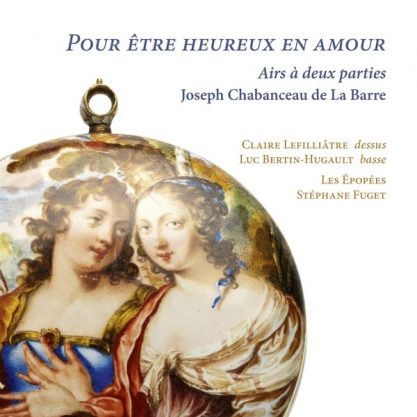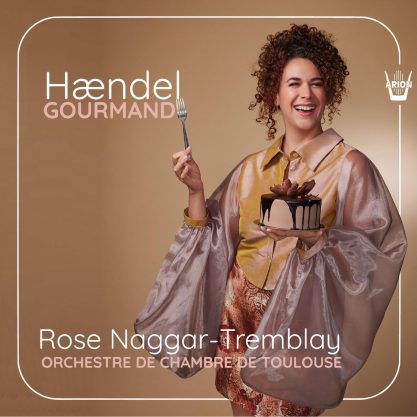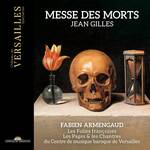Sandrine Piau © Sandrine Expilly
Georg Friedrich HAENDEL
Bérénice
Opéra en trois actes, HWV 38 (1737), sur un livret d’Antonio Salvi
Sandrine Piau ǀ Bérénice, Reine d’Egypte
Anne Hallenberg ǀ Sélène
Arianna Venditteli ǀ Alexandre
Paul-Antoine Bénos-Djian ǀ Démétrius, Prince de Macédoine
Rémy Brès-Feuillet ǀ Arsace
Matthew Newlin ǀ Fabio
John Chest ǀ Aristobolo
Il Pomo d’Oro
Direction Francesco Corti
Opéra en version de concert, Théâtre des Champs Elysées, Paris, mardi 21 mai 2024
Les rives égyptiennes de la Mer Rouge gardent en mémoire le souvenir de Bérénice, port de débarquement des éléphants de l’armée royale, venus des régions érythréennes. L’anse, baptisée par Ptolémée II Philadelphe en l’honneur de sa mère Bérénice I eut d’ailleurs deux autres établissements éponymes, dont Bérénice Pancrisia, célèbre pour ses mines d’or. Mais ne nous y trompons pas, Haendel ne s’inspire en rien de la vie de Bérénice I. Dans la généalogie, compliquée et souvent incestueuse des lagides, le compositeur anglais lui préfère l’une des ses descendantes du début du premier siècle avant Jésus-Christ, Bérénice III, fille de Ptolémée IX, ce même Ptolémée IX qui sous le nom de Toloméo est le héros de l’opéra de Haendel, donné ce vendredi 31 mai au Théâtre des Champs Elysées, avec Franco Fagioli dans le rôle-titre.
Bérénice III, successivement épouse de son oncle (Ptolémée X), puis de son cousin (Ptolémée XI), conserve une certaine renommée pour avoir contribué à empêcher une invasion Séleucide de l’Egypte. Mais Haendel n’a que faire de ces considérations historiques, s’appuyant sur un livret de l’italien Antonio Salvi (Bérénice, regina d’Egitto, daté de 1709 et repris aussi par Porpora ou Domenico Scarlatti), insufflant dans l’intrigue amoureuse des personnages macédoniens et romains bien plus identifiables pour les publics anglais et italiens. Soit Bérénice, éprise de Démétrius, allié de Mithridate, ennemi de l’Egypte, se voyant contrainte par alliance militaire d’envisager d’épouser le romain Alexandre. Mais comme souvent dans l’opera séria, l’intrigue n’est qu’un prétexte au déploiement de la maestria musicale du compositeur sur les airs solistes. Alors Haendel s’intéressant essentiellement à la musique, faisons de même et laissons le lecteur s’il le souhaite se pencher plus en avant sur les ressorts, finalement assez entendus, de l’intrigue amoureuse.
Crée au Covent Garden Théâtre de Londres le 18 mai 1737, l’œuvre fut marquée par un insuccès certain, ne connaissant que quatre représentations avant d’être retiré de l’affiche et de ne plus être remonté en Angleterre du vivant du compositeur. La faute peut-être à un genre qui commençait à lasser, Haendel ayant déjà plus de vingt-cinq ans de compositions derrière lui, à un premier rôle féminin finalement pas si étoffé, et à une partition marquée par une grande sobriété musicale, Bérénice se suffisant d’un effectif restreint, centré sur les cordes, hautbois (deux ce soir) et une basse continue présentement dominée par le clavecin de Francesco Corti, qui dirige l’ensemble Il Pomo d’Oro.
Une sobriété générale de la partition que le temps tend à réévaluer, l’œuvre réservant comme souvent (toujours ?) chez Haendel, de purs moments de plaisirs. Et le public du Théâtre des Champs-Elysées, venu en nombre ce soir, ponctue de nombreux airs d’applaudissements, au risque de décontenancer à au moins deux reprises les interprètes, obligés de marquer une suspension avant la poursuite.
Cet engouement s’explique avant tout par la très bonne tenue du plateau masculin, ou pour être plus précis, des rôles masculins de l’œuvre. Car c’est en effet, dans le rôle d’Alexandre, romain promis à et épris de Bérénice, que se doivent d’aller nos premiers éloges à la jeune soprane Arianna Venditelli, voix d’une grande clarté, d’une belle projection, et à la présence scénique très convaincante dès le premier aria qui lui est dévolu, le Che sara quando amante accarezza (Acte I, scène 4), aux vocalises agiles et souples, s’attirant immédiatement les faveurs du public. Des qualités vocales dont elle ne se départira pas tout au long des trois actes de l’œuvre, notamment en fin de représentation, occasion pour elle d’émouvoir une fois de plus, implorant l’amour de Bérénice (“In quella, sola in quella, candida mano a bella, ha posto la mia sorte il Dio d’Amore”, Acte III, scène 7), ou dans le très beau duo qui suit avec Bérénice, concluant l’expression des sentiments les plus tendres (“Caro dardo”, Acte III, scène 9).
Complétant cette galerie de personnages masculins charismatiques, Paul-Antoine Bénos-Djian, remarqué récemment en ces pages pour son interprétation du “Sovvente il sole” de Vivaldi dans le dernier album du Concert de la Loge (Alpha), impose un Démétrius à la voix ample et souveraine, capable aussi d’une grande sentimentalité, à l’exemple de sa touchante plainte envers Séléné, sœur de Bérénice dont il est épris, constituant l’un des moments les plus émouvants de l’œuvre (Selene, infida ! Spergiurato amore, Acte II, scène 4).
Rôle concis et pourtant prestation remarquée pour Matthew Newlin, qui dans le rôle de Fabio, ambassadeur de Rome et pour le moins personnage entremetteur dans les intrigues de l’argument, fait preuve d’une belle présence vocale, ténor d’une grande clarté de diction, notamment dans le bel air qui l’impose dès le début de l’œuvre, le très métaphorique “Vedi l’ape che ingegnosa… (Acte I, scène 3)”, regarde l’abeille ingénieuse, qui vole et se pose sur ces fleurs, là où le suc est le plus nourrissant. Un message, à peine subliminal, envoyé à Alessandro.

Arianna Venditteli © Manuela Giusto
Sandrine Piau incarne Bérénice, qui tout en s’aventurant depuis quelques années dans des répertoires plus contemporains n’en oublie pas pour autant le baroque, et notamment Haendel, qu’elle connait si bien. Reconnaissons que la majeure partie du premier acte la laisse un peu en retrait et qu’il faut attendre le fameux duo final de cette première partie, avec Démétrius, pour la voir exprimer toute la sensibilité qu’elle sait donner à son personnage, gracile, aux intonations subtilement piquantes, ce “Se il mio amore fu il tuo delitto” (Acte I, scène 11), démontre que si la projection vocale se modère, la couleur et l’expressivité se polissent, une majesté souveraine que l’on retrouvera notamment en fin d’œuvre, quand simplement portée par une ligne de hautbois, elle s’interroge sur les turpitudes de la raison et de la sincérité des sentiments (“Chi t’intende ? O Cieca instabile”, Acte III, scène 4).
Ann Hallenberg dans le rôle de Sélène, sœur de Bérénice et Rémy Brès-Feuillet dans celui d’Arsace, épris de cette même Sélène, se réservent eux aussi quelques airs des plus gracieux, bien que moins marquants. Francesco Corti, que nous avions trouvé bien sage en mars dernier à la tête du Freiburger Barockorchester lors de la représentation ici même de la Passion selon St-Matthieu de Jean-Sébastien Bach trouve en dirigeant Il Pomo d’Oro, formation qu’il dirige régulièrement depuis 2018, un orchestre plus à même de le suivre dans une expression personnelle de l’œuvre. S’appropriant le caractère sobre de la partition de Haendel, ne cherchant jamais à en surjouer les effets, il offre une interprétation toute en sensibilité, notamment du célèbre menuet d’ouverture et sert ensuite une œuvre essentiellement construite pour servir les solistes, sans recherche de grandiloquence inutile.
Opéra tardif de Haendel (après 1741, il se consacrera principalement à la composition d’oratorio), ce Bérénice, dont il faut bien avouer que le livret pourrait réserver un peu plus de rebondissements, souvent relégué au rang d’œuvre secondaire (Haendel ne pouvait à l’époque de sa composition plus compter sur la présence de Senesino, même si le plateau d’origine comptait quelques grands interprètes des œuvres du compositeur, à l’exemple de la soprane Anna Maria Strada dans le rôle de Bérénice) est à redécouvrir pour la majesté, intacte, de certains airs et duo typiquement haendéliens. La représentation de ce soir, agile et sensible dans sa représentation de la Lagide, rend un bel hommage à cette œuvre quelque peu délaissée.
Pierre-Damien HOUVILLE
Étiquettes : Bénos-Djian Paul-Antoine, Corti Francesco, Haendel, Hallenberg Ann, Il Pomo d'Oro, Newlin Matthew, opéra, Piau Sandrine, Pierre-Damien Houville, Théâtre des Champs-Élysées, Venditelli Arianna Dernière modification: 31 mai 2024