Porporino, ou les Mystères de Naples
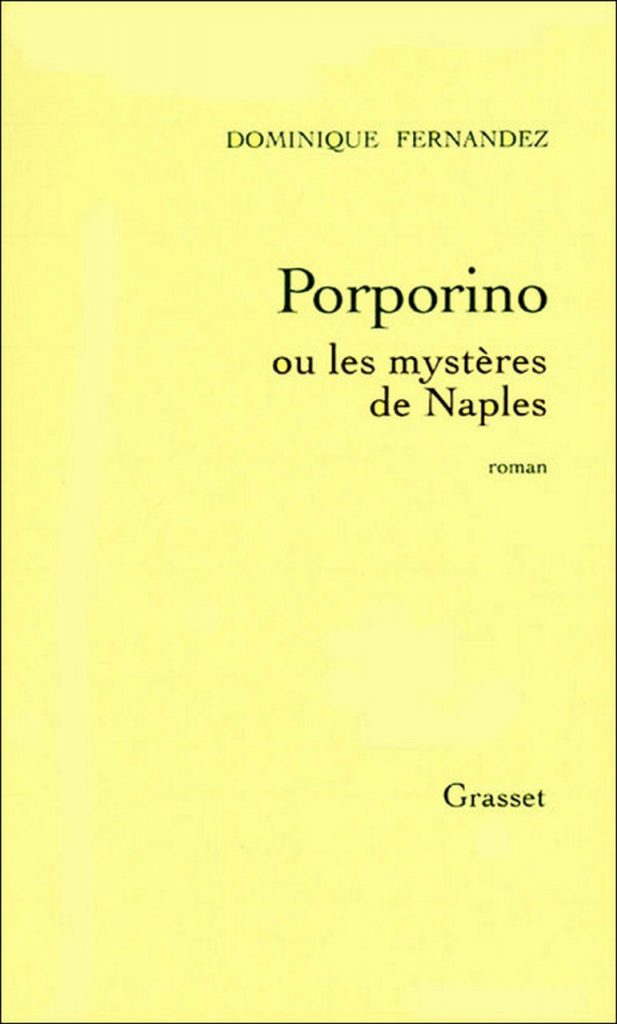
Dominique FERNANDEZ
Porporino ou les Mystères de Naples
Grasset & Fasquelle, 1974. Réed Grasset, Cahiers Rouges, 2005. 489 pages.
Prix Médicis 1974.
La publication en janvier dernier de L’Italie Buissonnière (Grasset) de Dominique Fernandez, suite de très érudites pastilles sur des joyaux souvent méconnus de l’immense patrimoine artistique de la péninsule, nous a donné envie de replonger dans l’une des œuvres phares de son auteur, Porporino, ou les Mystères de Naples (Grasset). Publié en 1974 et auréolé du prix Médicis la même année, l’ouvrage devait valoir à son auteur un début fort mérité de reconnaissance critique qui se confirmera quelques années plus tard par son Goncourt, obtenu en 1982 pour Dans la Main de l’Ange (Grasset), variation romanesque sur la vie de Pier Paolo Pasolini.
On sait l’attrait qu’exerce l’Italie du sud sur Dominique Fernandez depuis ses jeunes années, de même que l’érudition précise et humaniste le caractérisant, lui qui avec Mère Méditerranée (Grasset, 1965) signait à trente-six ans un ouvrage qui de la Sardaigne à Naples en passant par Sicile et Calabre, extrayait les fondements de l’identité méridionale dans une argumentation cultivée, plaisante, réaliste, loin des stéréotypes réducteurs et simplificateurs, prompte à souligner les spécificités de contrées que l’éloignement physique et économique du cœur actuel de l’Europe fait trop vite oublier.
Contrairement à ce que pourrait laisser supposer son titre, évocation biographique d’un descendant de Porpora (1686-1768) égaré dans un roman d’Eugène Sue (1804-1857), ce n’est pas dans la cité parthénopéenne que s’ouvre le roman, mais bien plus au nord, à Heidelberg, ville germanique des bords du Neckar, patrie de la Princesse Palatine et des frères Grimm. Un avertissement de l’éditeur, a priori anonyme, fait en effet mention de la découverte dans les caves du château d’un manuscrit rédigé en français, mémoires d’un castrat inconnu de la fin du dix-huitième siècle et nommé Porporino, sopraniste ayant vécu sa jeunesse dans le Mezzogiorno, fait carrière à Naples avant de terminer, oublié et reclus dans ce château de Heidelberg, bien au nord de sa terre natale.

Dominique Fernandez – Source : Wikimedia Commons
Cette fausse relation des circonstances de la découverte d’un manuscrit ancien par un éditeur anonyme, mais où transparaît la plume de Dominique Fernandez, est l’occasion de poser les grands thèmes du roman, la musique à Naples à la fin du XVIIIème siècle bien évidemment, mais aussi celui du trouble d’une identité de genre définie, thème majeur qui irrigue l’œuvre de Fernandez, et plus largement encore celui d’un monde qui change, le monde de la musique, comme la société en son ensemble, vers la prédominance de la science, du rationalisme et des libertés individuelles, valeurs dont l’auteur prendra plaisir à souligner au lecteur quelques contradictions. Et déjà les références pointent. Qui en effet ne verra dans l’auteur de ce manuscrit, hier flamboyant, aujourd’hui reclus et rédigeant en français sa vie et ses rencontres l’ombre de Casanova ? De même, cette fausse introduction, ancrant les circonstances de la découverte des pseudos-mémoires à venir ne peut que rappeler l’incipit de Frankestein (1818) de Mary Shelley, grande œuvre sur l’éthique de la science et la morale humaine, et les lecteurs qui douteraient a priori d’un tel hommage voilé n’auront qu’à se reporter aux derniers chapitres de Porporino pour constater que cette correspondance n’est pas fortuite.
Le lecteur, qui espérant se voir conter Naples, s’est retrouvé dans les brumes d’Heidelberg à la lecture de ce déroutant avertissement d’éditeur devra encore patienter avant de goûter les charmes du Vésuve. En effet, dans toute la première partie du roman, Naples est absente, où plutôt inconnue, évoquée par touches dans le fil de la narration et des représentations du narrateur, comme la grande ville, la capitale du pouvoir, une capitale qui est sans doute moins à comprendre comme une force de diffusion de sa splendeur sur le territoire que comme un pôle attractif, où comme aspirées par la force de Coriolis viennent s’agréger toutes les richesses et les talents du sud de la péninsule italienne. Porporino, narrateur de sa jeunesse y conte donc ses premières années dans le petit village de San Donato, en Calabre, bourg décrit comme essentiellement pastoral, peuplé de paysans humbles, où la vie est rythmée autant par les traditions que par les croyances, s’agglomérant autour de la figure défraîchie de sa vieille forteresse normande et où le seigneur du lieu, le Prince de Sansevero, ne passe qu’une fois l’an, résidant la plupart du temps à Naples. Faut-il voir dans ce village de San Donato l’actuel San Donato di Ninéa à environ 70 kms au nord de Cosenza ? Peut-être quand on sait que Dominique Fernandez voyage dans ces régions avant même l’écriture de Mère Méditerranée où il mentionne se procurer à Cosenza un exemplaire fac-similé de La Grande Grèce (1881-1884) de François Lenormant, incontournable et indépassable ouvrage sur l’histoire et l’archéologie de chaque recoin de l’Italie au sud d’un axe Paestum-péninsule du Gargano. Le village, qui en 1864 sous l’impulsion du jeune gouvernement unifié a rajouté son extension di Ninéa en souvenir de la ville grecque de Ninéa que le géographe Ecateo di Mileto place sur son territoire, et cela afin de se distinguer des autres toponymes éponymes, appartint à partir de 1374 à la famille Sanseverino mais changea de domination en 1664, suite à l’extinction de la branche régnante dans cette partie du royaume de Naples. Peu importe que le San Donato de Porporino soit ou non ce village, tant la description du bourg répond à de multiples lieux de Calabre où s’écoule une vie qu’il est trop souvent réducteur de qualifier de miséreuse, l’équilibre se créant entre la prodigalité miséricordieuse et la sécurité apportées par les princes d’un côté et la soumission féodale d’une population essentiellement agricole de l’autre. Dominique Fernandez, parfois dédaigneusement qualifié de méridionaliste par les apôtres septentrionalistes d’une Italie des villes et principautés indépendantes et préindustrielles se fera peut-être railler pour les descriptions de cet équilibre pastoral. C’est oublier qu’il a montré, encore récemment avec La Société du Mystère (Grasset, 2017), que sa connaissance de la culture de l’Italie du nord égale celle du sud et que ses connaissances font sans doute de lui l’auteur le plus légitime pour réévaluer l’apport culturel et la richesse artistique du Mezzogiorno.
Porporino, qui ne s’appelle encore que Vincenzo del Prato, de Vincenza, prénom de sa grand-mère maternelle, ce qui permet à l’auteur de souligner une déjà latente confusion des genres, vit à San Donato, entouré des solidarités de village, du rite immuable de la passegiatta, et des jeux des enfants de son âge, entretenant une camaraderie dénuée de toute équivoque avec Luisilla, une enfant du village. Vie joyeuse, épanouissante, à l’écart de tout rôle social et de toute contrainte liée à son statut d’homme ou de femme, ou comme le résume le narrateur, « la sagesse et le bonheur ne commencent que là où finit la conscience de son propre statut ». Bonheurs simples de cette vie de village campagnard où règne une homogénéité sociale que vient renforcer encore le nombre limité de patronymes, qui comme pour Vincenzo se transmettent le plus souvent selon des traditions intergénérationnelles. Importance aussi de la religion dans ce sud de l’Italie, Vincenzo se distinguant par la beauté de sa voix dans la chapelle de la petite église du village, sous l’égide de Don Sallusto, professeur de chant présenté comme graisseux et efféminé, ayant autrefois fait une carrière sans éclat à Naples. L’arrivée de « visiteuses » dans le village, que nombre d’hommes se pressent de rencontrer pour quelques moments furtifs et inavouables dans une maison abandonnée à l’écart du village, est l’occasion pour le jeune Abbé Pérocades, toujours prompte à la péroraison et personnage central du roman, de tenir un prêche moralisateur à ses ouailles, en opposition à une tradition ancrée et tolérée. Pourquoi la morale viendrait-elle régenter la coutume dans une société engoncée par la religion, déjà soumise à l’âpreté des conditions de vie, aux mariages arrangés, à la promiscuité dans les logis. Oui, la prostitution est aussi à San Donato un exutoire, un régulateur de la société et pour ne pas l’avoir compris Pérocades se fera sortir de sa chaire. Passage important où Dominique Fernandez distille le caractère relatif et souvent conjoncturel de toute morale, thème qui irrigue l’ensemble de Porporino et plus généralement de son œuvre.
La suite de cette première partie d’ouvrage oscillera entre exaltation de l’indétermination, sociale ou de genre, et l’évocation quasi ethnologique de l’Italie du sud. Quand pour la première fois Vincenzo embrasse Luisilla, a priori rien ne se brise, rien n’est gâché, mais pourtant, pour la première fois nos deux protagonistes sont ramenés à leur condition sexuée. Avouant son délicieux forfait à sa mère Vincenzo est dès lors ramené son statut d’homme en devenir, de même que Luisilla à celle de femme éveillant le désir. L’ombre de l’opération, à peine sous entendue auparavant, plane et avec elle l’idée qu’à jamais Vincenzo sera un être indéterminé, évoluant au sein d’une société où le sexe se doit de déterminer la conduite, le comportement et les goûts. Cette constatation, qui apparaît par bien des aspects encore très contemporaine est l’occasion pour Dominique Fernandez de glisser vers l’évocation de ce que chaque société a de construit et par cela peut être de factice. La vie des villages du Sud est pétrie de croyances et de superstitions, lointaines réminiscences de l’ancestral paganisme avec lesquelles se doit bien de composer Don Sallusto mais que réprouve l’instruit, éclairé, rationnel et Franc-Maçon Pérocades. Les échanges entre Don Sallusto et Vincenzo dans cette partie du roman sont l’occasion d’expliquer en quoi l’Italie du sud a été non pas civilisée, terme si relatif, mais forgée par les espagnols, ancêtres des princes régnants, qui au nom d’un ordre civilisationnel fondent les principes rigoristes sur lesquels elle vit encore. L’usage des cercueils pour les mises en bière, mais aussi l’usage privé de la propriété ou encore un usage de l’ornementation dans l’architecture passant par la prédominance souvent ostentatoire du balcon. Cette construction sociétale trouve son acmé dans la distinction faite au sein des églises entre les hommes qui siègent d’un côté et les femmes de l’autre. Pourquoi ainsi séparer ce qui a vocation à se rassembler ? La raison en est simple. L’homme comme la femme ainsi séparés ont l’occasion de prendre conscience et d’assimiler leur rôle et leurs responsabilités au sein de la société. Quand en conscience ils franchiront la travée pour s’unir, ce sera en pleine conscience, sous le regard de Dieu, de leur rôle et de leur choix, et non poussés par la force aveugle d’une impulsion première. Ainsi, l’héritage fortement catholique du Mezzogiorno découle-t-il de la forte influence espagnole dans ces régions plus que de l’influence de Rome.
Mais la fin de cette première partie nous fait sentir qu’il est temps de quitter San Donato. Les rapports entre Vincenzo et son père se tendent et quand entre Luisilla et Vincenzo se noue un enfantin et a priori futile pacte de sang, derrière cette symbolique entaille s’évanouit l’enfance, cet âge enchanteur des possibles et de l’indifférenciation, pour laisser place à l’émergence du rôle que la société dévoue aux hommes comme aux femmes. Symboliquement équivalent des menstruations, l’entaille de Vincenzo le fait quitter le monde de l’enfance, vers un ailleurs incertain.

Les lecteurs mélomanes qui n’auraient pas goûtés tout le sel de cette première partie, qui derrière l’argument et la description est à lire comme une très grande évocation ethnologique et morale, mais dénuée presque complètement de considérations musicales, se raviront de cette deuxième partie du roman. Nous retrouvons Vincenzo à Naples dans les années 1760 avec tout ce que cette ville comporte à l’époque de dynamisme, d’effervescence artistique, d’influence sur le monde artistique et de richesses, au point qu’il n’est pas utile de rappeler dans les présentes pages que la ville est à cette époque une métropole économique et culturelle de premier plan à l’échelle européenne. De même éviterons-nous de nous fourvoyer dans une évocation forcement partielle des livres à lire sur la Naples de cette époque, nous permettant juste de citer le souvent méconnu et pourtant remarquable livre de Raffaelle La Capria, L’Harmonie Perdue (L’inventaire, 2001, 1986 pour l’édition originale italienne), très belle évocation de la cité parthénopéenne et de sa culture à travers les âges.
Nous sommes en 1763, Vincenzo a maintenant quinze ans et étudie depuis trois ans au Conservatoire des Pauvres de Jésus-Christ, place des Gerolomini, en face de l’église des Gerolomini qui constitue l’un des plus beaux exemples du baroque napolitain en architecture. Où l’on apprend vite que Vincenzo a été opéré par Giuseppe Salerno, médecin personnel du prince Raimondo Sansevero, par section du cordon spermatique. Sa vie est désormais rythmée dans cette véritable école d’apprentis sopranistes que constitue le Conservatoire des Pauvres de Jésus-Christ par le service à la chapelle, mais encore plus spécifiquement par les leçons de contrepoint de Antonio Sacchini (1730-1786), celles de chant par Giuseppe Aprile (1731-1813), premier sopranistes du San Carlo, connu aussi sous le nom de Scirolino, nom de scène adopté en l’honneur du compositeur Sciroli (1722-1781). Vincenzo se lie d’amitié avec un jeune élève de son âge, Domenico Cimarosa (1749-1801), « intact », ce qui ne l’empêche pas d’être décrit comme gras et replet, conséquence de ses abus de douceurs à la pâtisserie Startuffo. Description précise de la vie de ces jeunes sopranistes, pour la plupart d’origine très modeste, le plus souvent entretenus par un membre de l’aristocratie, en l’occurrence pour Vincenzo le prince Raimondo di Sansevero, comme nous l’avons vu seigneur de sa localité, et dont Vincenzo apprendra bien vite la crainte qu’il inspire, ou plus exactement la crainte qu’inspirent les multiples expériences scientifiques qu’il réalise dans les caves de son palais.
Mais Dominique Fernandez ne s’arrête à un simple exposé en toile de fond de l’apprentissage des castrats napolitains, il en évoque les références, les ambitions et les rivalités. Planent sur le couvent les ombres tutélaires de deux prestigieux anciens élèves, Farinelli (1705-1782), retiré à Bologne après une carrière européenne, ou celle de Caffarelli (1710-1783), retiré dans son domaine d’Otrante, après une carrière elle aussi majestueuse et en partie espagnole, les liens de sang avec la couronne d’Espagne favorisant leurs carrières sous le règne de Philippe V. On y contera aussi l’art de gagner quelques subsides lors des fêtes de San Genaro, celui de s’exercer sur la vaste production de Frottola, les inévitables rivalités entre élèves, mais aussi l’esprit de corps qui les animent, conscients de leur propre bouffonnerie dans une seconde moitié du dix-huitième siècle où le rationalisme des Lumières et un vent de liberté tend déjà à reléguer le castrat napolitain au rang d’anormalité cruelle favorisée par le pouvoir espagnol. Vincenzo, qui bientôt prend son nom de scène, Porporino, en hommage à Nicola Porpora (1686-1768), qui vient de s’éteindre dans la ville. Précisons que Porporino est un personnage entièrement fictif, aucune relation n’est à faire avec le castrat Antonio Uberti (1697-1783), surnommé Il Porporino, et qui avait lui été élève du compositeur.
La création musicale, si vivante et si importante dans la vie mondaine de Naples est aussi l’occasion pour l’auteur du roman d’évoquer les multiples aspects de la vie intellectuelle napolitaine et d’ainsi se faire croiser les trajectoires de nombreuses figures de cette fin de siècle. Le Prince de Sansevero entretient par exemple une correspondance avec l’Abbé Nollet (1700-1770) autour du devenir de la matière lors de la combustion, occasion de digressions savoureuses sur le rapport entre la matière et le souffle, que ce soit en combustion ou concernant la voix humaine des castrats. Une réception donnée par la comtesse de Kaunitz au Palazzo San Felice sur les contreforts du Capodimonte sera ainsi l’occasion de voir disserter le jeune Amadeus Mozart (1756-1791) sur ses conceptions de la musique, sous l’œil de son père, d’une bienveillance inquisitrice. Casanova (1725-1798), en personnage de la bonne société européenne distrait l’assemblée en narrant une aventure libertine et vénitienne, et l’on discutera de la performance du sopraniste Venanziano Rauzzini (1746-1810) l’avant-veille, dans l’Armide Abandonnée (1770) de Niccolo Jommelli (1714-1774). Sara (décédée en 1800) et Ange (1708-1791) Goudar sont également des convives.
Relater la pléiade de personnages croisés au cours des pages reviendrait à plagier le roman et nous laissons au futur lecteur la joie érudite de tous les découvrir et de dénouer les fils de leurs relations, tout en précisant que les chronologies croisées de leurs réelles présences à Naples ne permettent pas toujours de valider la potentialité historique de leurs échanges. Qu’importent ces petites libertés tant l’évocation est stimulante, et au-delà du plaisir de voir revivre la société napolitaine, ces pages sont aussi l’occasion d’amorcer l’évocation des mutations profondes de la société, dont le déclin annoncé des castrats n’est qu’un épisode révélateur parmi d’autres. Car la musique elle aussi change, l’opéra buffa prend peu à peu le pas sur l’opéra seria, et La servante Maîtresse de Pergolèse (1733), au succès international, supplante dans les cœurs les vieux livrets de Métastase. Le Teatro Nuevo et les Fiorentini font ombrage au San Carlo. Pérocades, apôtre d’un nouveau monde prêt à se construire sur les ossements de l’ancien affirme à propos des castrats que le faux, l’artificiel, l’antinaturel ne peut servir à exprimer l’aspiration à la justice et à l’égalité entre les hommes. Porporino, témoin des échanges sent que l’avenir de la musique ne lui réserve pas une grande place et qu’il appartient bien malgré lui à une espèce vouée à disparaître. Dominique Fernandez lui, nous brosse à ce moment en quelques dizaines de pages aussi savantes que sublimes un formidable condensé de la fin de la musique baroque, professant au passage que l’évolution des conceptions, matrice nécessaire et essentielle des sociétés humaines ne doit se faire sur la négation des conceptions anciennes, au risque de se priver de leurs richesses, de tuer ce qu’elles peuvent avoir de fertile et de nous rendre étranger à notre propre identité.
Si cette deuxième partie du roman a été l’occasion de plonger dans les arcanes des conceptions musicales en cette fin de l’ère baroque, et cela au cours de tableaux très enlevés dont ces lignes ne peuvent retranscrire qu’une partie des débats, la dernière partie de l’ouvrage sera plus centrée sur Naples, ce qu’elle possède comme identité et fait qu’elle fut et reste l’une des cités les plus attirantes d’Europe. Bien entendu, prenant plaisir à entrecroiser ses thèmes, Dominique Fernandez nous offre, outre une réflexion sur l’identité de Naples, de savoureuses réflexions sur l’identité musicale, et plus généralement celle du genre.

Aussi cette troisième partie débute-t-elle par une longue déambulation de Porporino et Pérocadès dans les rues de la cité, à la recherche de son identité. Une identité qui s’affirme finalement dans le rejet de la rationalité, Naples se complaisant non pas dans une splendeur déchue, mais dans une splendeur jamais concrétisée, laissant notamment apparaître comme remaniés des palais qui n’ayant jamais atteint le stade adulte, resplendissent par l’indétermination de leur fonction finale. Les alentours de la Via Toledo qui coupe la ville en deux, physiquement et socialement, sont ainsi le symbole de la multiplication de l’aristocratie sous les espagnols, qui s’inscrit dans l’architecture de la ville sans arriver à la définir. Au Foro Carolino (actuelle Piazza Dante) sont évoquées les vingt-six vertus de Charles III d’Espagne. Le passage par le vicolo carminiello où vécut Caffarelli sera l’occasion de digressions osées sur le retournement du désir sexuel selon l’âge, et le caractère finalement très sociétal de celui-ci. Puis, en approchant du Palazzo Cellamare, via Chiaia, est évoquée une autre figure incontournable de Naples, celle du Jettatore, du mauvais œil, qui inspira à Théophile Gautier l’une de ses meilleures nouvelles (Jettatura, 1857), figure irrationnelle, anticartésienne qui reste si essentielle à la compréhension de l’essence de la ville. Conversation qui se terminera sur l’évocation de la pauvreté consubstantielle à la ville, qui engendra malgré ou par cela quelques-uns des plus importants compositeurs du siècle.
La représentation d’un opéra de Tommaso Traetta (1727-1779) avec notamment Gasparo Pacchiarotti (1740-1821) dans la distribution en gala de printemps au San Carlo, représentation à laquelle assiste le Chevalier d’Eon (1728-1810) sera l’occasion d’évoquer, au-delà de l’identité sexuelle, la place de cette identité dans la musique, nombre de distributions d’opéras confiant des rôles masculins a des castrats pouvant se retrouver avec des tessitures plus hautes que leurs partenaires féminines. Jeu des apparences et des contradictions qui culmine avec l’évocation de la carrière de Giusto Fernando Tenducci (1736-1790), castrat marié, et selon les mémoires de Casanova, père de deux enfants. La musique n’est-elle pas indissociable du faux-semblant, du travestissement, ne serait-ce que dans la tradition ancrée à Naples de la réutilisation des airs, de la copie, du plagiat, n’évoluant qu’en se cachant sous le voile de la continuité pour mieux se réinventer ?
La nécessité de ne pas dévoiler au lecteur ce qu’il advient en fin de roman de Porporino, de Pérocadès, du Prince Raimondo de Sansevero et de quelques autres protagonistes réels ou fictifs de cette histoire nous obligera à un salutaire laconisme sur quelques rebondissements et sur les événements historiques qui en transformant le Royaume de Naples en République Parthénopéenne provoqueront des évolutions sociétales majeures dont le monde musical ne sera pas exclu et se traduiront par la fin de l’ère des castrats dans la musique napolitaine. Permettons-nous juste de dévoiler au futur lecteur qu’avant de s’effacer Porporino aura l’occasion de visiter la chapelle de Sansevero en compagnie de Raimondo, et croisera de bien étranges et féminines créatures comme la Duchesse de San Felice ou encore Lady Hamilton…
Mais ne nous y trompons pas, relire de nos jours Porporino, ce n’est pas seulement replonger dans la Naples flamboyante, baroque et parfois éruptive de la fin du XVIIIème siècle, c’est aussi se réimprégner de quelques thématiques caractéristiques de la littérature des années 1970. Porporino, nous l’avons vu, en plus d’être un grand roman sur la musique Baroque, en plus d’être un grand roman sur Naples, est aussi un grand roman sur la définition de l’Identité et plus particulièrement sur l’influence de son sexe dans la construction de son identité et dans les attendus de comportements sociaux que la société nous impose. Si ces questionnements qui irriguent l’ensemble du roman peuvent pousser dès son entame à une comparaison osée et un peu vieillie, celle de savoir si les castrats ne sont pas au XVIIIème ce que les hippies sont à la fin du XXème, la constante interrogation dans le roman, non pas seulement de la sexualité, mais de l’identité de genre et de ses schémas, des contradictions et des retournements des désirs selon les âges de la vie ou selon les sociétés, interpellera encore le lecteur du début du XXIème siècle. Le panel des possibles, des ressentis et des expressions du désir peut d’ailleurs plus choquer actuellement que lors de la sortie du roman, qui se fit dans un contexte plus tolérant qu’actuellement, que d’aucuns jugeront trop permissif. Notons au passage que l’année d’avant Porporino, soit en 1973, le Prix Médicis avait été attribué à Paysage de Fantaisie (Editions de Minuit) de Tony Duvert (1945-2008), subversif roman sur la prostitution de petits garçons de la part d’un auteur reconnu comme ouvertement pédophile. Bien entendu, le rapprochement s’arrête à cette collusion dans l’attribution deux années de suite du prestigieux prix littéraire à deux romans, qui chacun à leur manière, interrogent les accents si multiples du désir. Dans Porporino, c’est bien la tolérance affichée envers l’institution du castrat, et cela même si cet état n’est pas choisi par l’intéressé, qui pourra choquer. C’est oublier que Dominique Fernandez, de ses premiers écrits à ses récentes prises de positions médiatiques, nous amène à ne pas considérer les comportements passés au regard des normes sociales actuelles, si conjoncturelles et donc si précaires.
Voilà, nous pourrions nous arrêter là et conclure. Le lecteur nous semble assez renseigné soit pour avoir envie de plonger ou replonger dans les méandres du Porporino de Dominique Fernandez, ou bien passer loin au large de la baie de Naples et voguer vers d’autres horizons littéraires. Pourtant quelque chose manquerait, car une figure plane dans le roman au-dessus de Naples, qui s’impose sans jamais être citée parmi les dizaines de personnages fictifs ou réels qui jalonnent les cinq-cents pages du roman. Qui en effet, quelques dizaines d’années après le très fictif Porporino et près d’un siècle et demi avant le très réel Dominique Fernandez, eut l’occasion de parcourir l’Europe du fin fond de la Calabre à la forteresse de Heidelberg ?
Ne laissons pas languir nos lecteurs. Cette figure, c’est celle d’Alexandre Dumas. Dumas, l’un des rares voyageurs européens du dix-neuvième siècle à avoir parcouru la Calabre, expédition qu’il relate dans Le Capitaine Arena (1842), où il passe non loin de San Donato, mais qui fit aussi de la forteresse de Heidelberg le théâtre de son roman Le Trou de l’Enfer (1851). Dumas encore, amoureux de Naples qu’il dépeint dans Le Corricolo (1843), où le lecteur attentif pourra déjà croiser quelques personnages communs avec Porporino. Et Dumas toujours, que les mutations napolitaines de la fin du dix-huitième inspireront, du destin de la sulfureuse Lady Hamilton dans Souvenirs d’une favorite (1865) à celui au combien tragique de la duchesse Maria Luisa Sanfelice dans La San-Felice (1864). Autant de correspondances non dues au hasard quand on sait l’admiration que porte Dominique Fernandez à Alexandre Dumas, à qui il consacra un très bel essai, Les Douze muses d’Alexandre Dumas (Grasset, 1999), s’attelant à remettre l’écrivain au panthéon des plus grands auteurs français et rappelant que dans un dix-neuvième siècle romantique et bourgeois, Alexandre Dumas su, dans nombre de ses plus grands romans, comme dans pléthore d’œuvres plus oubliées, se montrer le dernier défenseur d’une geste baroque, partisan de l’exercice parfois irrationnel de l’honneur et du panache qui au prix de quelques fioritures caractérise ses personnages. Il y a donc dans Porporino, dans cet art consumé d’entremêler la grande histoire et les destins individuels, dans le souffle épique comme dans le goût immodéré pour les personnages hors norme, dans l’art de croquer les personnages et de faire avancer le récit, aussi un hommage feutré mais bien réel de la part de Dominique Fernandez à Alexandre Dumas, un Dumas qui par ailleurs fut souvent ramené à une condition identitaire indépendante de son être.
Bref, une lecture qui nous a furieusement donné envie de…retourner à Naples, réécouter Porpora, Jommelli et Cimarosa, retourner en Calabre (en passant par Heidelberg), trouver quelques Dumas oubliés…soit une lecture aussi enrichissante que porteuse de promesses…
Pierre-Damien HOUVILLE
Étiquettes : Alexandre Dumas, Italie, littérature, Naples, Pierre-Damien Houville Dernière modification: 27 septembre 2020






