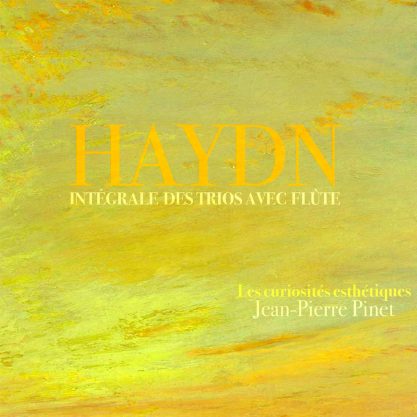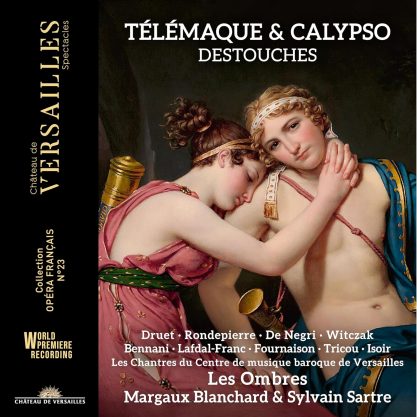Christoph Willibald von GLUCK (1714-1787)
Iphigénie en Aulide / Iphigénie en Tauride
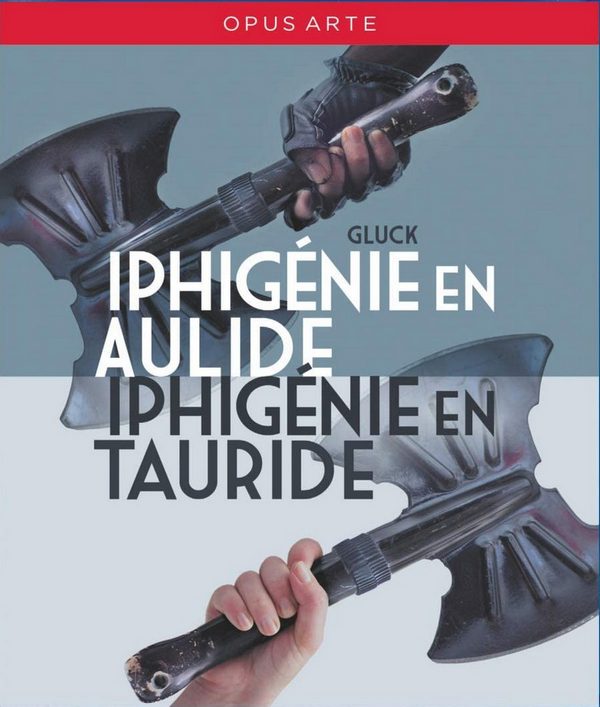
Iphigénie en Aulide
Tragédie en trois actes (1774), sur un livret de Marie François Louis Gand Leblanc du Roullet d’après Iphigénie en Aulide de Racine (inspirée par Euripide)
Véronique Gens (Iphigénie), Salomé Haller (Diane), Nicolas Testé (Agamemnon), Anne-Sofie von Otter (Clytemnestre), Frédéric Antoun (Achille), Martijn Cornet (Patrocle), Christian Helmer (Calchas), Laurent Alvaro (Arcas)
Iphigénie en Tauride
Tragédie en quatre actes (1779), sur un livret de Nicolas-François Guillard d’après Iphigénie en Tauride de Latouche (inspirée par Euripide)
Mireille Delunsch (Iphigénie), Laurent Alvaro (Thoas), Jean-François Lapointe (Oreste), Yann Beuron (Pylade), Salomé Haller (Diane), Simone Riksam (première prêtresse), Rosanne van Sandwijk (seconde prêtresse), Peter Arink (un Scythe), Harry Teuwen (un ministre), Gonnie van Heugten, Madieke Marjon, Maartje Rammeloo, Floor van der Sluis (prêtresses).
Chœurs du Nederlandse Opera
Direction : Martin Wright
Orchestre des Musiciens du Louvre
Direction : Marc Minkowski
Mise en scène : Pierre Audi
Décors : Michaël Simon
Costumes : Anna Eiermann
Lumières : Jean Kalman
Scénographie : Klaus Bertisch
2 DVD, 229′ (plus les bonus). Opus Arte. Enregistré en public au Nederlandse Opera d’Amsterdam le 7 septembre 2011.
 Arrivé à Paris à l’automne 1773 à l’instigation de sa protectrice la Dauphine Marie-Antoinette et soutenu par Antoine Dauvergne qui était alors l’un des Directeurs de l’Académie Royale de Musique, le chevalier Glück était venu en France avec le grand dessein de renouveler le genre de la tragédie lyrique française. Il travaillait depuis le début de l’année sur son Iphigénie en Aulide, dont le livret avait été composé pour la circonstance par le bailli Du Roullet. Celle-ci fut représentée le 19 avril 1774 en présence d’une partie de la famille royale. Elle connut un succès immédiat, bien que certains spectateurs déplorassent l’absence de décors grandioses et de « machines », ainsi que la brièveté des airs de ballets. Le sourcilleux Rousseau reconnut lui-même qu’on pouvait « faire de bonne musique étrangère sur des paroles françaises », mettant ainsi un point final aux spéculations de la Querelle des Bouffons – rapporté par Benoît Dratwicki in Antoine Dauvergne, une carrière tourmentée dans la France musicale des Lumières. Capitalisant sur ce premier succès, Glück livra dès le mois d’août suivant l’adaptation française d’Orfeo e Eurydice (créé en 1762). Cinq ans plus tard, à l’instigation de l’audacieux Devisme (alors à la tête de l’Académie), l’Iphigénie en Tauride affrontait la production concurrente et éponyme de Piccini, qu’elle écrasa de son succès. La carrière parisienne du chevalier allait toutefois bientôt s’achever sur le cuisant échec de son Echo et Narcisse, créé la même année à l’Académie. Les deux épisodes de l’existence de la fille des Atrides marquent ainsi le début et la fin du passage de Glück à Paris. Ils permettent aussi de mesurer la maturation de son génie lyrique : d’une pièce à l’autre le drame se resserre autour de quelques personnages-clés, et l’atmosphère musicale se tend par degrés progressifs jusqu’à l’heureux et bref dénouement final. L’efficacité dramatique augmente aussi considérablement, puisque les échanges entre Oreste et Pylade sont infiniment plus poignants que les protestations de fidélité d’Achille à Iphigénie ou que les tergiversations d’Agamemnon. Mais on retrouve dans les deux pièces la description minutieuse des sentiments contraires qui animent les personnages, dans leur complexité psychologique, et leur lutte difficile contre d’implacables commandements divins. Dans le contexte des Lumières, ce combat résonne comme celui de la « loi naturelle » contre les obscurantismes religieux de toute nature.
Arrivé à Paris à l’automne 1773 à l’instigation de sa protectrice la Dauphine Marie-Antoinette et soutenu par Antoine Dauvergne qui était alors l’un des Directeurs de l’Académie Royale de Musique, le chevalier Glück était venu en France avec le grand dessein de renouveler le genre de la tragédie lyrique française. Il travaillait depuis le début de l’année sur son Iphigénie en Aulide, dont le livret avait été composé pour la circonstance par le bailli Du Roullet. Celle-ci fut représentée le 19 avril 1774 en présence d’une partie de la famille royale. Elle connut un succès immédiat, bien que certains spectateurs déplorassent l’absence de décors grandioses et de « machines », ainsi que la brièveté des airs de ballets. Le sourcilleux Rousseau reconnut lui-même qu’on pouvait « faire de bonne musique étrangère sur des paroles françaises », mettant ainsi un point final aux spéculations de la Querelle des Bouffons – rapporté par Benoît Dratwicki in Antoine Dauvergne, une carrière tourmentée dans la France musicale des Lumières. Capitalisant sur ce premier succès, Glück livra dès le mois d’août suivant l’adaptation française d’Orfeo e Eurydice (créé en 1762). Cinq ans plus tard, à l’instigation de l’audacieux Devisme (alors à la tête de l’Académie), l’Iphigénie en Tauride affrontait la production concurrente et éponyme de Piccini, qu’elle écrasa de son succès. La carrière parisienne du chevalier allait toutefois bientôt s’achever sur le cuisant échec de son Echo et Narcisse, créé la même année à l’Académie. Les deux épisodes de l’existence de la fille des Atrides marquent ainsi le début et la fin du passage de Glück à Paris. Ils permettent aussi de mesurer la maturation de son génie lyrique : d’une pièce à l’autre le drame se resserre autour de quelques personnages-clés, et l’atmosphère musicale se tend par degrés progressifs jusqu’à l’heureux et bref dénouement final. L’efficacité dramatique augmente aussi considérablement, puisque les échanges entre Oreste et Pylade sont infiniment plus poignants que les protestations de fidélité d’Achille à Iphigénie ou que les tergiversations d’Agamemnon. Mais on retrouve dans les deux pièces la description minutieuse des sentiments contraires qui animent les personnages, dans leur complexité psychologique, et leur lutte difficile contre d’implacables commandements divins. Dans le contexte des Lumières, ce combat résonne comme celui de la « loi naturelle » contre les obscurantismes religieux de toute nature.
© Opus Arte
Iphigénie en Aulide
Tirer un bon parti d’une scène centrale est toujours un exercice difficile, dont Pierre Audi s’acquitte ici avec intelligence : l’action s’y conccentre, tandis que les deux escaliers métalliques adjacents accueillent les arrivées des solistes et les processions des ensembles. Côté costumes, un riche tissu bariolé aux dominantes sombres, façon léopard, mais fortement relevé d’un jaune qui évoque l’or, compose de royales tenues à Agamemnon (avec une traîne de sacre et rehaussé de la couronne qui marque son rang), Clytemnestre (en robe à panier) et Iphigénie (dans un habit plus modeste, qui sied à la jeune fille qu’elle incarne). Diane est affublée d’une manche en forme d’aile d’oiseau, qui évoque les animaux dont elle est la protectrice ; Arcas apparaît en guerrier à demi-nu lors de l’ouverture pour recueillir une colombe blessée, présage aux aventures de la frêle Iphigénie, à deux doigts d’être broyée par le destin.
La puissance de l’orchestre se développe magnifiquement dès l’ouverture, avec des percussions bien maîtrisées. Elle portera avec fougue les rebondissements de l’intrigue, nous réservant aussi de beaux moments attendris, comme les duos d’Iphigénie avec sa mère puis avec Achille au premier acte, les hésitations d’Agamemnon au second ou les émouvants adieux d’Iphigénie au troisième. La marche nuptiale du second acte est particulièrement réussie. L’inspiration du maestro Minkowski excelle à nous rendre les contrastes sans toutefois exagérer les nuances, avec un sens de la rigueur musicale qui, loin d’être pesant, donne à chaque page la plénitude de ses effets sans avoir besoin « d’en rajouter » : la perfection musicale n’est pas très loin…
Véronique Gens incarne avec sensibilité une Iphigénie juvénile ballotée par le destin. Ses reproches à un Achille dont son père lui a dénoncé la prétendue infidélité sont touchants (« Parjure, tu m’oses trahir »), pleins de sensibilité (« Iphigénie hélas vous a trop fait connaître ») ; ils se dissipent bientôt dans l’émouvant duo (« Ne doutez jamais de ma flamme/ Vous le bannissez de mon âme ») qui clôt l’acte I. Comment rester insensible devant la fébrilité qui l’étreint avant les fiançailles (« Par la crainte et par l’espoir ») et se répand en beaux aigus déchirants ? Résignée avec douceur devant le sacrifice (« Il faut de mon destin »), ses adieux à sa mère (« Adieu, vivez pour Oreste ») en deviennent bouleversants.
De son côté Anne-Sofie von Otter se montre tout d’abord une Clytemnestre empreinte de dignité face à l’infortune de sa fille (« Armez-vous d’un noble courage »), à laquelle le timbre mat de sa voix altière donne toute sa majesté. Mais devant la cruauté injuste du sort qui menace sa progéniture, elle dévoile sans peine son amour maternel et sa sensibilité (« Par un père cruel »). Retrouvant force et dignité au troisième acte, elle lance fièrement ses imprécations contre son royal époux (« Non je ne souffrirai pas »). Ce répertoire semble convenir comme un gant à la grande dame qui triompha jadis dans les fulgurances d’Ariodante, sous la baguette du même Minkowski, et nous régale ici d’un phrasé irréprochable et d’une diction sans accent.
Face à elle, l’Agamemnon de Nicolas Testé balance longuement entre révolte face à un commandement inique (« Peuvent-ils ordonner »), épanchement de l’amour paternel (« O toi l’objet le plus aimable ») et affrontement avec son futur gendre (« De votre audace téméraire », prélude à une violente confrontation vocale). A ses côtés dans le rôle de Calchas, Christian Helmer incarne avec force l’oracle intransigeant, arc-bouté sur la volonté divine qui se joue des destins humains (« Au faîte des grandeurs »).
Avec sa voix chaleureuse aux reflets chatoyants, son physique avantageux de jeune premier, Frédéric Antoun apporte charme et sensibilité dans ce monde de noirceur. On comprend que la belle Iphigénie se rende à ses explications (« Cruelle, non jamais ») puis tombe sous son charme (« L’hymen qui sous ses lois l’enchaîne ») alors qu’elle le connaît à peine. Mais il sait aussi faire montre de sa détermination, d’abord pour affronter Agamemnon puis pour sauver sa bien-aimée à n’importe quel prix (« Calchas, d’un trait mortel percé »). Son timbre ensoleillé relève efficacement les beaux ensembles, du quatuor « Jamais à tes autels » (deuxième acte) au quatuor final,en passant par le beau trio « C’est mon père Seigneur ».
Dans le rôle de Diane, la courte apparition de Salomé Haller au final accorde sa grâce à Iphigénie (« Votre zèle des Dieux ») avec une diction précise empreinte de la solennité de son rôle divin.
Les chœurs du Nederlandse Opera sont puissants et homogènes ; ils traduisent très efficacement l’atmosphère de la pièce, qu’il s’agisse de la scène nuptiale, du prélude au sacrifice (« Non, non, nous ne souffrirons pas ») ou du final.
Iphigénie en Tauride
La mise en scène de Pierre Audi montre pleinement son efficacité, avec une grande économie de moyens. Des tenues immaculées « à l’antique » pour les jeunes prêtresses, plus contemporaines pour Iphigénie et Diane, de même que pour Oreste et Pylade, émigrants appréhendés dès l’ouverture par une troupe de paramilitaires en armes dirigée par un Thoas au crâne rasé et en habit militaire (au visage dissimulé derrière des Ray-Ban !) cultivent habilement l’ambigüité entre drame antique et actualité contemporaine. Le texte du livret étant suffisamment explicite à cet égard, l’amour qui lie Pylade et Oreste est traité avec raison de manière très sobre : quelques gestes de tendresse qui précèdent la séparation du second acte, des effusions viriles lorsqu’il faut décider qui subira le sacrifice (au troisième acte). Le jeu des clairs-obscurs de l’éclairage souligne à propos les différentes phases de l’action.
Côté orchestre Marc Minkowski imprime dès les premières notes de l’ouverture une direction impérieuse, précise et ardente, relayée par des percussions saisissantes, qui illustrent pleinement la dimension dramatique. Côté interprètes le plateau s’avère d’un niveau élevé remarquablement homogène. Mireille Delunsch campe une Iphigénie ayant pris de la maturité par rapport au précédent épisode, avec un timbre logiquement un peu plus mat que celui de Véronique Gens. Elle traverse avec dignité ses différentes épreuves : le récit presqu’halluciné (« Cette nuit j’ai revu ») qui se prolonge dans la délicate supplique à Diane (« O toi qui prolongeas mes jours »), le désespoir cristallin du « O malheureuse Iphigénie » – véritable moment de grâce vocale, la prière agitée « Je t’implore ô déesse », et enfin la joie fraternelle du « Ah laissons-là ce souvenir funeste » qui éclate devant un Thoas épouvanté. Face à elle, la Diane de Salomé Haller fait montre d’une bonne projection et d’une diction sensible pour lancer son commandement avant le final (« Arrêtez ! Ecoutez mes décrets éternels »).
Jean-François Lapointe (Oreste) et Yann Beuron (Pylade) forment un tandem tout à fait équilibré au plan vocal comme au plan dramatique. Tous deux dotés d’un timbre bien charpenté et à la projection affirmée, ils dégagent une poignante émotion lors du duo du second acte (« Quel silence effrayant/ Dieux à quelles horreurs »), tandis que celui du troisième acte (« Que me demandes-tu ?/ J’implore ta pitié ») est tout simplement bouleversant, après un trio fort réussi avec Iphigénie (« Je pourrais du tyran »). Relevons tout spécialement chez Yann Beuron le phrasé élégiaque qui anime l’air « Unis dès la plus tendre enfance », et la détermination dans l’air final du troisième acte « Divinité des grandes âmes ». De Jean-François Lapointe on retiendra tout particulièrement les imprécations du « Dieux qui me poursuivez » qui dominent sans peine les sonorités puissantes de l’orchestre, et le sens des contrastes dans les lamentations du « Dieux protecteur de ces affreux rivages » proférées au milieu des ombres inquiétantes des Euménides qui l’encerclent. Son expressivité vocale ne se dément pas dans les moments plus apaisés du quatrième acte, qu’il s’agisse du « Que ces regrets touchants », ou de l’extatique « Partage mon bonheur ! ». Laurent Alvaro incarne de son côté un Thoas brutal et assoiffé de sang, à la forte expressivité théâtrale, déployant une projection sans faille dans son grand air « De noirs pressentiments ».
Les chœurs du Nederlandse Opera ne sont pas en reste, qu’il s’agisse des parties strictement féminines (« Patrie infortunée », le magnifique « Chaste fille de Latone »), des parties masculines (martial « Les Dieux apaisent leur courroux »), ou encore des parties mixtes. Enfin l’orchestre anime sans peine les nombreux passages instrumentaux, qui mettent pleinement en valeur sa profonde unité.
Le coffret qui accueille les deux DVD comprend une notice musicologique de Klaus Bertisch en français, anglais et allemand, ainsi qu’une courte synopsis de l’intrigue de chaque pièce. Les paroles ne sont pas transcrites, mais les sous-titres sont disponibles en français, anglais, allemand, néerlandais et…coréen ! Au total cet enregistrement s’impose sans réserve comme version de référence de ces chefs d’œuvre du Chevalier Glück, tant sur le plan musical qu’au plan scénographique.
Bruno Maury
Technique : captation sonore d’un excellent niveau pour une représentation publique ; plans vidéo habilement choisis.