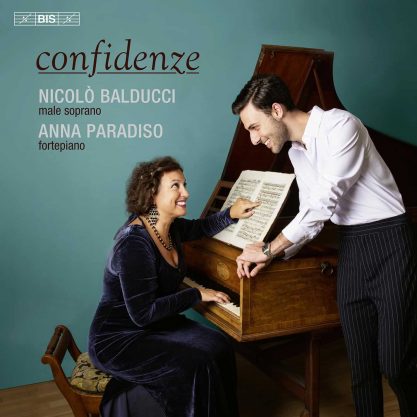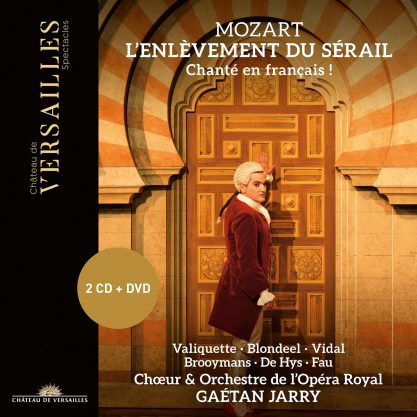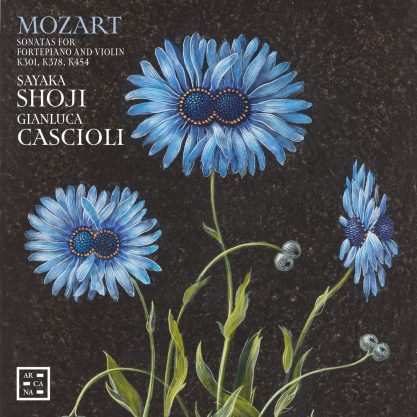“Prépare-moi bien proprement ton joli nid chéri, car mon petit bonhomme le mérite”
(Lettre de Mozart à Constance, 23 mai 1789)

Jean-François PHELIZON
Wolfgang Amadeus Mozart
Deux volumes brochés, tome I, 1756-1781, tome II, 1781-1791, E&N (co-édition EUROP&ART Editions et Editions Nuvis, Paris & Malakoff), 2024, 654 et 736 pages, 58 euros les deux tomes.
Jean-François Phelizon, “mélomane et audiophile depuis toujours”, esprit curieux qui a rédigé des ouvrages de stratégie d’entreprise, sur l’art de la guerre ou encore les cyberstructures, nous livre ici une immense somme de 1385 pages sur Mozart. L’apparence est sobre, la couverture muette, les illustrations de piètre qualité et de petit format. Soit deux pavés brochés gros et gris. Le quatrième de couverture dément cette apparence de rigueur universitaire un peu plombante, le communiqué de presse livrant une sorte de note d’intention de l’auteur :
“Redécouvrir Mozart, via le parcours remarquable de l’homme se cachant derrière l’un des plus grands génies musicaux de l’Histoire !… S’appuyant sur un travail historique poussé et avec une rigueur exemplaire, Jean-François Phelizon plonge ses lecteurs dans la réalité qui a façonné la destinée de Mozart, loin des idées reçues et des mythes construits au fil du temps. Imposants de prime abord, les deux tomes de son récit, composés comme un véritable roman, auront tôt fait d’embarquer et d’envoûter le lecteur, quel que soit son profil, grâce à un style direct, vivant, parsemé d’une multiplicité d’anecdotes.”
L’entreprise est considérable, et son objet a tant été scruté, analysé et commenté qu’on sent à quel point sa genèse fut difficile, en dépit d’un style d’une aimable fluidité. Raconter la vie de Mozart, en très grande partie en se fondant sur sa correspondance, agrémentée de transition de l’auteur, liant les pointillés, et laissant transparaître sa constante admiration pour Wolfgang Amadeus, qui explique aussi le paradoxe de cette biographie à la fois très détaillée, mais qui se veut avant tout un travail de vulgarisation à l’attention du grand public.
Hélas, l’ouvrage souffre des contradictions entre rigueur historique et sélectivité romanesque qui parsèment les deux volumes. Cette tension vire à l’éloge indiscriminé du Divin Mozart. Car derrière la “redécouverte” revendiquée, et la résolution d’une prétendue “énigme Mozart”, cette nouvelle biographie, chronologique et principalement historique (les amateurs d’analyses musicales passeront leur chemin) constitue avant tout une énorme somme narrative, très inégale, parfois extraordinairement détaillée presque jour après jour (la correspondance des Mozart le permet), parfois plus elliptique voire hasardeuse dans ses théories personnelles. La bibliographie pléthorique commentée alterne ouvrages de référence qui font autorité (l’irremplaçable Mozart de Jean et Brigitte Massin chez Fayard notamment), monographies de moindre importance voire fantaisistes, anecdotiques ou obsolètes.
On s’étonne ainsi qu’une bibliographie commentée ne soit pas plus critique. Et c’est là que le bât blesse, non universitaire (loin de nous l’idée de lui jeter la pierre), ni écrivain revendiquant une œuvre littéraire ou un essai, l’auteur semble n’avoir pas rédigé son ouvrage sur la base des sources primaires, mais paraît se contenter d’une compilation orientée, celle d’un Mozart travailleur, fidèle mais débordé, musicien accompli dès ses plus vertes années, sage dans sa vie privée aseptisée, religieux, vivant par et pour la musique, sous-estimant les aspects économiques, sociaux ou son implication maçonnique (pp. 789 et suivantes). Un Mozart composant une “ode à l’égalité” répondant à l’ “envie d’égalité qu’il a chevillée au cœur” (p.859).

Portrait de Mozart par Joseph Lange, 1782. Selon Constance Mozart, le portrait le plus ressemblant de son époux, conservé au Mozart Museum de Salzbourg – Source : Wikimedia Commons
Ce Mozart hagiographique ne résiste cependant pas à une analyse plus complexe, qui, sans nier son génie musical, l’inscrirait à la fois davantage dans la filiation de l’école classique (pp.63 et suivantes assez faiblardes, empilant les noms de contemporains). L’histoire culturelle est habilement retranscrite, à travers les différents voyages en terres germaniques, France et Italie mais, pour prendre l’alpha et l’omega opératique, les mélomanes trouveront la création de Mitridate expédiée bien rapidement, et sans même citer les passages clé de Burney sur le fonctionnement du théâtre napolitain, ceux sur la Clemenza di Tito et son relatif insuccès carrément indigents (pp. 1100 et suivantes), revenant aux poncifs d’une œuvre écrite à la va-vite, et au choix du sujet “malhabile” voire “carrément injurieux”, ignorant volontairement que l’excellent livret de Caterino Mazzolà d’après Metastase (et Suétone) avait été mis en musique plus de 40 fois auparavant, sans doute pour excuser l’insuccès des représentations. Aucune mention sur l’arrière-plan politique des négociations entre les États de Bohême et Léopold II autour du servage et de la charge fiscale, ou sur les défis liés au virus révolutionnaire français à l’orée de cette cérémonie de couronnement… Le commentaire de l’œuvre la réduit à un “très belles pages (…) poignant témoignage de l’humanisme de son auteur”, puis cite Podalydès ou Sollers à la rescousse en arguments d’autorité pour sauver la Clémence qui n’en a guère besoin, tant cet ultime opera seria est désormais considéré à la fois comme un retour aux sources, et une œuvre plus audacieuse qu’à première vue, en dépit des contraintes de la commande (superbe complexité du finale du premier acte notamment). Qu’on est loin de la finesse un peu esothérique de Jean-Victor Hocquard (cf. Les Opéras de Mozart aux Belles Lettres) ou des doctes subtilités de l’Avant-Scène ! Cet exemple, pris parmi d’autres, montre le biais de ce livre : défendre le leg mozartien face à des dénigrements qui n’ont plus lieu d’être… Et sur les près de 1400 pages, 5 pages seulement (dont une entière de synopsis en encadré) sont consacrée à cette œuvre majeure qu’est la Clémence, tandis que Jean-François Phelizon n’hésite pas à se délecter de détails reproduits ad nauseam comme le déguisement de Mozart en arlequin le 9 février 1783 ou divers déboires financiers. Ne soyons pas trop cruels, le mélomane s’est noyé dans ce roman de vie, et sa plume est inégale : la partie autour de la création d’Idomeneo est excellente (pp. 512 et suivante).
En définitive, il s’agit là d’une biographie paradoxale : détaillée, précise, très documentée, presque un almanach, elle n’en est pas moins partielle et partiale, et fait l’impasse ou glisse distraitement sur des œuvres essentielles tout en accordant parfois crédit à des sources plus ou moins douteuses (les témoignages apparus dès 1791, parfois à l’instigation de l’avisée Constance et la complicité du premier biographe Georg Nikolaus von Nissen). En outre, et c’est sans doute le plus grand écueil à nos yeux, les deux tomes s’en tiennent à une approche purement historique, jamais musicale ou musicologique, et l’on apprend souvent davantage sur les œuvres dans les numéros de l’Avant-Scène ou les commentaires originaux trilingues (et différents) de la Mozart Philips Edition, ce qui est tout de même un comble. L’épilogue “interpréter Mozart” est savoureux et s’ouvre sur la problématique suivante : “La musique de Mozart, si lumineuse, si subtile, si pénétrante, est cependant celle dont l’interprétation est la plus sujette à caution. A quoi cela tient-il ?” Hélas, on n’y trouvera rien sur l’évolution des pratiques interprétatives depuis les années 30 à nos jours, et avec le revirement des orchestres sur instruments d’époque, mais plutôt une glose indigeste sur la nécessité de connaître la vie du compositeur pour en saisir le sens tragi-comique :
“Redisons-le : Mozart se désespère et garde espoir en même temps. Il pleure et rit tout ensemble, un peu à la manière d’un enfant. C’est cette humanité-là qu’on peut déceler dans ce qu’il nous a laissé et qu’un interprète mature devrait s’évertuer à nous transmettre. S’imprégner de la vie de Mozart ouvre de fait des horizons insoupçonnés aux musiciens et aux mélomanes qui ne peuvent se passer de sa musique. Et finalement, se rapprocher de lui est une condition sine qua non pour devenir mozartien.
Inversement, ceux des interprètes de Mozart qui ne font pas l’effort de le bien connaître – ou qui s’en éloignent – ont une fâcheuse tendance à jouer ses œuvres de façon artificielle” (p.1226).
CQFD.
Reste un monument-hommage passionné et aisément lisible, dédié à un compositeur plus grand que l’homme et dont l’immense stature, à la manière du spectre du Commandeur, a quelque peu paralysé son auteur, trop fervent mozartien. Terminons enfin ce compte-rendu en signalant qu’outre des encadrés bienvenus, l’ouvrage comporte une chronologie, la bibliographie commentée précitée, un index des personnes, un index des quelques 196 illustrations (des vignettes en noir et blanc). “M’ingannerai di nuovo. In mezzo all’opera, ricorderai…” s’exclame Vitallia à Sesto dans la Clemenza (I,9). L’amour rend bel et bien aveugle.
Viet-Linh Nguyen
Étiquettes : biographie, éditions Europ&Art, éditions Nuvis, Mozart, Phelizon Jean-François Dernière modification: 29 septembre 2025