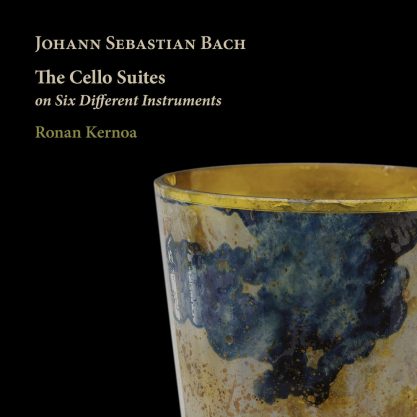Cloître de l’Abbaye d’Ambronay © PDH / Muse Baroque, septembre 2025
Comme une envie d’évasion ! Une incitation au départ et à la découverte de contrées inconnues. Pour sa quarante-sixième édition le Festival de l’abbaye d’Ambronay se pare d’un titre, Nouvelles échappées, qui loin de l’injonction à la vie monacale nous pousse vers l’exploration ô combien enchanteresse, de quelques pans méconnus de la musique, ou à la revisite de classiques, magnifiés, revigorés sommes-nous tentés d’écrire, par les ensembles musicaux les plus prometteurs du moment. Car s’il est bien une constante du Festival d’Ambronay, qui cette année se concentre, se densifie sur trois week-ends au lieu de quatre précédemment, contraintes budgétaires du champ culturel oblige, c’est bien de réussir cet alliage subtil entre mise en avant d’ensembles émergents et mise en exergue d’ensembles confirmés, qui à Ambronay portent le vent d’une musique baroque jamais figée, mais au contraire curieuse, avide de découvertes et de relectures. Passe, passe le temps, il n’y en a plus pour très longtemps…au risque de démentir Georges Moustaki, il n’est jamais trop tard et si la figure immuable du cloître de l’abbatiale semble narguer l’éphémère existence de ses visiteurs, se rendre à Ambronay reste le moyen le plus sur de palper, de percevoir éditions après éditions, les évolutions d’une musique ancienne qui n’en finit plus de dévoiler sa modernité.
Et comme en ce deuxième week-end de festival l’été se prolonge sur les coteaux du Bugey, rendant l’atmosphère particulièrement agréable, ne boudons pas notre plaisir à l’entame de ce deuxième round de l’édition 2025, qui vit le week-end précédent les voutes de l’abbaye résonner des sonorités extatiques d’Alessandro Scarlatti, pour un Te Deum récemment redécouvert et dirigé par Giulio Prandi à la tête du Coro e Orchestra Ghislieri (concert d’ouverture du Festival du vendredi 12 septembre), puis de celles de son Stabat Mater par Guillaume Haldenwang & l’Ensemble La Palatine. Un Stabat Mater de Alessandro Scarlatti qualifié de sublime poème de la douleur par Vincenzo Bellini et dont l’écho dû aimablement se marier avec l’autre grand moment de ce premier week-end, l’interprétation de la classique Messe en Si de Jean-Sébastien Bach par le chœur Vox Luminis et le Freiburger Barockorchester sous la direction de Lionel Meunier.
Mais à l’heure où les coursives de l’abbaye bruissent encore du souvenir ému de ce premier week-end, délaissons-en l’évocation d’autant plus mélancolique que nous n’y étions pas, pour nous plonger dans ce second week-end de Festival dont l’aura s’avère riche en promesses.

Sébastien Daucé © Bertrand Pichène / Festival d’Ambronay
Jean Sébastien BACH (1685-1750)
Cantates de jeunesse
Cantate BWV 131 “Aus der Tiefe ruf’ich Herr zu dir”
Cantate BWV 106 “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit”
Cantate BWV 4 “Christ lag in Todesbanden”
Caroline Weynants, soprano,
Blandine De Sansal, alto,
Florian Sievers, ténor,
Lysandre Châlon, basse
Ensemble Correspondances :
Ripénistes :
Sopranos : Maud Haering, Caroline Dangin Bardot, Ji Yoon
Altos : Marie Pouchelon, Lewis Hammond
Ténors : Antonin Alloncle, Randol Rodriguez
Basses : Réné Ramos Premier, Paul-Louis Barlet
Orchestre :
Violons : Simon Pierre, Paul Monteiro
Flûtes : Lucile Perret, Matthieu Bertaud
Violoncelle : François Gallon
Viole de gambe : Mathilde Vialle, Mathias Ferré
Violone : Etienne Floutier
Théorbe : Simon Linné
Hautbois : Johanne Maître
Basson : Mélanie Flahaut
Orgue : Mathieu Valfré
Direction Sébastien Daucé
Abbatiale d’Ambronay, vendredi 19 septembre 2025
 La direction d’ensemble et de chœur peut-elle se lire comme une chorégraphie ? Nous sommes plus que tentés de répondre par l’affirmative tant celle de Sébastien Daucé comporte aussi une dimension physique, gestuelle, quasi charnelle. Sébastien Daucé semble faire corps avec son chœur et ses musiciens, embrasser l’œuvre, et si cet aspect nous avait déjà frappé lors de précédentes représentations (à l’exemple du programme, essentiellement composé de motets, présenté au Festival d’Hardelot en 2023, ou plus récemment dans sa direction au TCE en 2024 du David & Jonathas de Charpentier), il n’en est que plus saillant dans le concert de ce soir.
La direction d’ensemble et de chœur peut-elle se lire comme une chorégraphie ? Nous sommes plus que tentés de répondre par l’affirmative tant celle de Sébastien Daucé comporte aussi une dimension physique, gestuelle, quasi charnelle. Sébastien Daucé semble faire corps avec son chœur et ses musiciens, embrasser l’œuvre, et si cet aspect nous avait déjà frappé lors de précédentes représentations (à l’exemple du programme, essentiellement composé de motets, présenté au Festival d’Hardelot en 2023, ou plus récemment dans sa direction au TCE en 2024 du David & Jonathas de Charpentier), il n’en est que plus saillant dans le concert de ce soir.
Modernité de l’approche écrivions-nous en début d’article. Incongru, déplacé, irrévérencieux aurait paru il y a encore de cela quelques années le choix de Sébastien Daucé de se présenter face au public sans veste, chemise blanche sans nœud ni cravate, manches relevées. Il y a dans la direction de Sébastien Daucé une apparente décontraction qui n’a d’égale que la concentration de tous les instants dont le chef fait preuve. Oui, osons le dire, un concert de Sébastien Daucé peut aussi se voir comme une chorégraphie et garderait de l’intérêt dans le silence le plus total. Le geste est ample, précis, enveloppant symboliquement d’un bras ferme les choristes, soutenant les musiciens. Précision du regard, attention à chaque individualité de l’ensemble, la direction de Sébastien Daucé, ni feinte d’une inutilité polie par les répétitions, ni empreinte d’un autoritarisme interprétatif hiérarchique, touche aussi par la symbiose, la synergie palpable entre le chef et son ensemble. Musiciens et voix du chœur évoluent, se mettent en avant ou en retrait avec discrétion et élégance au gré des besoins. Oui, avec Sébastien Daucé, Jean-Sébastien Bach prend des airs de ballet et ce n’est pas pour nous déplaire.
Mais cette exécution millimétrée et métronomique serait futile si elle n’était entièrement dévolue à la partition de ces cantates de jeunesse de Jean- Sébastien Bach. L’Ensemble Correspondances, dont nous avons à plusieurs reprises en ces pages loué la qualité d’approche des grandes œuvres chorales du répertoire sacré (chez Henri Du Mont notamment) n’en est pas à son coup d’essai avec ces cantates, déjà données lors de l’édition 2024 du Festival de la Chaise-Dieu ou à la Chapelle Royale de Versailles et qui le seront de nouveau à la Philharmonie de Paris au mois d’avril prochain.
Tout comme Paul Agnew quelques automnes précédents, Sébastien Daucé et l’Ensemble Correspondances s’intéressent dans ce programme à la genèse des cantates de Bach, genre dont nous savons qu’il sera l’un des chantres, et plus particulièrement aux trois œuvres écrites durant le court séjour du compositeur à Mülhausen (Thuringe), où il exerça comme organiste quelques mois entre 1707 et 1708, avant de connaître d’autres engagements et en particulier la plus prolifique période dite « de Weimar ». Trois cantates de jeunesse donc, marquées par l’empreinte de ses grands devanciers (Buxtehude notamment), d’une sobriété luthérienne et caractérisées notamment par l’absence de récitatif, marqueur caractéristique des premières compositions de Bach en la matière, avant ses influences italiennes.
N’épiloguons-pas sur le fait de savoir si la cantate BWV 131 Aus der Tiefe ruf’ich Herr zu dir est ou non la première du genre chez Jean-Sébastien Bach et renvoyons la question à un débat déjà largement évoqué chez Gilles Cantagrel ou dans la discographie abondante de l’œuvre. Cantate pour quatre voix, mixtes (ce qui n’était probablement pas le cas dans les exécutions initiales de l’œuvre), cette œuvre où se révèle déjà la maîtrise d’architecture de Bach s’avère remarquable d’épure, dès la Sinfonia introductive, portée par le hautbois de Johanne Maître, avant que ne s’élève le chœur, ample, homogène et d’une très belle densité, très caractéristique de l’ensemble Correspondances. Si le chœur touche, de par la précision rythmique de ses entrées, la qualité de ses intonations, cette cantate BWV 131 est particulièrement remarquable par les deux passages pour voix solistes de l’œuvre, à commencer par l’arioso pour basse du second mouvement, permettant de goûter au timbre grave, à la diction maîtrisée de Lysandre Châlon qui sublime le So du willst, Herr, Sünde zurechnen.
La fameuse cantate Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (BWV 106) fait également partie des compositions du jeune Bach à Mulhausen et si les circonstances précises de sa commande restent obscures (peut être le service funéraire d’Adolph Strecker, édile de la ville). Sébastien Daucé sait lui conserver son épure originelle, notamment dans la remarquable partie soliste introductive, nimbée des deux flûtes de Lucile Perret et Matthieu Bertaud. La mort apprivoisée, rendue douce et sereine par cette cantate très structurée, mettant en exergue les voix solistes, celle du ténor Florian Sievers (grand habitué du répertoire, notamment sous la direction de Philippe Herreweghe) sur l’arioso Ach, Herr, lehre uns bedenken et peut plus encore la basse de Lysandre Châlon sur l’aria Bestelle dein Haus. La voix claire, toute en tempérance et finement colorée de Blandine de Sansal emporte l’aria In deine Hände befelhl in meinen Geist vers des sommets d’expressivité et d’intériorité parachevant une interprétation en tous points sublime de ce grand classique du répertoire bachien.
Et comme l’équilibre vient souvent de la trilogie, l’Ensemble Correspondance exécute ensuite la cantate Christ lag in Todes Banden (BWV 4). Introduite au contraire de la précédente par une Sinfonia pour cordes, strictement architecturée autour de ses sept mouvements reprenant les textes de Martin Luther, nous soulignerons dans cet autre classique du répertoire les entrées décalées, rapides et parfaitement rythmées des différentes voix du chœur à l’entame du premier verset (Christ lag in Todes Banden), sur un verset dont l’exécution se distingue par la direction enveloppante de Daucé, avant que les parties vocales solistes ne soient l’occasion pour Bach de développer un art consommé de l’alliance voix-instrument, que ce soit dans la ligne de viole (Mathilde Vialle, Mathias Ferré) du Duetto du deuxième verset ou du violon, aussi mélodieux qu’enlevé de l’aria pour chœur du troisième verset. Et si le Hier ist das rechte Osterlamm (verset 5) est une nouvelle fois l’occasion d’apprécier la voix de basse de Lysandre Châlon, nous soulignerons le Duetto du verset 6, So feiern wir das hohe Fest, où les voix de Caroline Weynants (soprane) et Florian Sievers s’allient dans une grâce achevant de faire de l’interprétation de ces trois cantates du jeune Bach un moment de grâce pure, d’intériorité sacrée. Alors oui, Sébastien Daucé, maîtrisant aussi bien son chœur que ses instrumentistes s’impose encore une fois par ce programme avec l’Ensemble Correspondance comme l’un des interprètes actuels majeurs de l’œuvre sacrée de Jean-Sébastien Bach.

Marta Gawlas, Marta Korbel, Ensemble Coahaere © Bertrand Pichène / Festival d’Ambronay
Pierre GAULTIER de Marseille (1642-1696)
Variations Baroques
Suite en G ré sol Bémol, Ouverture, Prélude, Ritournelle, Sarabande, Loure, Rigaudon.
Suite en G ré sol Bémol, Gracieusement, Rigaudon, Gavotte, Menuet I et II
Suite en C sol ut, Prélude, Embarras de Paris, Symphonie, Marche
Suite en C sol ut, Symphonie, Air, Passacaille, Sommeil
Suite en F ut fa, Carillo, Air, Chaconne
Suite en D la ré sol Bémol, Tendresse, Menuet I et II, Rigaudon I et II, Suite des Regrets
Suite en D la ré, Ouverture, sarabande I et II, Bourrée, Fantaisie
Ensemble Coahaere :
Marta Gawlas, flûte
Marta Korbel, violon Giovanni Baptista Rogeri (1699)
Monika Hartmann, violoncelle
Natalia Olczak, clavecin
Faut-il de nos jours passer par la Pologne pour découvrir Marseille ? Il nous faut répondre par l’affirmative, moins pour découvrir la ville que la figure du compositeur Gaultier [ou Gautier] de Marseille (1642-1696), bien peu joué sous nos latitudes (malgré un très excellent disque de Symphonies par Hugo Reyne chez Astrée Auvidis dès 1998, accompagné de Patrick Cohën-Akenine au violon, Vincent Dumestre au théorbe et Elisabeth Joyé au clavecin, excusez du peu !) et venant opportunément rappeler qu’il y eu une musique à Marseille avant…[1]
C’est au cours de leurs études que les quatre jeunes musiciennes d’origine polonaise de l’ensemble Coahaere ont découvert Pierre Gaultier de Marseille et ont commencé à s’intéresser à la musique de ce compositeur pour le moins confidentiel…même s’il se dit que son nom pourrait réapparaître à Ambronay dès le week-end prochain dans le programme concocté par François Lazarevitch et ses Musiciens de Saint-Julien. Un compositeur dont l’itinéraire particulier sonne comme l’une de ces échappées auxquelles invitent cette édition du Festival d’Ambronay. Né, non pas à Marseille, mais non loin, à La Ciotat, il embrasse une carrière de musicien dans un premier temps assez classique (organiste, claveciniste, premier séjour à Paris sous la férule de Jacques Champion de Chambonnières), puis après un retour à La Ciotat, second séjour parisien où il devient l’élève de Lully auprès duquel il fait son apprentissage de l’opéra. Revenu dans le sud du royaume, à Marseille en 1681, il devient avec l’autorisation de Lully producteur d’opéras et contribue à faire connaître le genre dans tout le sud de la France, de Toulon à Montpellier, en passant par Aix, Arles et Avignon.
Lui-même compose deux œuvres, Le Jugement du Soleil et Le Triomphe de la Paix, considérées comme perdues et cela avant de trouver une fin aussi tragique que prématurée, périssant noyé, son navire ayant fait naufrage au large de Sète alors que Pierre Gaultier de Marseille reprenait la mer après des représentations à Montpellier. Un véritable cimetière marin et sétois pour le compositeur qui ne laisse à la postérité comme compositions que les Symphonies de feu Mr. Gaultier de Marseille divisées en suite de tons, et publiées par l’incontournable Ballard en 1707[2].
Un corpus dont s’empare l’ensemble Coahaere, pour nous restituer ces pièces dont l’appellation de Symphonies est à prendre dans la première acceptation du terme, à savoir de courtes pièces en plusieurs mouvements où les instruments jouent ensemble, et non dans le sens de composition pour orchestre symphonique et le plus souvent en quatre mouvements.
Des Symphonies de Pierre Gaultier de Marseille le plus souvent brèves, en mouvements courts et typés d’où se dégagent les principales caractéristiques du compositeur, à la fois un agréable penchant pour l’intériorité, la profondeur des sentiments, comme sur la sarabande de la première suite ou encore dans le Sommeil de la suite en ut bémol. Pierre Gaultier de Marseille exprime souvent avec ses compositions une forme certaine de mélancolie et ses mouvements les plus lents en deviennent à la fois les plus beaux et les plus avant-gardistes sur la musique de son époque. Ses mouvements plus rapides, d’une structure de composition assez conventionnelle sont agréables sans détoner dans la production musicale de son époque, même si l’on appréciera une belle marche en final de la première Suite en ut, ou une passacaille enivrante dans la Suite en ut Bémol. Mais là où l’on ira chercher un autre marqueur du style de Pierre Gaultier de Marseille, c’est bien dans la réinterprétation et l’appropriation de quelques formes musicales puisées dans les traditions provençales à l’exemple de l’usage du Rigaudon, danse provençale populaire du temps du compositeur, particulièrement dans l’arrière-pays, jusqu’à la vallée de la Durance. Si Pierre Gaultier de Marseille développe les thèmes de danses habituels de la musique de cette époque (gavotte, menuet, passacaille, chaconne etc.) la présence de parfois deux Rigaudons dans la même suite constitue un élément marqueur de son style, même si cette forme se retrouve aussi chez d’autres de ses contemporains, et bien plus nordistes compositeurs, Rameau comme Lully, Campra ou encore dans le David & Jonathas de Charpentier (acte IV).
Les quatre jeunes musiciennes de l’ensemble Coahaere et dont la formation émergente est soutenue par le programme des Jeunes Talents d’Ambronay s’emparent des partitions de Pierre Gaultier de Marseille avec conviction. Si l’on regrettera un jeu manquant encore parfois de souplesse et de fluidité (au violon et au clavecin notamment, qui apparaissent par moments apprêtés, alors que les Ombres ou les Timbres auraient fait merveille) on mentionnera le violoncelle joliment affirmé de Monika Hartmann et la flûte enjouée et légère de Marta Gawlas lors de ce concert que Coahaere nous invite à prolonger avec la parution de son premier enregistrement, tout entier dévolu à ce compositeur et paraissant chez Ambronay Editions (compte-rendu à retrouver prochainement dans nos pages).
A suivre,
Pierre-Damien HOUVILLE
[1] …Fernandel…ou Jul…à vous de choisir !
[2] Soulignons toutefois une probable postérité picturale. Dans le tableau sobrement intitulé Réunion de Musiciens de François Puget (1651-1707), il est fort probable que le théorbiste soit Pierre Gaultier.
Étiquettes : Ambronay, Châlon Lysandre, Daucé Sébastien, De Sansal Blandine, Ensemble Coahaere, Ensemble Correspondances, festival, Gaultier de Marseille, Jean-Sébastien Bach, Pierre Gaultier de Marseille, Pierre-Damien Houville, Sievers Florian, Weynants Caroline Dernière modification: 5 octobre 2025