E la nave va

© Muse Baroque
Francesco CAVALLI
Pompeo Magno
dramma per musica en trois actes sur un livret de Nicolò Minato créé au Teatro San Salvatore de Venise le 20 février 1666
Pompeo : Max Emanuel Cenčić
Issicratea : Mariana Flores
Mitridate : Valerio Contaldo
Sesto / Principe cavaliero : Logan Lopez Gonzalez
Farnace / Amor : Aloïs Mühlbacher
Harpalia / Genio di Pompeo : Kacper Szelążek
Cesare / Principe cavaliero : Victor Sicard
Claudio / Principe cavaliero : Nicholas Scott
Giulia : Lucía Martín-Cartón
Servilio / Principe cavaliero : Valer Barna Sabadus
Crasso : Jorge Navarro Colorado
Atrea : Marcel Beekman
Delfo : Dominique Visse
Cappella Mediterranea
Leonardo García-Alarcón, direction
Version de concert (mise en espace), Théâtre des Champs-Elysées, mercredi 1er octobre 2025
Décidément, Leonardo García-Alarcón est omniprésent. Après Ambronay, le voici ce rare Pompeo Magno, tout droit venu du Bayreuth Baroque Festival, avec le même plateau vocal, à l’exception de Sesto et Giulia. Certes, la mise en scène de Max-Emmanuel Cenčić lui-même, n’est plus au rendez-vous lors de cette tournée européenne (Genève, Paris et Vienne), mais ce n’est pas non plus une aride version de concert que nous livre le chef : point de partitions, des déplacements constants, une scène ornée de bougies, quelques accessoires indispensables (deux épées), des interventions spatialisées depuis les balcons ou la salle. Cette version mise en espace, d’une rare fluidité, d’une intelligence dramatique intacte, permet heureusement de s’immerger dans des marivaudages passablement compliqués, où retournements et travestissements abondent. Mais commençons par la fin : 1666, c’est le dernier opéra que Cavalli fera représenté de son vivant. Le manuscrit est conservé à la Biblioteca Marciana de Venise dans la Collection Contarini, mais il est lacunaire, ce qui permet au chef de compléter l’oeuvre avec le foisonnement et l’extravagance qu’on lui connaît. Car si ce concert n’est pas une première mondiale (dès 1975 Denis Stevens avait interprété l’oeuvre avec Paul Esswood en Pompée, ce dernier dirigeant en 2022 une version au Varazdin Baroque Evenings Festival en Croatie), il s’agit de la première résurrection convaincante, disposant de l’orchestre historiquement informé et des chanteurs adéquats. Voici une oeuvre qui renoue avec les ruptures de tons et de styles chers au théâtre vénitien : la pompe romaine héroïque se mêle rapidement aux saveurs populaires de la commedia dell’arte. Entre les deux pôles, Leonardo García-Alarcón a choisi d’accentuer clairement l’aspect burlesque et ironique, ce sont moins les marbres du Sénat que les tréteaux de la foire qui l’intéressent, et c’est une version passablement remaniée (manquent les chœurs et les ballets – que Cavalli emprunta au style français après son Ercole Amante – sans compter les nombreux inserts et adaptations par le chef) concoctée avec facétie et jubilation qu’il nous a été donné de goûter.
Leonardo García-Alarcón dirige sa Cappella Mediterranea avec la spontanéité multicolore qu’on lui connaît : le geste est généreux, les débordements fréquents, les ornements et l’inspiration surabondants. L’orchestre se révèle luxuriant et varié, avec dans l’élan de nombreuses entorses à l’historicité : cymbales, flûte à coulisse, onomatopées, rythmes de danses modernes, percussions aussi changeantes qu’insistantes, continuo en armée mexicaine (archiluths, violes de gambe, violoncelle, deux clavecins, un orgue…) sans compter des effectifs pléthoriques (dont deux superbes cornets et sacqueboutes, ces dernières jouant parfois en imitant des trompettes). Cette orgie sonore, hédoniste et désinhibée, confère une grande séduction à l’oreille, une énergie revigorante de tous les instants. Elle est cohérente avec le parti-pris de considérer le livret avec la malice d’un second degré contemporain, sans prendre le moins du monde au sérieux le destin tragique ou héroïque des personnages, notamment les grandes figures historiques de Mithridate incognito, de Pompée, de César, du fils de Mitridate Farnace pris en affection par Pompée, ce qui hélas dessert certaines scènes dont l’intensité dramatique aurait pu se hisser au niveau de celle d’un Giasone, ou d’une Didone du même compositeur. Les rôles travestis comiques sont excellemment rendus, de même que la double intrigue amoureuse (le triangle Pompée / Servilio / Giulia ; le quatuor Mitridate / son épouse Issicratea / ses prétendants Sesto et Claudio). On ne tâchera pas ici de résumer l’intrigue bouillonnante, renvoyant les lecteurs au synopsis du programme de salle du TCE.
Si le verbe – pourtant si expressif chez Cavalli – se dissout dans la mer chatoyante de l’orchestre, la beauté sonore et le sens du spectacle dissipent nos regrets d’une lecture plus intime, à la sobriété plus théâtrale. Place à la commedia dell’arte, et avec panache ! Le chef argentin, poète du souffle et du rythme, fait de l’excès une esthétique. Sa direction boulimique, souple et exaltée, confère à la partition une vitalité irrésistible. Leonardo García-Alarcón assume la chair, la matière et la flamboyance. Alors, oui, la gravité politique est absente (César et Claude tout à fait ridiculisés, le premier dans sa cape de pacotille, le second surjouant l’idiot bossu libidineux de service), la folie burlesque, presque fellinienne emportant tout sur son passage. Cavalli, fidèle à la veine vénitienne, entremêlait les registres : les héros versent des larmes, les fous dansent autour des cadavres. Ici on rit beaucoup : Marcel Beekman, incroyable Atrea visionnaire, tente de pêcher des étoiles à la main, tandis que Dominique Visse, génial Delfo au timbre un peu fatigué, transforme chaque réplique en aphorisme surréaliste. Leur duo, parfaitement réglé, électrise la salle.

Max-Emanuel Cencic © Laura Chapman, 2024
Mais revenons au rôle-titre pour saluer le charisme souverain de Max Emanuel Cenčić en Pompeo. À la fois producteur, metteur en scène et interprète, le contre-ténor orchestre son propre triomphe avec une élégance consommée et une retenue vocale surprenante (contredisant sa mise en scène survoltée). Son timbre soyeux, d’une densité ambrée, épouse le rôle avec une douceur et une sensibilité désarmante, faisant de Pompée un aristocrate bienveillant, et un militaire bien rêveur. Le cantabile se déploie comme un ruban de velours, et l’acteur cisèle chaque geste, qu’il s’agisse du doux abandon de l’air du sommeil ou du conflit intérieur entre le Génie et l’Amour, d’une rare intensité. En Issicratea, femme de Mitridate présumé mort, Mariana Flores impose son expérience cavallienne par un chant aussi mobile que sensible : plainte caressante, élégance altière. Certes, par rapport à ses enregistrements (le superbe coffret paru chez Ricaercar), la tessiture paraissait un peu haute pour elle et les aigus étaient parfois contraints, mais la musicienne demeure fascinante par son art de la couleur et du mot.
Valerio Contaldo s’épanouit pleinement dans le rôle de Mitridate, central à l’intrigue et plus riche psychologiquement que celui de Pompée, passant de l’incognito voyageur à l’époux vengeur, au meurtrier d’esclave déloyale, puis au noble monarque acceptant sa condamnation. Son ténor mordant, flexible et expressif, confère à Mitridate une urgence nerveuse, servie par une diction nette et timbre très chaleureux. Le jeune Logan Lopez Gonzalez, en Sesto, déploie une aisance scénique et vocale réjouissante. Le chant, clair et souple, s’illumine dans un Datte senso a questi marmi d’une noblesse inattendue. Seuls quelques forte aventureux viennent troubler cette ligne d’ensemble — amusants dans les scènes bachiques.

Mariana Flores © site officiel de l’artiste
Aloïs Mühlbacher, malgré ou grâce à un timbre juvénile et plat, s’épanouit en Farnace, qui n’en demande pas plus. Avec Kacper Szelążek, Harpalia, furie nymphomane grinçante, toute de stridences maîtrisée, comique à souhait, rejoint Atrea et Delfo dans les rôle bouffons avec gourmandise, trucidée sur scène par Mitridate pour favoriser le passage de l’amant vers les appartements de l’épouse ! L’on passera plus rapidement sur Victor Sicard en César et Jorge Navarro Colorado en Crasso, aux chants fermes et stables, mais aux rôles peu développés. De même, Nicholas Scott campe un Claudio (le futur Empereur) tout en grimaces ridicules, avant de révéler, dans son air de dépit, un raffinement insoupçonné mais bref. La Giulia de Lucía Martín-Cartón séduit par son élégance limpide mais un peu mièvre. Valer Sabadus, fidèle à son sfumato très poétique, laisse planer sur Servilio une aura diaphane que certains pourraient trouver monochrome (à tort). Enfin, pour conclure le chœur des multiples protagonistes, on ne redira pas à quel point Marcel Beekman (Atrea) et Dominique Visse (Delfo) offrent un duo comique d’anthologie plantureux et sonore, acide et farceur. Ensemble, ils incarnent à la perfection la verve grotesque et la jubilation charnelle d’un Cavalli plus bouffe que jamais.
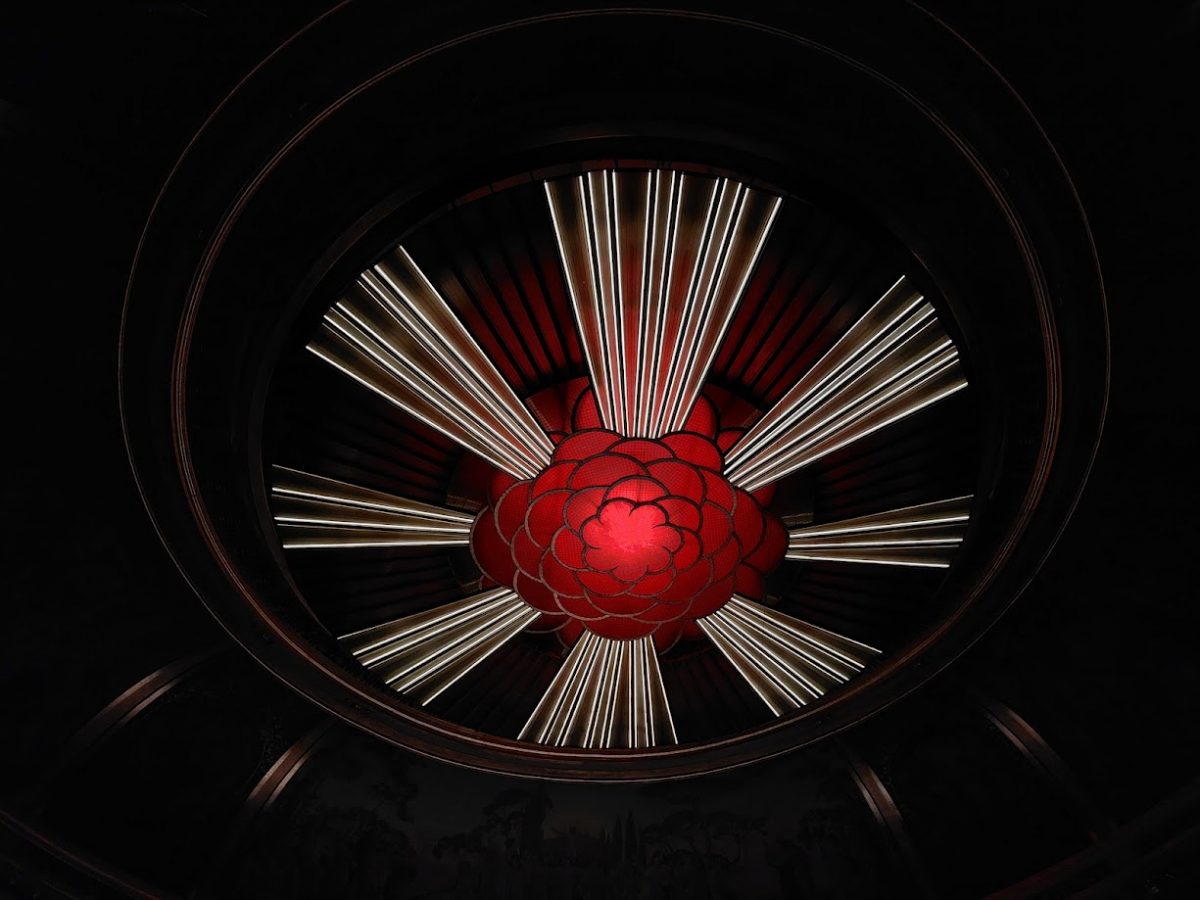
Le nouvel éclairage du lustre du TCE, de toute beauté © Muse Baroque
Redisons-le, la Cappella Mediterranea dirigée avec fougue (et précision), se montre somptueuse : les cordes et les vents tissent des textures d’une richesse éclatante, presque étourdissante, tandis que les percussions — omniprésentes — martèlent le rythme avec un entrain envahissant mais communicatif. Cette profusion sonore tend à noyer la délicatesse des airs plus intimes. Les ensembles, riches et colorés, révèlent néanmoins une virtuosité remarquable offrant un relief théâtral qui, même s’il flirte avec l’excès, rend justice à la flamboyance du baroque vénitien. Bien qu’on aurait aimé plus de contraste, ce mélange de lumière et de rire atteint parfois l’ivresse et insuffle une incroyable explosion dans cette alternance de beauté et de tumulte, de récitatifs enflammés et de percussions où se joue la vérité du baroque : un art de l’excès, mais toujours au service de la vie. Une relecture somptueuse et outrancière.
Viet-Linh Nguyen
Étiquettes : Barna-Sabadus Valer, Beekman Marcel, Cappella Mediterranea, Cencic Max Emanuel, Contaldo Valerio, Flores Mariana, Francesco Cavalli, Garcia-Alarcon Leonardo, Lopez Gonzalez Logan, Mühlbacher Aloïs, Théâtre des Champs-Élysées, Visse Dominique Dernière modification: 6 octobre 2025








