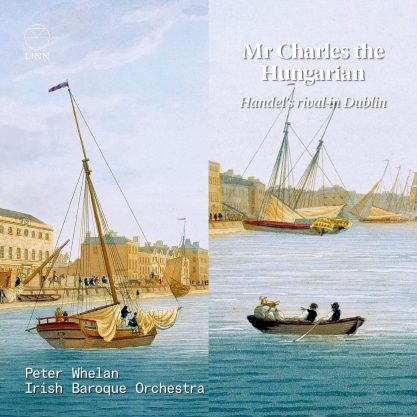© Festival de Saint-Denis / Christophe Fillieule
Georg Friedrich HAENDEL
La Resurrezione
Oratorio sur un livret de Carlo Sigismondo Capece, créé à Rome au palais Bonelli, le dimanche de Pâques 8 avril 1708
Emöke Barath, Maddalena (soprano)
Julie Roset, Angelo (soprano)
Lucile Richardot, Cleofe (mezzo-soprano)
Emiliano Gonzalez-Toro, San Giovanni, (ténor)
Robert Gleadow, Lucifero (baryton-basse)
Le Concert de la Loge,
Direction Julien Chauvin
Mise en espace : Olivier Simonnet
Mise en lumière : Cécile Trelluyer
Basilique de Saint-Denis, jeudi 13 juin 2024, dans le cadre du Festival de Saint-Denis.
 Opera proibita ! L’affirmation d’une interdiction qui nous renvoie au titre de l’album éponyme qu’enregistra, voici de cela maintenant quelques années, Cécilia Bartoli avec Marc Minkowski et les Musiciens du Louvre (Decca, 2005). La soprane apparaissait sur la photo de couverture en Anita fellinienne, auréolée de bleu, pour un disque quasi entièrement consacré à des extraits d’oratorio, dont deux classiques de La Resurrezione de Haendel, le célèbre aria introductif de l’Ange Disserratevi, o porte d’Averno, et le non moins célèbre récitatif de Marie-Madeleine Notte funesta.
Opera proibita ! L’affirmation d’une interdiction qui nous renvoie au titre de l’album éponyme qu’enregistra, voici de cela maintenant quelques années, Cécilia Bartoli avec Marc Minkowski et les Musiciens du Louvre (Decca, 2005). La soprane apparaissait sur la photo de couverture en Anita fellinienne, auréolée de bleu, pour un disque quasi entièrement consacré à des extraits d’oratorio, dont deux classiques de La Resurrezione de Haendel, le célèbre aria introductif de l’Ange Disserratevi, o porte d’Averno, et le non moins célèbre récitatif de Marie-Madeleine Notte funesta.
Un titre comme une provocation venant rappeler qu’au moment où le jeune Georg Friedrich Haendel arrive pour la première fois à Rome, à l’hiver 1707, les représentations d’opéras sont interdites. Le Pape Clément XI et la Curie romaine, arguant que la Sainte Vierge a protégé la ville des dévastateurs tremblement de terre de 1703 (qui ne firent pas de victimes à Rome, mais dont on estime entre 6000 et 10 000 le nombre de morts sur un axe allant de l’Aquila à Amatrice, dans les Abruzzes), interdisent toute représentation pour une durée de cinq ans, plongeant dans une petite mort des représentations lyriques prenant à leurs yeux des libertés touchant à la licence et au blasphème.
Quelques jours à peine après la représentation donnée au Festival de Saint-Michel en Thiérache, pour le second week-end de celui-ci que nous n’avons hélas pu couvrir, c’est dans le cadre cette fois-ci du Festival de Saint-Denis que Julien Chauvin et les musiciens du Concert de la Loge s’emparent de l’œuvre sépulcrale de Haendel pour l’un des concerts les plus attendus d’une programmation comme chaque année marquée par un éclectisme musical permettant à chaque public de trouver représentation à ses oreilles aimable. Et si nous ne fûmes que moyennement séduits par le dernier disque de la formation, principalement consacré à une énième version des Quatre Saisons de Vivaldi (Alpha), fort honorable mais ne renouvelant pas l’approche d’une œuvre gravée jusqu’à l’excès, avouons que sur le papier, la distribution de cette Resurrezione offre de bien belles perspectives, réunissant quelques-unes des voix les plus prometteuses de la scène baroque actuelle.
Haendel, jeune, fougueux et audacieux, absorbe lors de son voyage en Italie les codes et marques stylistiques de la musique italienne, et lorsqu’il arrive à Rome, après un séjour de plusieurs mois à Florence, s’empare de l’interdiction de toute représentation lyrique pour mieux la détourner, adoptant le genre de l’oratorio et un sujet éminemment religieux (par essence, centré autour des évènement bibliques de la fin de la Semaine Sainte), pour en faire une œuvre dévolue à l’expression des sentiments les plus passionnels, les plus intimes, constamment marquée par la ferveur…bref, un opéra biblique, véritable concentré de la virtuosité musicale dont s’avère capable le jeune Haendel, vingt-trois ans au moment de la première représentation de l’œuvre, le dimanche de Pâques 1708, au Palazzo Ruspoli (Francesco Ruspoli, patricien romain, étant le principal soutien du compositeur lors de ce séjour italien).
L’œuvre, dont nous devons le livret à Carlo Sigismondo Capece (1652-1728, poète à la cour de la Reine Marie Casimire de Pologne, à cette époque vivant en exil à Rome, et auteur de quelques livrets ultérieurs pour Caldara ou Domenico Scarlatti) relate les échanges autour de la figure du Christ et de sa Passion entre Marie-Madeleine, Jean l’Evangéliste, Lucifer, un Ange et Marie de Cléophas, l’une des Myrrhophores ayant trouvé vide le tombeau du Christ (les exégètes feront d’ailleurs remarquer que Marie de Cléophas n’est pas citée par Saint-Jean dans son Evangile, avec qui elle converse dans l’œuvre).
Le compositeur concentre son action sur ses personnages, humains ou allégoriques, ne recourant pas, au contraire de nombre de ses œuvres ultérieures, à un quelconque narrateur ou aux chœurs, composant une partition d’une sincérité palpable, resserrée sur un nombre succinct d’acteurs de l’action. Une partition où éclate la maîtrise de composition de Haendel, qui avec le premier aria da capo de l’Ange, le célébrissime Dissarretevi, o porto l’Averno, exprime d’emblée une intensité émotionnelle de son personnage confondante, ancrant cette figure dans le cœur du public. L’Ange, c’est ce soir Julie Roset, allure ancillaire, voix légère et colorée, d’une clarté et d’une projection à même d’emplir les imposantes voutes de la Basilique Royale, qualités vocales remarquables auxquelles s’associent une présence et un jeu contribuant à en faire l’une des jeunes sopranes les plus demandées du moment, elle qui avait déjà collaboré ici même avec le Concert de la Loge sur La Création de Joseph Haydn l’année dernière. Des qualités vocales et de scène dont elle ne se départira pas, faisant du deuxième aria de son personnage, D’amor fu consiglio, aussi enlevé que déterminé, un autre grand moment de cette représentation.
Une figure allégorique de l’Ange dont les sentiments entrent forcément avec le non moins allégorique Lucifer, campé par le baryton-basse Robert Gleadow, plus habitué du répertoire mozartien et du bel canto, mais qui trouve dans ce rôle de Lucifer moyen d’imposer toute la stature de sa voix, lui aussi bien servi par Haendel qui lui offre un premier aria (Caddi, e ver, ma nel cadere) d’une belle force expressive, lui permettant d’arrimer toute la malignité de son personnage face à l’Ange. Une confrontation des points de vue, des sentiments et des espérances qui sont l’une des grandes richesses de cet oratorio, le compositeur soulignant avec virtuosité chaque sentiment. Maddalena, de par la proximité qu’elle eut avec le Christ est la figure biblique majeure de cette œuvre et Emöke Barath lui prête toute la clarté et la sentimentalité de voix qu’on lui connaît, bien sûr dans le si connu Notte, notte funesta, mais peut être plus encore, dans la seconde partie de l’œuvre sur le déchirant et absolument sublime Per me gia di morire.
Nous qui l’avions trouvé un peu en retrait dans le Rinaldo dirigé par Thibault Noally en début d’année au Théâtre des Champs Elysées, concédons que ce soir elle sublime son personnage, rendant cette Maddalena haendélienne d’une confondante sincérité.

Julie Roset © Simon Gosselin
Une expressivité vocale et une sincérité irradiante d’Emöke Barath qui atteint peut-être sa plus grande expression dans les récitatifs en duo qu’elle partage avec Lucile Richardot, au nombre de trois, dont un très harmonieux Ahi dolce moi signore, précédent le duo Dolchi chuodi, amati spine, la voix de la soprane s’alliant à merveille avec la tessiture mezzo-soprano de Lucile Richardot, dont l’assurance et la détermination transpercent dans chacune de ses interventions. Une présence et un caractère affirmés, une voix racée et une appétence pour les projets les plus divers qui expliquent la variété des projets dans lesquels ont la retrouve depuis maintenant quelques saisons (que l’on se souvienne par exemple son rôle parodique dans le Médée & Jason monté par Les Surprises).
Mais cette alliance si bien composée de Cleofe et de Maddalena en servantes éplorées du Christ ne serait que finalement peu de chose sans la présence, souveraine et sage de San Giovanni, compagnon de Jésus, auquel Emiliano Gonzalez-Toro prête une voix posée, chaude, l’accompagnant d’une présence charismatique. Le ténor suisse, que nous avions déjà entendu associé à Emöke Barath pour un Retour d’Ulysse dans sa patrie avec son ensemble Il Gemelli offre quelques moments pleins de majesté, notamment les deux récitatifs qu’il partage avec Maddalena et Cleofe en fin d’œuvre, d’une émouvante sobriété (Cleofe, Giovanni, udite et Si, si col redentere).
La distribution initiale de l’œuvre, non moins prestigieuse, comptait Margherita Durastanti dans le rôle de Maddalena (qui devait par la suite de nombreuses fois collaborer avec Haendel, Agrippina, Radamisto, Arianna in Creta) et Arcangello Corelli au violon et à la direction. C’est ce soir Julien Chauvin qui assume à la fois le rôle de premier violon et la direction du Concert de la Loge, optant pour notre plus grand plaisir pour un accompagnement sobre, sans emphase (modérant une partition qui peut facilement verser vers quelques débordements, versant dans lequel tombent certains chefs), laissant s’exprimer, outre les violons, très présents, les belles lignes de hautbois et de viole de gambe qui font la renommée de cette Resurrezione.
Si vous ajoutez à cela une belle mise en lumière (Cécile Trelluyer et Marc Delamézière) et une mise en espace des chanteurs adéquate et sans fard (Olivier Simonnet), vous obtiendrez une représentation qui tend au sans faute, faisant de cette Resurrezione un pur moment de grâce, de communion entre musiciens et interprètes, emportant avec eux le public de la Basilique de Saint-Denis.
Pierre-Damien HOUVILLE
Étiquettes : Barath Emöke, Gleadow Robert, Gonzalez Toro Emiliano, Haendel, Le Concert de la Loge, Lucile Richardot, Pierre-Damien Houville, Resurrezione, Roset Julie Dernière modification: 21 juin 2024