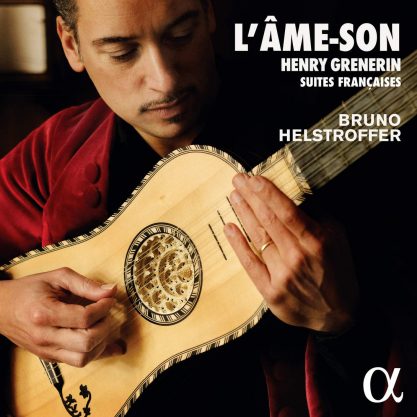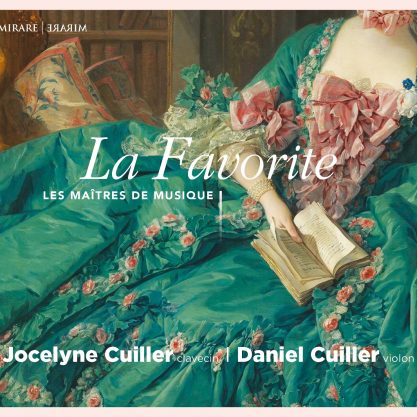« Les zephirs paroissent dans une gloire élevée
et brillante. Les peuples differens qui sont
venus à la feste de Cybele entrent dans le temple,
et tous ensemble s’ efforcent d’ honorer Atys, qui
vient revestu des habits de grand sacrificateur.
Cinq zephirs dançans dans la gloire.
Huit zephirs joüants du haut-bois et des cromornes,
dans la gloire.
Cinq zephirs joüants du haut-bois.
Trois cromornes joüants dans la gloire.
Troupe de peuples differens chantans qui accompagnent
Atys.
Six indiens et six egiptiens dançans.
Six indiens.
Six egiptiens. »
(Philippe Quinault, Atys, Acte II scène 4)
L’art de la mise en scène est un art subtil. Il exige, n’en déplaise aux théoriciens, non une idéologie prête à porter qui n’est qu’une facilité pour l’esprit, mais la capacité à mettre en adéquation ce qu’une écoute sincère, authentique, personnelle de l’œuvre fait naître en nous, et ce qu’on en donne à voir sur une scène.
Il semble cependant que depuis quelques années, la musique baroque et classique se voit régulièrement affublée sur les scènes du monde – et d’Europe en particulier faudrait-il préciser ? – d’un visuel en total décalage avec l’univers esthétique que le public moyen, dont je me réclame, associe implicitement, inconsciemment, automatiquement avec l’œuvre. Dites « Mozart », et voilà l’imaginaire collectif à l’ouvrage, imaginant perruques, dorures et épinettes délicatement aquarellées. Prononcez « Haendel », et voilà les costumes chatoyants, les bougies baignant de leur lumière mordorée de lourds rideaux de velours pourpre, la pluie tombant sur Londres noyé de brume et les amours contrariées de héros tout droit sortis d’estampes illustrant le Tasse ou l’Arioste.

Jean Berain, décors et costumes pour une représentation d’Armide de Lully en 1686 © Theatre Research Institute of Ohio State University
Certes ces vignettes sont fausses, et il suffit de contempler les dessins de Bérain pour saisir toute la recréation contemporaine des talentueux Benjamin Lazar ou Louise Moaty, malgré les bougies, les châssis et une gestuelle conforme aux traités et pratiques de l’époque. Mais l’on sait aussi que des metteurs en scène comme David McVicar (l’Orlando à la Stephen Frears ou le Giulio Cesare très colonial), Pierre Audi (l’Orfeo digne de Poussin) ou Vincent Tavernier (un Monsieur de Pourceaugnac d’un esprit moliéresque inénarrable) ont réussi le pari de concilier respect de la trame et de la forme de l’opéra baroque et propos convaincant, « comestible » pour le public contemporain. Et si nous ne sortons pas de derrière les fagots les grandiloquentes élucubration d’un Ponnelle bien-aimé (mais le Met lui n’a pas n’hésiter pas à recréer en 2012 l’Idomeneo de 82 sans honte et avec succès) et surtout le magnifique Atys crépusculaire de Villégier, c’est bien parce que notre propos est justement de stigmatiser la tendance inverse, et que l’accumulation de ces – anciennes – réussites tend à brouiller le discours.

Elīna Garanča et Barbara Frittoli dans la reprise de 2012 d’Idomeneo au Met, dans la mise en scène de Jean-Pierre Ponelle © Metropolitan Opera New York City
Certes, cet imaginaire collectif de courtisans en jabots et de sopranos en paniers caricaturé à plaisir ne demande qu’à être contredit – depuis Jauss et l’école de Constance, nous savons que jouer avec, contrarier, exaspérer l’horizon d’attente du récepteur (i. e. le malheureux public qui n’en peut mais) est le dernier plaisir du créateur, mais aussi du destinataire cultivé qui sait jeter à bas ses catégories et ses attentes volontiers déçues. Certes, la répétition de clichés probablement passés d’âge, la valse sans fin répétée des mêmes costumes, des mêmes décors, des mêmes jeux scéniques est censée provoquer l’ennui et par conséquent la désaffection du public, qui attend d’être désarçonné, tiré d’une monotonie imaginative qui lui impose une conception poussiéreuse des classiques pour enfin percevoir le caractère proprement révolutionnaire d’Alcina ou de Cosi. Certes.
Qui ne sait d’ailleurs que la grande originalité, voire l’audace d’une mise en scène talentueuse peut permettre de révéler, d’enrichir la lecture d’une partition, quitte à fortement la trahir. Un exemple parmi tant d’autres, le Don Giovanni mis en scène par Michael Haneke, tout juste repris en janvier dernier sur la scène de l’opéra Bastille se trouvait transposé dans le monde de la finance, profitant au mieux des violences implicites que chacun devine ou imagine tapies dans un univers où les fantasmes contemporains logent sans limites le pouvoir et la domination. Nous n’avons pas aimé ce Don Juan de cafétéria troussant les femmes de ménage, mais le propos était puissant et fort quoique facile. Mais il importe qu’une correspondance soit perceptible par le public entre ce que le texte et la musique nous disent et ce que l’on voit, et que la vision du metteur en scène se rende intelligible, sous peine de laisser le public face à une énigme sémiologique. Or, si l’interprétation complexe des divers signes que dispense l’art total de l’opéra fait partie du plaisir intellectuel et artistique qu’on en retire – qui n’a joui de ces discussions acharnées et passionnées sur une mise en scène dont la richesse ouvre sur une infinité de possibilités ?-, l’incompréhension, le choc violent, la laideur assumée, le décalage affirmé finissent, quand ils sont systématiques et donc vides de sens, par lasser.

Don GIovanni dans sa cafétaria par Michael Haneke, reprise à l’Opéra Bastille en janvier 2015 © Vincent Pontet / Opéra de Paris
A cet égard, pour prendre un exemple récent non chroniqué sur nos pages – car peu remarquable et sans instruments ni artistes spécifiquement baroques – l’Idomeneo de Martin Kusej programmé par l’Opéra de Lyon en janvier et février 2015 nous a semblé un précipité chimiquement pur de mise en scène parvenant à l’inverse de l’objectif intellectuel recherché, donnant envie de fuir derrière ses paupières closes un dispositif scénique dont l’absence de beauté concurrence l’avalanche de clichés issus de la mise en scène contemporaine soit disant provocante. Aux lieux communs du spectateur, attendant un décor à la grecque et des héros en toge, répondaient ceux du metteur en scène recherchant à tout prix le choc, la controverse, l’écart interprétatif. Clichés contre facilités, évidences contre symboliques alambiquées sans rapport avec l’objet du discours : la dialectique difficile qui s’instaure entre l’attente et la vision imposée par le metteur en scène ne donne finalement pas naissance à une réflexion de quelque profondeur. L’étonnement n’est pas équivalent au questionnement, ni le dégoût inspiré par l’obscène, à une remise en question.
Il serait bien sûr possible, et d’autres l’ont d’ores et déjà fait avec talent, de s’attarder sur l’interprétation précise des choix de mise en scène de Kusej. On pourrait justifier le choix d’un décor sur tournette présentant toujours finalement la même boîte blanche et vide – quoique la laideur des panneaux de placo d’un blanc sale finisse par fatiguer quelque peu – en arguant de l’omniprésence de la volonté divine, faisant peser sur des personnages tournant sans cesse (rappel du labyrinthe de Minos ?) une pesanteur qui n’est certes pas incompatible avec l’atmosphère tragique. L’arrivée d’un requin géant en plastique, monstre neptunien ultra-réaliste prenant de ce fait des allures kitsch, peut à la rigueur être comprise comme une tentative d’instaurer une distance – laquelle, soit dit en passant, n’est une priorité que si l’on dénie au tragique sa puissance intrinsèque. L’ironie, le second degré, le rejet de l’identification ne sont toujours une nécessité absolue, et faire réfléchir le spectateur sur le pouvoir et ses liens avec la religion, objectif manifeste de Kusej, est une tâche qui peut parfaitement être menée au sein même de la tragédie par une adhésion qui conduit d’ailleurs, quand elle est correctement achevée, à la catharsis.
Il faut cependant déployer des trésors d’imagination interprétative pour voir dans l’armada de colosses issus du GIGN le mieux armé, mitraillettes, lunettes noires et air bestial en sus, un sens quelconque. Il fallait certes des gardes pour encadrer la foule des captifs troyens ; était-il nécessaire de les faire sortir de Matrix ? Pourquoi le Grand Prêtre de Neptune est-il la réincarnation d’un chef de secte satanique (ou hard-rock ?) de pacotille ? (Notons d’ailleurs ce goût appuyé pour le kitsch et la pacotille, qui témoignent nous semble-t-il d’un manque de confiance dans la capacité des œuvres à inspirer suffisamment par elles-mêmes une réflexion distanciée). Pourquoi enfin cet amas de tissus sanglants, se déversant sur sol, et sur lequel les mariés se tiennent victorieusement au 3eme acte? Le lien entre violence, pouvoir et religion nous semble ici bien lourdement signifié, et l’allusion aux déportés des camps qu’elle ne manque pas d’évoquer, incongrue. Est-il enfin nécessaire de céder à la mode qui impose de confronter les œuvres avec l’intrusion forcée et revendiquée des signes les plus grossiers de l’ultra-modernité ? Si le sens peut parfois en jaillir, bien souvent malheureusement, il ne demeure que l’impression d’une mécanique imposée à du vivant, une sensation de déjà vu qui finit par gommer l’unicité de l’œuvre pour en faire un manifeste (passons par exemple sur les « drapeaux » de tissu rouge arborés par les personnages et le chœur au 3ème acte, qui semble vouloir à toute force faire entrer dans l’opéra une dimension politique dont le bien fondé reste obscur).
Et encore, Kusej n’est pas aussi radical que d’autres, et sa banale transgression n’atteint pas les élucubrations sado-saochistes de Nigel Lowery – Amir Hosseinpour défigurant Rinaldo en 2002 (sans même parler du Giulio Cesare au Moyen Orient de Peter Sellars et de son Ptolémée en maillot moulant). Ce qui avait choqué à l’époque pour la recrudescence gratuite de Barbie et d’Action Men, de poupée gonflable à bouche de latex grande ouverte, de Playmobils et de missiles Exocet semble aujourd’hui presque la norme, qui oscille entre le minimalisme épuré de bon ton, l’accumulation de nazis et autres chemises noires (très pratique pour Néron ou n’importe quel romain), et les monstruosités précitées. Tout le reste, « classique, traditionnel, peu inventif », d’une fidélité lassante, d’une décoration ennuyeuse, se voit relégué dans les oubliettes de « l’historiquement ringard ». Et ce que nous avons réussi pour l’interprétation, à savoir « l’historiquement informé » (pour traduire maladroitement le terme anglais sans équivalent, car « sur instruments d’époque » est bien plus réducteur, et souvent faux devant le nombre de copies), n’a pas su s’imposer pour la mise en scène. Devons-nous le regretter ? Oui, tout en n’espérant pas imposer ce seul modèle, car sans cela comment imaginer la sublime Theodora de Carsen, avec son gouverneur américain et sa peine de mort éloignée du livret mais d’une intensité et d’une intelligence rares ?
La Theodora de Peter Sellars, scène d’exécution finale © Glyndebourne, 1996
Une autre idée de la mise en scène, que nous défendons, est de cesser de vouloir à tout prix voir dans les œuvres ce qui n’y est pas forcément – notre temps – et tenter d’y cerner l’universel, ou bien d’user de la magie de l’évocation.
Viet-Linh NGUYEN & Elsa FERRACCI
Étiquettes : Carsen Robert, Elsa Ferracci, Lazar Benjamin, Viet-Linh Nguyen Dernière modification: 22 mai 2020