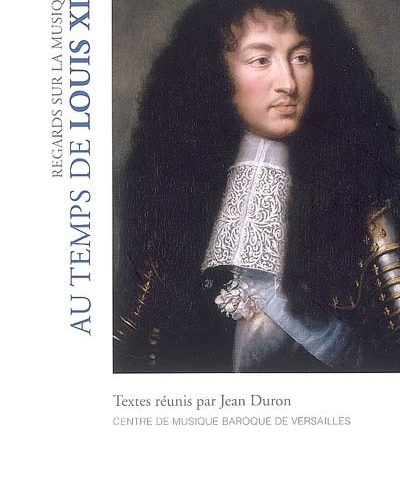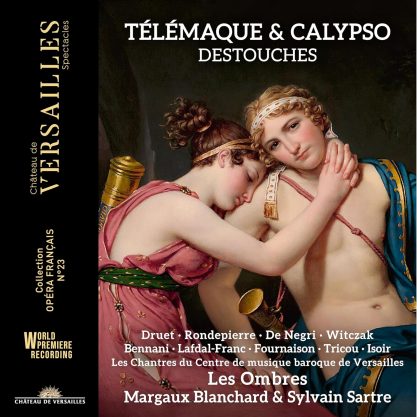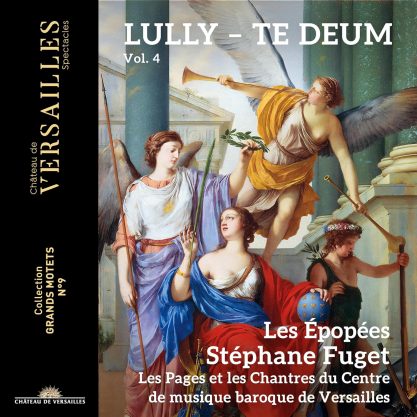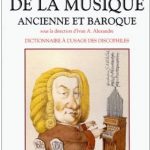Au temps de Louis XIV
Textes réunis par Jean Duron

© CMBV / Mardaga
Alberto Ausoni : A la cour et à la ville: art de plaire, musique et mode
Jean-Yves Hameline : Chanter Dieu sous Louis XIV
Jean Duron : Cette musique charmante du siècle des héros
Philippe Beaussant : L’influence personnelle de Louis XIV, du ballet à la tragédie
Anne-Madeleine Goulet : Les variations de la fête
Edmond Lemaître : Une discipline d’orchestre
Collection Regards dur la Musique, Centre de Musique Baroque de Versailles / Mardaga 2007, petit in-4 br., 157 p.
[clear]Après Louis XIII, poursuivons notre chronique de la savante série éditée par Mardaga pour le compte du Centre de Musique Baroque de Versailles, avec l’ouvrage consacré à la musique au temps de Louis XIV. La courte introduction de Jean Duron restitue d’entrée le contexte complexe et les exigences de la musique à l’époque du Roi-Soleil. Rarement dans son histoire la musique aura été autant liée au pouvoir. Non seulement elle rythme tous les instants majeurs de ce long règne (aussi bien fiancailles et mariages royaux que guerres et funérailles) mais encore elle doit plaire au Roi, musicien et danseur, qui n’hésite pas à abandonner les affaires de l’Etat pour dicter ses consignes personnelles lors de la composition de tel ballet ou de tel opéra !
L’article d’Alberto Ausoni consacré à « l’art de plaire, musique et mode » souligne l’évolution des esprits qui accompagne la montée en puissance de la monarchie absolue. Si la Cour crée la mode et affine le goût, c’est parce qu’en province comme à Paris la formation des esprits et l’art de plaire supplantent peu à peu l’ancien idéal guerrier de la noblesse. Ce nouveau paradigme est également plus accessible aux riches familles roturières, qui s’y rallient avec avidité dans leur souci de distinction (comme ne disait pas encore Bourdieu…). La diffusion des gravures de mode et des portraits renforce ce succès : nombreux sont ceux, femmes et hommes, qui s’y font représenter avec un instrument entre les mains. A côté des « cours » du duc d’Orléans et des Grands, qui concurrencent celle du Roi durant la Fronde, le foyer de l’abbé Mathieu, curé de Saint-André des Arts, participe à la diffusion de la musique italienne.
Côté religion, Jean-Yves Hameline souligne l’importance de la musique dans le décorum voulu par le culte post-tridentin. Certes le discours religieux demeure souvent empreint d’une certaine méfiance envers le caractère voluptueux de la musique, source insidieuse de péché. Mais la musique s’affirme comme moyen d’aviver la foi et d’atteindre la communion avec Dieu. La musique est désormais vue sans équivoque comme un moyen non de distraire l’attention du fidèle mais au contraire de la renforcer. Elle ne s’isole pas cependant pas dans un caractère « sacré », puisque le monde n’existe que dans sa dimension religieuse. Aussi les plus grands compositeurs (en particulier Charpentier) composent-ils aussi bien de la musique destinée aux offices qu’à la cour. De leur côté, les religieux (et en particulier les Jésuites, qui s’investissent dans l’éducation des classes aisées) n’hésitent pas à créer des événements musicaux. C’est dans ce contexte que ce développe le « petit motet », apporté d’Italie par le franciscain Henry du Mont.

Jardins du Château de Versailles, Parterre de Latone, moulage du terme d’Hercule, d’après Louis Le Conte, dit Le Conte de Boulogne (Boulogne, 1639 – Paris, 1694),
original datant de1684-1686 Inv. M.R. 1941
© Muse Baroque, 2011
Le magnifique article de Jean Duron sur « cette musique charmante du siècle des héros » décrypte brillamment les caractéristiques et les évolutions de la musique tout au long du règne. A son début existaient déjà plusieurs formations : les Vingt-Quatre Violons, les chanteurs et les instruments de la Chambre, les vents des Ecuries, les chœurs de la Chapelle. Elles n’étaient réunies qu’épisodiquement, lors des grandes cérémonies civiles ou religieuse. A partir de 1682, date de l’installation officielle de la Cour à Versailles, leur réunion devient la règle. Ainsi, à l’opposé de l’orchestre « classique » du XIXème siècle avec ses solistes, les instruments sont toujours intégrés par groupes entiers, que l’on fait taire par moment pour obtenir les effets recherchés. C’est le timbre -et non le thème, qui n’apparaîtra qu’au XVIIIème- qui structure la composition. Au plan vocal, les polyphonies s’articulent autour des voix graves, avec une seule « voix de dessus », à l’inverse de l’usage italien, comme le remarque déjà Lecerf de la Viéville. L’impression de majesté qui s’en dégage (et que l’on peut rapprocher en peinture des « clairs-obscurs » de Georges de la Tour) impressionne les contemporains. Elle devient ainsi une caractéristique de la musique française en Europe, aucune autre cour ne possédant de moyens équivalents, de sorte que cette musique ne pouvait s’exécuter hors de France, comme le note Sébastien de Brossard à Meaux. S’appuyant sur d’aussi formidables moyens, les compositeurs ont compris le pouvoir émotionnel de la musique, suscitant les passions puis les faisant s’évanouir. En matière de chant, les ornements se développent et s’enrichissent, mais les difficultés à codifier et noter ces « tours de gosier » font que les compositeurs se plaignent maintes fois d’être trahis, tandis que les chanteurs se plaignent de ne pouvoir exécuter les airs de manière fiable ! Mais dans les années 1690 Etienne Loulié invente le chronomètre, qui permet de déterminer le tempo, et en 1701 Brossard développe dans son Dictionnaire de la Musique son intuition de la cadence.
Avec l’arrivée de nouveaux musiciens à la Chapelle, les Grands Motets remplacent définitivement les messes en musique sur les paroles de l’ordinaire. Composés de mouvements autonomes (généralement inspirés des Psaumes), ils s’allongent en durée pour atteindre la demi-heure, jusqu’à constituer une œuvre complète, avec solistes, chœurs et symphonie qui conservera sa forme jusqu’à la Révolution. La messe royale devient ainsi une œuvre d’apparat à grand effectif. Cette forme se répand, limitée toutefois par les moyens disponibles, dans la plupart des églises du royaume.
Après le succès des représentations des opéras italiens à Paris, Perrin réfléchit à un opéra français. Mais la fertilisation croisée du théâtre et de la musique aboutit provisoirement à un genre unique, la comédie-ballet, due essentiellement à Molière et Lully. La première tragédie en musique fut le Cadmus et Hermione de Lully, créée en 1673 sur un livret de Quinault ; elle intègre airs chantés et récitatifs, mais aussi chœurs et danses. En raison des moyens disponibles, ces œuvres sont difficilement représentées en province. Qu’à cela ne tienne : dès 1695 l’éditeur Ballard diffuse des versions réduites des opéras à la mode à la Cour. A côté de cette musique « officielle », d’innombrables recueils témoignent du succès d’airs sérieux ou à boire, émanant d’auteurs sérieux ou de rimeurs d’occasion…

Galerie des Glaces du Château de Versailles © Muse Baroque, 2011
Philippe Beaussant s’attache à décrire l’influence personnelle du monarque dans les choix musicaux de son époque. Initié tout d’abord au luth, le jeune Roi décide rapidement de passer à la guitare, instrument jugé jusque-là populaire et qui prend avec lui ses lettres de noblesse. Dès ses 13 ans, il s’engage dans les représentations de ballet, avec un « palmarès » de professionnel : au total 60 rôles dans 23 ballets ! En amateur avisé, constatant qu’il avait atteint ses limites techniques, il s’arrête à l’âge de 32 ans, ce qui laissera le champ libre aux danseurs professionnels, et favorisera l’apparition de la tragédie lyrique. La participation du roi à des ballets n’était certes pas entièrement nouvelle à la cour de France : Henri III, puis Henri IV et Louis XIII dansèrent aussi. Mais l’intérêt du Roi pour la musique ne diminue pas lorsqu’il cesse de paraître sur scène, allant jusqu’à choisir les sujets des tragédies lyriques de Quinault. Cet art est marqué profondément par les partis-pris royaux : alors que les allégories mythologiques triomphent dans le décorum imposant de Versailles, les pastorales s’imposent en matière lyrique.
Dans « les variations de la fête« , Anne-Madeleine Goulet rappelle comment, après les privations de la Fronde, Paris se couvrit de fêtes. Celles-ci mobilisent les ressources de tous les arts : chant, danse et musique bien sûr, mais aussi architecture et peinture (pour les décors), poésie et théâtre, romans et costumes…Chacun a en tête la somptueuse fête de Vaux-le-Vicomte d’août 1661 donnée par Fouquet en l’honneur du Roi, et qui fut bien ingratement suivie de l’arrestation du surintendant quelques semaines plus tard… Les fêtes de la Cour se déroulent généralement en dehors de Paris : Fontainebleau, Chambord, Saint-Germain-en-Laye, puis Versailles bien sûr. Dès 1664 est donnée la célèbre « Fête des Plaisirs de l’Ile enchantée », avec des décors de Vigarani, qui rehaussent ce qui n’est alors qu’une résidence de campagne. Puis viendra l’habitude d’organiser de grandes fêtes à Versailles pour célébrer les victoires militaires et les succès diplomatiques : dans les Flandres en 1668, pour le rattachement de la Franche-Comté en 1674 (un Grand Divertissement durant six jours, avec représentations du Malade Imaginaire, de l’Alceste de Lully ; des décors de Vigarani et Bérain, avec la collaboration de Le Brun, peintre du Roi depuis 1661 : il n’en fallait pas moins pour éblouir la noblesse de cette nouvelle province du royaume !).
Les fêtes servaient ainsi l’absolutisme monarchique, dont elles permettaient de mesurer les évolutions. Ainsi, c’est au cours du Grand Carrousel de 1662 que Louis XIV adopte le soleil pour emblème, et la devise « Nec pluribus impar ». En retour, elles s’attirèrent quelques critiques de contemporains lucides sur le contraste entre l’opulence royale et le dénuement du peuple et des finances royales : Colbert, La Fontaine, Saint-Simon, La Bruyère, Vauban exprimèrent leurs voix discordantes, voire leurs sarcasmes. De fait, après l’installation de la Cour à Versailles, les grandes fêtes laissèrent place aux « fêtes d’appartement », moins dispendieuses mais encore plus élitistes. Seuls les nombreux deuils de la famille royale mirent fin à ces réjouissances à la fin du règne, tandis que la haute aristocratie (notamment les Condé à Chantilly) en reprenait le flambeau.
L’évolution des pratiques orchestrales dans cette période-charnière est retracé avec forces détails par Edmond Lemaître (« une discipline d’orchestre »). Dès 1669 fut fondée « l’Académie d’opéra », privilège accordé à Perrin pour la pastorale Pomone. Après sa faillite suite à malversations, Lully rachète le privilège, et la renomme « Académie Royale de Musique ». Lully s’était également vu confier « La Petite Bande » (ou « Petits Violons »), formée de jeunes interprètes réguliers qu’il éduquait et dirigeait – probablement l’une des premières formations professionnelles dans l’Europe de ce temps. L’Académie comprend elle 42 instrumentistes -sans les trompettes, qui ne sont pas intégrées officiellement, et les cors, qui jouent en coulisses- dont 24 violons (surtout dessus et basses, le registre intermédiaire étant mal représenté car peu audible). Lully forme également deux « batteurs de mesure », Lalouette et Colasse, pour les répétitions. Comment dirigent-ils ? Bâton ou feuille de papier, les deux sont attestés…Et Lully règle aussi les coups d’archets des cordes, usage qui sera repris et généralisé par les Allemands. Au plan musical, Lully créée « l’ouverture à la française » (grave pointé- vif fugato- grave pointé) pour les ouvrages lyriques ; il impose le menuet pour la danse.
Les instruments anciens, hérités du XVIème siècle, sont remplacés par de nouveaux, plus aisés à manier et plus riches en sonorités : le dessus de violon se perfectionne, la basse de violon prend une cinquième corde pour étendre son registre aigu et gagner en virtuosité. Des instruments nouveaux apparaissent : la flûte traversière, importée d’Allemagne, concurrence sérieusement la flûte à bec, avec sa capacité à enfler le son sur une même note ; le basson, enfin le dessus de hautbois, instrument lulliste par excellence (apparu vers 1660). La trompette en revanche demeure d’un emploi assez limité. Et dans l’ancienne famille des violes, la basse (avec sept cordes, depuis Sainte-Colombe) s’affirme au détriment des autres. L’appareil instrumental fait appel essentiellement au quintette de cordes, quelquefois au trio. Le quintette de cordes constitue également la base de l’orchestration lyrique. On mesure là tout le chemin que fait parcourir à l’art musical du règne le jeune violon venu d’Italie, mort pour s’être écrasé le gros orteil lors du Te Deum de 1687 à l’église des Feuillants…
Que dire de plus devant cette avalanche d’érudition bien documentée, qui permet de comprendre la formation d’un genre musical national, à la croisée de l’héritage de la Renaissance et des apports italiens, qui porte aussi fort que ses armées victorieuses la renommée du Roi-Soleil aux quatre coins de l’Europe ? Amateurs de baroque qui voulez connaître le contexte historique de la création de vos œuvres musicales favorites, ne faites pas l’économie de la lecture de ce précieux ouvrage…
Bruno Maury
Site de l’éditeur Mardaga :
Site du Centre de Musique Baroque de Versailles