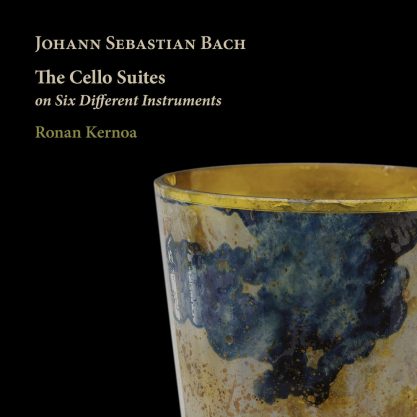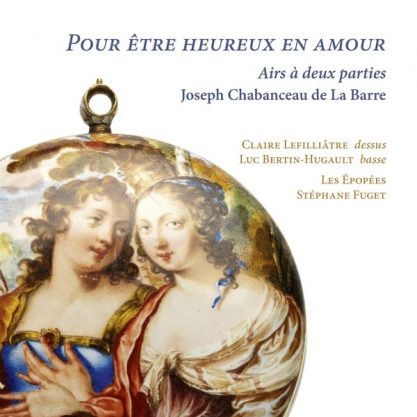Ensemble l’Encyclopédie © Marielle Aubé
Ensemble l’Encyclopédie © Marielle Aubé
Kindermusik
Wolfgang Amadeus MOZART
Sérénade n°6 en ré majeur K.239
« Serenata notturna »
Leopold MOZART
Symphonie des Jouets en ut mineur
Wolfgang Amadeus MOZART
Concerto n°13 pour pianoforte et orchestre en ut mineur KV 415
Leopold MOZART
Promenade musicale en traineau en fa majeur
Ensemble l’Encyclopédie
Florent Albrecht, pianoforte et direction
Salle Gaveau, Paris, 20 octobre 2025
La musique est vecteur d’émerveillement ! L’affirmation peut sembler banale, évidente, éculée. Elle retrouve soudain tout son sens à l’écoute de ces pièces, incontournables, qui n’ont pas pour la moindre des vertus de rajeunir grandement le public des concerts baroques et classiques. Car ce soir le public de la salle Gaveau était notablement composé d’enfants n’ayant pas atteint, ou à peine, leur première décennie. Vacances de la Toussaint oblige, programmation s’y prêtant, nombre de spectateurs n’ont pas les pieds qui touchent terre et tout le monde s’en accommode, même au prix de quelques remarques ou questions non chuchotées à leurs parents (ou grands-parents) en cours de représentation.
Florent Albrecht, fin pianofortiste et mozartien qu’on avait pu admirer dans les Fantasies (Triton) et son Ensemble l’Encyclopédie, formation encore récente puisqu’elle fut créée par le pianofortiste il y a seulement cinq ans, en 2020, rendent hommage à la famille Mozart : le programme tant entièrement composé d’œuvres du père, Léopold Mozart (1719-1787) et de sa plus célèbre descendance, en la personne du fils, Wolfgang Amadeus (1756-1791). Ces retrouvailles en famille marquent la sortie du premier enregistrement de l’Ensemble l’Encyclopédie chez Harmonia Mundi, où se retrouvent la plupart des œuvres jouées ce soir.
S’il ne brille pas par la rareté des œuvres jouées – la plupart s’avérant des classiques des concerts joués traditionnellement en fin d’année – ce programme reste composé d’œuvres dont l’inventivité, la légèreté et la fraîcheur d’âme restent une perpétuelle source d’émulation pour les plus jeunes oreilles, et leurs nombreuses paires d’yeux recherchant les instruments faisant entendre ces si curieuses sonorités. Et quand nous disons jeunes oreilles, avouons que personne n’a boudé son plaisir, jeunes ou moins jeunes, à l’écoute de pièces, certes pas inconnues, mais dont l’interprétation musicalement informée de Florent Albrecht et de son ensemble, avec notamment des effectifs comparables au contexte de leur création et non comme souvent l’usage d’un orchestre symphonique, permet d’en souligner l’inventivité et la proximité d’avec le public. Avec l’Encyclopédie, ces pièces retrouvent un nouvel allant, une nouvelle jeunesse à la fois vive et épurée.
Alors plongeons comme des enfants avec ce bonheur premier de l’ambiance de la salle, de l’accord des instruments et des facéties des instrumentistes dans ces classiques viennois qui au passage illustrent parfaitement ce style galant viennois de déclin du baroque et de transition vers le classicisme, tout en laissant déjà percevoir une légèreté, une cadence rythmique et des sonorités colorées et sucrées dont ne se départira pas tout un pan de la musique germanique jusqu’aux célèbres valses viennoises, irriguant le dix-neuvième siècle.
Mais honneur au fils pour commencer ce concert, Florent Albrecht et ses musiciens nous gratifient de l’interprétation de la Sérénade n°6 en ré majeur (K.239) également surnommée Serenata motturna composée début 1776 à l’occasion des fêtes du carnaval de Salzbourg. Une pièce en trois brefs mouvements où l’on soulignera la distinction faite par le compositeur entre les parties en tutti, avec notamment adjonction de timbales et les parties solistes portées par deux violons, dans une forme inspirée des concerto grosso italiens. Un premier mouvement composé d’une Marcia où s’affirment des violons très mozartiens, avant que le Minuetto du deuxième mouvement ne se caractérise par un beau jeu de réponses entre les différentes voix de violon et un passage en pizzicato occasion de regards qui se tendent, interrogatifs, des plus jeunes spectateurs de la salle. Cela avant un Rondo conclusif, sautillant et gai, lui aussi assez représentatif de la parfaite maîtrise du jeune Mozart dans l’art des compositions pour violons.

Portrait de la famille Mozart (vers 1780). Attribué à Johann Nepomuk della Croce (1736-1819). Huile sur toile (140 x 187 cm) – Source : Wikimedia Commons
Mais passons du fils au père pour la Symphonie des Jouets en ut mineur. Quoi ! Léopold Mozart, compositeur de la Smphonie des Jouets… nous entendons d’ici certains crier à l’hérésie et déjà convoquer leur avocat spécialiste du droit de la propriété intellectuelle. Ne rentrons pas dans un débat déjà ancien et dont le présent article n’a pas vocation à trancher le débat. Disons simplement pour en faire une courte synthèse que longtemps attribuée à Joseph Haydn (1732-1809), parfois à son frère cadet Michael Haydn (1737-1806), elle revint finalement à Léopold Mozart, notamment sur la foi de partitions de l’œuvre rédigées par ce dernier. Et cela avant qu’un quatrième larron compositeur ne vienne troubler le jeu depuis une trentaine d’année, Edmund Angerer (1740-1794), bénédictin autrichien et lui-même compositeur. Le débat n’est à ce jour pas tranché et avouons que cela n’affecte en rien le plaisir perçu à l’écoute d’une œuvre qui sous les atours attrayants d’une légèreté assumée cache une inventivité de tous les instants, cherchant autant à divertir qu’à intriguer.
Si la structure musicale de l’œuvre est portée par un orchestre de cordes (violons, alto, violoncelles, contrebasse), nombreux sont les instruments, parfois très secondaires à une faire une apparition sonore, stimulante, au cours des trois mouvements (Allegro, Menuetto, Presto) de l’œuvre. Citons dans le désordre et de manière non exhaustive, des rossignols à eau, un triangle, cymbales, trompette baroque, crécelle… Une panoplie, une quasi litanie, autrement dit un inventaire à la Prévert qui n’est pas qu’anecdotique, nombre de ses instruments puisant leur origines dans le folklore autrichien des régions salzbourgeoises et frontalières de l’actuelle Bavière, région du Berchtesgaden où jouets colorés en bois et instruments pour enfant constituent les fondements de la tradition et de l’artisanat local, expliquant le titre original de l’œuvre de Berchtoldsgaden Musik. Une œuvre qui ainsi rejouée avec ces instruments secondaires glanés et mis en avant conserve tout son pouvoir d’émulation des petits et grands.
Retour aux fondamentaux en suite de programme pour Florent Albrecht, avec le Concerto n°13 (KV 415) pour pianoforte et orchestre de Wolfgang Amadeus Mozart, occasion pour le chef d’ensemble de faire entendre un pianoforte (de facture et de date hélas non mentionnées, est-ce le Baumbach de 1780 de l’Abbé de Vermond ?) au son très droit, sec, avec peu de résonnance et en cela joliment caractéristique des temps anciens de l’instrument, même si son ampleur sonore limitée peine quelque peu à emplir le volume de la salle Gaveau. Ce qui n’empêchera pas d’apprécier dans cette œuvre, parfois décriée à juste titre pour son manque d’homogénéité de composition, la capacité d’un Mozart encore jeune (l’œuvre est composée au cours de l’hiver 1782-1783) et des musiciens à théâtraliser la composition, faisant débuter son premier mouvement (allegro) de manière solennelle, avec une pompe rappelant les ouvertures à la française (trompette naturelle et timbales sont de la partie), avant que le piano n’entre, dialoguant alors avec l’orchestre, avec une élégance et un raffinement qui n’a rien à envier aux œuvres plus tardives de Mozart et à ses poursuivants (y compris jusqu’à Beethoven). Cet art de la diffraction qui contraste avec le second mouvement du concerto (Andante), où l’Encyclopédie se fait plus intime, avec une orchestration très épurée et laissant le pianoforte tendre vers un jeu de sonate, avant que le troisième mouvement (allegro) ne revienne dans un Rondo à la structure très architecturée aux amours du compositeur pour la verve musicale déployée dans le mouvement initial, nous gratifiant d’un mouvement où le piano agit comme une rampe de lancement du thème pour l’orchestre, qui le reprend et semble rebondir, réagir à ce dernier, avant de finalement se taire pour laisser l’instrument, assez étonnamment, conclure l’œuvre dans un apaisement d’après tempête. Une œuvre dans laquelle Mozart semble tester ses effets et les capacités de l’instrument, faisant fi d’une cohérence d’ensemble qui ne semble pas son but premier.
Et pour finir ce programme avec entrain et divertissement comme il avait commencé, Florent Albrecht convoque un autre divertissement de Léopold Mozart, celui-ci non contesté, la Promenade Musicale en traîneau en fa majeur (1755), courte pièce (à peine plus de deux minutes) et nouvelle occasion pour Mozart père de laisser s’exprimer son goût pour une musique très visuelle et faisant également intervenir des instruments peu conventionnels, à l’exemple de ces grelots de traîneaux, aux sonorités très caractéristiques, ou encore ce fouet, claquant de manière très sonore, captivant le jeune auditoire d’une soirée au cours de laquelle Florent Albrecht et l’Ensemble l’Encyclopédie, en revisitant ces classiques dans une approche raisonnée proche de celle de leur création se sont acquis haut les cœurs les faveurs de tous les publics.
Pierre-Damien HOUVILLE
Étiquettes : Albrecht Florent, Ensemble l'Encyclopédie, Harmonia Mundi, Mozart, Mozart Leopold, Musique classique, musique instrumentale, musique pour orchestre, Pierre-Damien Houville, Salle Gaveau Dernière modification: 27 octobre 2025