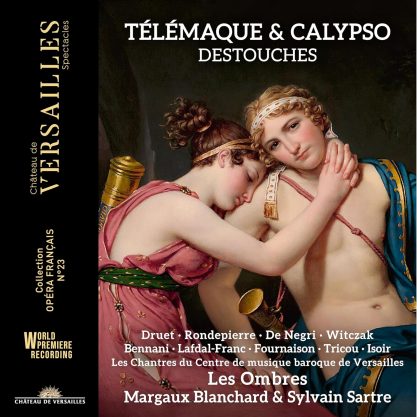© Sébastien Mathé / Opéra National de Paris
Iphigénie en Tauride
Tragédie lyrique en 4 actes de Christoph Willibald von Gluck (1714-1787) sur un livret de Nicolas-François Guillard
Création à l’Académie Royale de Musique le 18 mai 1779
Iphigénie : Tara Erraught
Oreste : Jarrett Ott
Pylade : Julien Behr
Thoas : Jean-François Lapointe
Diane / Première prêtresse : Marianne Croux
Deuxième prêtresse / Une femme grecque : Jeanne Ireland
Un Scythe / Un ministre : Christophe Gay
Iphigénie (rôle muet) : Agata Buzek
Chœur et Orchestre de l’Opéra National de Paris (chef des chœurs : Alessandro di Stefano)
Direction musicale
Thomas Hengelbrock
Mise en scène : Krzysztof Warlikowski
Décors et costumes : Malgorzata Szczesniak
Lumières : Felice Ross
Vidéo : Denis Guéguin
Chorégraphie : Claude Bardouil
Dramaturgie : Miron Hakenbeck
Opéra Garnier, Paris, 14 septembre 2021
(représentations du 14 septembre au 02 octobre 2021)
Il y a bien pire que la malédiction des Atrides, les Ménades et tout le toutim. Il y a l’inventivité cultivée de Krzysztof Warlikowski qu’on apprécie ou qu’on honnit. Au moins ne laisse t-elle pas insensible depuis sa création mouvementée de 2006. Imaginez : une vaste maison de retraite au mur de fond de hangar, avec rideaux métalliques et tag géant en forme de dragon. A droite un alignement de lavabos, où Iphigénie âgée, pourra se contorsionner en vomissant tout son soul. A gauche, des douches, qui ne serviront à rien. En haut, façon Apocalypse Now, tourbillonnent des ventilateurs. L’idée de départ n’est pas déraisonnable, sur le papier. Iphigénie, âgée, fragile psychiquement comme physiquement, ne parvient pas à se débarrasser des démons de sa terrible existence. Hélas pour cela, il fallait malmener le livret, la faire monologuer avec ses souvenirs en escamotant de scène les prêtresses, femmes grecques ou les chœurs qui délivrent leurs lignes depuis les balcon, juste de noir vêtus. Et avait-on besoin de tant de laideur au niveau des décors de Malgorzata Szczesniak, de rabaisser la tragédie vers le trivial, pour le geste d’auteur ? Fallait-il que Pylade s’enivre au whisky, goulot à la bouche, pour se donner le courage de la rébellion finale (un échange de jets de roses !). Fallait-il tout ce fatras si compliqué que ces byzantineries perdent même les auditeurs au fait de l’œuvre et du contexte mythologique ? On compulse discrètement Eschyle, Euripide, Racine, sans succès car la réécriture du metteur en scène, allusive et disruptive, chamboule tout. Avant de nous traiter de rétrogrades bouchés, rappelons que même si nous adorons les toges, nous avons été admiratifs de la théâtralité sobre d’un Pierre Audi à Amsterdam avec Marc Minkowski qui respectait le drame. Hélas, la poésie comme la narration sont ici ouvertement culbutées.

© Sébastien Mathé / Opéra National de Paris
Essayons un peu de n’y rien comprendre, car tout ce fatras est impitoyablement construit, et ne procède pas juste d’un coup de dés abolissant le hasard. Il n’en est pas moins inutilement élitiste dans sa prétention post-contemporaine, et daté dans sa provocation. Commençons : Iphigénie, âgée, blonde décolorée et permanentée façon 60’s, moulée dans sa robe à paillette dorée, se morfond dans sa maison du troisième âge des States aux côtés de petites vieilles qui mangent des gâteaux et regardent la TV. Mais grâce à un ingénieux système de voiles ou de cage de verre, des flashbacks et visions l’assaillent constamment. On y voit cette fois-ci Iphigénie jeune, sanglée dans une robe moulante écarlate, brune et… flirtant avec Thoas, en tatouages et fauteuil roulant (alors qu’il sera ensuite en pleine forme et en uniforme de dictateur digne de ceux du Général Alcazar titinesque avant son assassinat). Ajoutons qu’Iphigénie est alternativement jouée par la filiforme Agata Buzek ou chantée par Tara Erraught à la silhouette plus charpentée, et que les deux Iphigénies cohabitent quasi constamment, mais échangent leurs habits. Ceux qui n’ont pas lu le livret avant (et encore), en perdent leur latin, ou plutôt leur grec… Poursuivons : on aperçoit dans la pénombre un Oreste nu assassinant Clytemnestre après lui avoir bouloté les seins (si c’est bien Clytemnestre car cela se passe à l’arrière plan) puis l’on regarde des vidéos qui font leur apparition à compter du 3ème acte : sacrifice manquée d’Iphigénie avec couteau sur la gorge en ralenti et rediffusé en boucle, scènes d’embrassades avec Oreste. Ou alors Iphigénie, très malheureuse, trop malheureuse, ta famille est anéantie, etc., se console avec son doudou : un gros coussin.

© Sébastien Mathé / Opéra National de Paris
Bon n’en lâchons plus, Argos est pleine. De bruit et de fureur, de Pylade dans le whisky, d’Iphigénie dans le vomi. Et la musique me direz-vous, cette musique sublime, tendue, pleine d’émotion du Gluck réformateur de la tragédie lyrique ?
Tara Erraught campe une très noble Iphigénie, sensible, attentive à la prosodie, à la diction française remarquable pour ce rôle exigeant avec autant de récitatifs accompagnés. Certes son soprano un peu flutée n’éclipse pas les souvenirs des nuances moirées et tragiques de Mireille Delunsch, mais elle surplombe incontestablement le plateau vocal avec le Thoas de Jean-François Lapointe, stable et rocailleux, d’une musicalité impérieuse que dément la mise en scène qui cherche à le rendre pitoyable ou grotesque. Points faibles de la distribution les Pylade et Oreste de Julien Behr et Jarrett Ott ne sont manifestement pas à l’aise dans ce répertoire, malgré leur engagement dramatique : voix instables, trop larges, mal maîtrisées, articulations romantiques et prosodie rudimentaire. En outre, Julien Behr n’a pas la tessiture de haute-contre à la française requise et doit constamment tirer dans les aigus (on est loin du célèbre Joseph Legros lors de la création de 1779), tandis que le baryton trop aigu de Jarrett Ott rend le contraste des deux personnages plus flous, ce qui est peut-être voulu du fait de la relation fusionnelle et des sous-entendus homosexuels signifiés par le metteur en scène.
Les chœurs de l’Opéra de Paris ont été contraints de chanter masqués (ce qui est une aberration), et depuis les balcons latéraux : résultat, on perd en présence et en projection ce qu’on gagne par un son éthéré, transparent dans les aigus, d’une clarté diaphane. Dans la fosse, Thomas Hengelbrock dirige avec finesse et dynamisme l’Orchestre de l’Opéra de Paris. On regrettera seulement le timbre déplacé des instruments modernes, notamment des instruments obligés, et un manque de présence des cordes qui est le talon d’Achille récurrent de la phalange parisienne.
Et tandis que les peuples célèbrent le lieto fine et le retour de leur légitime prince, cette Iphigénie laisse le souvenir marquant quoiqu’amer d’un rendez-vous manqué, et l’on se dit Krzysztof Warlikowski a tout de même réussi avec ses ombres torturées à hanter le spectateur.
Viet-Linh Nguyen
Étiquettes : Christoph Willibald Gluck, opéra, Palais Garnier, Viet-Linh Nguyen Dernière modification: 28 septembre 2021