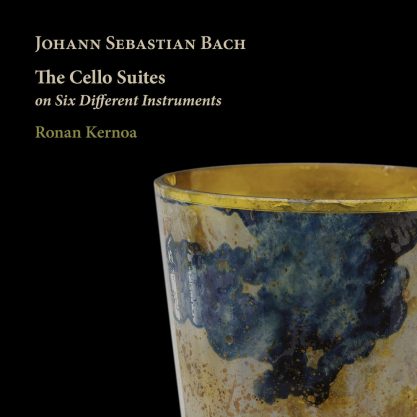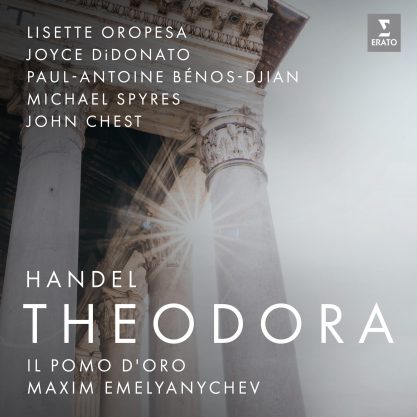“O the Pleasure of the Plains
Happy Nymphs and happy Swains !
Harmless, merry, free and gay,
Dances and sport the Hours away !”

Leonardo García-Alarcón © Bertrand Pichène / Festival d’Ambronay 2025
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Acis & Galatée (HWV 49)
Semi-opéra en deux actes sur des textes de John Gay d’après Les Métamorphoses d’Ovide,
Créé à Londres en 1731
Charlotte Bowden, soprano, Galatea
Hugo Hymas, Ténor, Acis
Staffan Lijas, Basse, Polyphemus,
Valerio Contaldo, Ténor, Damon,
Nicolas Scott, Ténor, Coridon,
Maud Bessard-Morandas, soprano
Leandro Marziotte, contre-ténor,
Raphael Hardmeyer, basse
Cappella Mediterranea
Direction Leonardo García-Alarcón
 Il est des lieux qui vous forment, voire qui vous modèlent. Leonardo García-Alarcón choisit-il Ambronay ? Ce qui est certain c’est que l’abbatiale a choisi le chef argentin. Vingt ans ! Vingt années de riche collaboration entre le Festival d’Ambronay et Leonardo García-Alarcón, mais aussi en cette année 2025 vingt ans d’existence pour la Capella Mediterranea. Avouons que le chef a quelques raisons d’être ému en prenant la parole pour présenter le concert, d’autant qu’en filigrane pointent au moins deux autres évènements au souvenir marquant. La rencontre ici même, il y a vingt ans, avec celle qui deviendra son épouse, Mariana Flores, et le décès tragique en 2023 sur la scène de l’abbatiale de Alejandro Meerapfel, compagnon de route de tant de projets, en pleine représentation de Il Donno della Vita eterna d’Antonio Draghi. « Nous avons tout connu dans cette église » dira avec pudeur et simplicité le chef argentin avant de faire allusion à l’évènement, avec l’élégance des gens qui se souviennent tout en ayant pris le parti d’avancer. C’est aussi cela Leonardo García-Alarcón, la classe, la maîtrise et la tempérance jusque dans le souvenir des moments les plus douloureux.
Il est des lieux qui vous forment, voire qui vous modèlent. Leonardo García-Alarcón choisit-il Ambronay ? Ce qui est certain c’est que l’abbatiale a choisi le chef argentin. Vingt ans ! Vingt années de riche collaboration entre le Festival d’Ambronay et Leonardo García-Alarcón, mais aussi en cette année 2025 vingt ans d’existence pour la Capella Mediterranea. Avouons que le chef a quelques raisons d’être ému en prenant la parole pour présenter le concert, d’autant qu’en filigrane pointent au moins deux autres évènements au souvenir marquant. La rencontre ici même, il y a vingt ans, avec celle qui deviendra son épouse, Mariana Flores, et le décès tragique en 2023 sur la scène de l’abbatiale de Alejandro Meerapfel, compagnon de route de tant de projets, en pleine représentation de Il Donno della Vita eterna d’Antonio Draghi. « Nous avons tout connu dans cette église » dira avec pudeur et simplicité le chef argentin avant de faire allusion à l’évènement, avec l’élégance des gens qui se souviennent tout en ayant pris le parti d’avancer. C’est aussi cela Leonardo García-Alarcón, la classe, la maîtrise et la tempérance jusque dans le souvenir des moments les plus douloureux.
Et si Ambronay constitue pour la Cappella Mediterranea une Arcadie initiatique, à la fois féconde et tempétueuse, Leonardo García-Alarcón se devait un jour d’y donner cet Acis & Galatea, classique haendélien par excellence, quasi passage obligé, œuvre phare alliant dans la concision de son livret et la précision de la partition légèreté et profondeur, intimité et faste. Un voyage, mythologique et musical comme la promesse de l’échappée vers des horizons qui pour être connus n’en sont pas moins inspirants. Acis & Galatea est une œuvre à juste titre présentée comme arcadienne par le chef, tant s’y déploie la pureté virginale des sentiments, l’initiation aux charmes de l’existence et au final l’apprentissage de son caractère tragique, mais dont il ne faut oublier pour autant qu’elle puise son inspiration dans les ressorts siciliens de la mythologie grecque, les amours contrariées du jeune berger Acis et de la néréide Galatée prenant décors sur les pentes de l’Etna, où le risque de prendre un rocher sur la tête, ou non envoyé par le cyclope Polyphème, est toujours d’actualité. Une pastorale muse de nombreuses œuvres classiques du répertoire, de l’Acis et Galatée de Lully (1686) au non moins célèbre Polifemo de Porpora (1735) en passant par les plus confidentiels Les Amours d’Acis et de Galatée (1682) de Charpentier (sur un livret de Jean de La Fontaine) dont seul l’aria Brillantes feuilles, naissez a résisté aux pertes de l’Histoire et Acide e Galatea de Haydn (1763), tout en n’oubliant pas la plus rarissime zarzuela Acis e Galatea (1708) de Antonio de Literes. [Un mythe fécond donc, qui inspira Haendel à plusieurs reprises, la version donnée ce soir, celle de 1731 en deux actes et créée à Londres, ne devant être confondue avec la pastorale Aci, Galatea e Polifemo du même Haendel créé en juillet 1708 à Naples, alors que le jeune compositeur s’inspire avec autant de talent que de rapidité des formes de la musique italienne.]
Et il faut reconnaître que Haendel sied une fois de plus à merveille à Léonardo García-Alarcón, qui dans cette partition, véritable synthèse des styles anglais et italien trouve à la fois la rigueur de composition des partitions et la fantaisie des couleurs instrumentales qui le ravissent et lui permettent de s’exprimer. Allons même plus loin, le chef de la Cappella Mediterranea semble souvent jouer avec la partition, sa richesse, ses anfractuosités et ses méandres pour mieux nous en servir une version marquée de sa personnalité, modelée de son empreinte. Dès la Sinfonia d’ouverture se retrouve la vigueur des attaques de cordes, la densité orchestrale mais aussi la souplesse et la finesse ouatée des flûtes qui nous avait emportée dans le récent enregistrement du Dixit Dominus, associé à la Missa Concertata de Colonna (Ricercar). Les tempi, vifs, variés, francs, sont pertinents et offres à la partition une vigueur amplifiée, une jeunesse renouvelée se retrouvant dès le premier des nombreux passages dévolus au chœur, celui-ci s’avérant, dense, homogène, malléable aux inflexions soulignées par le chef qui du clavecin dirige son ensemble le plus souvent du regard, des mains quand celles-ci ne sont pas sur le clavier, presque des épaules quand les doigts dextres se doivent de faire vivre la partition. Tout le corps de Leonardo García-Alarcón semble parfois tressaillir, se contracter comme au passage d’une secousse électrique dans une direction incarnée mais jamais maniérée, vive sans être ostentatoire.

Acis & Galatea (1761), par Pompeo Batoni (1708-1787), Huile sur toile, 98 x 75 cm. Stockholm, Musée National d’Art. – Source : Wikimedia Commons
Au rang de ses interprètes, nous soulignerons le timbre gracile et juvénile de Galatée, interprétée avec une ancillaire élégance vocale et scénique par Charlotte Bowden qui ne peine à se plonger dans ce rôle de nymphe marine et à rendre palpable la sincérité de ses sentiments amoureux, juvénile et curieuse dans le Hush, ye pretty warbling Quire (Acte I), plus roucoulante, agile et vocalement piquante sur le As when the Dove (fin de l’Acte I), elle offre une belle colonne vocale, et une belle longueur de note sur les da capo du rôle.
Nous ne retrouvons pas, du moins en début de représentation, une telle adéquation avec le personnage chez Hugo Hymas, qui incarne en début d’œuvre un Acis effacé, vocalement sans aspérité, mais également sans véritable personnalité. Si son aria Where shall I seek the charming Fair ? (Acte I) aux da capo sans grandes nuances nous laisse de marbre, avouons que le jeune ténor semble rapidement se détendre, la voix se chauffer, plus pénétrante, convaincante dès le Love in her Eyes sits plaiying (milieu de l’Acte I), il forme avec Charlotte Bowden un couple touchant, charmant sur le célébrissime duo conclusif du premier acte Happy We.
Mais c’est bien dans cet Acis & Galatea dans le second acte que le tragique surgit. Le tragique, c’est Polyphemus, jaloux des amours de nos deux cœurs tendres. Il faut pour incarner Polyphemus un charisme vocal et une présence physique, scénique digne à la fois de l’impressionnant Cylop sculpté par Jean Tiguely et Nikki de Saint Phalle (Milly-la-Forêt) et du Colosse de l’Apennin (Jean Bologne, Villa di Pratolino, Toscane). Staffan Liljas, baryton-basse d’origine suédoise campe à merveille tant vocalement que physiquement son démon, faisant de Polyphemus un personnage contre démiurgique, armageddonnien, d’abord inquiétant et carnassier sur le O ruddier tan the Cherry ! (Acte II), tétanisant et d’une parfaire diction sur le Cease to Beauty to be suing (Acte II), toujours aussi impressionnant dans son trio avec Acis et Galatea The Flocks shall leave the Mountains, assurément l’acmé dramatique de l’œuvre. Emplissant de sa voix les voutes de l’abbatiale d’Ambronay, même quand la mise en espace le rejette en arrière de l’orchestre Staffan Liljas, trop rare sous nos latitudes, constitue bel et bien la révélation majeure et hautement charismatique de cette représentation d’Acis & Galatea où nous mentionnerons également le noble Valerio Contaldo, tout à fait convaincant dans le rôle de Damon.
En deux mots : Happy We !

L’Ensemble Cantoria © Bertrand Pichène / Festival d’Ambronay 2025
Les Trésors du Vatican
Tomas Luis de Victoria (1548-1611)
Ave Regina a 8
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1547-1594)
Kyrie
Gloria
Tomas Luis de Victoria
Alma redemptoria a 8
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Credo
Tomas Luis de Victoria
Vidi speciosam a 6
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Sanctus-Benedictus
Tomas Luis de Victoria
Laudate Dominum a 8
Tomas Luis de Victoria
Ave Maria a 8
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Agnus Dei
Ensemble Cantoria :
Sopranos : Inès Alonso, Carmen Callejas & Rita Morais
Altos : Oriol Guimera & Juan Manuel Morales
Ténors I : Andrés Miravete & Carles Prats
Ténors II : Vicente Bujalance & Jorge Losana
Basses I : Lluis Arratia & David Guitart
Basses II : Lorenzo Tossi & Albert Cabero
Orgue : Marina Lopez
Direction : Jorge Losana
Nous avons retrouvé notre préninstin ! Le Festival d’Ambronay se devait de souligner, même discrètement, le cinq-centième anniversaire de la naissance de Palestrina, né vraisemblablement en 1525 à Palestrina (Latium), l’ancienne Préneste, dont l’actuel gentilé conserve la connotation antique. C’est aujourd’hui l’Ensemble Cantoria qui rend hommage au compositeur, s’emparant de son répertoire et l’associant à celui de Tomas Luis de Victoria (1548-1611), compositeur espagnol ayant exercé autant dans les états pontificaux qu’en Espagne et dont la confidentialité en France n’a d’égale que la renommée de l’autre côté des Pyrénées, Tomas Luis de Victoria s’imposant comme un jalon essentiel de la musique polyphonique de la fin de la Renaissance espagnole.
Cantoria, que nous avions pu entendre dans un très beau programme consacré aux madrigaux de Monteverdi lors de l’édition 2024 du Festival de Saint Michel en Thiérache, met en regard les deux compositeurs dans un programme sobrement intitulé Les Trésors du Vatican. L’ensemble, uniquement vocal à l’exception du soutien discret de l’orgue de Marina Lopez, revient judicieusement sur la filiation entre les deux compositeurs, intimement liée à leur carrière romaine. Car avant toute chose, il faut souligner que le parcours de Victoria fait plus que croiser celui de Palestrina. Après une formation initiale ibérique, notamment comme chantre de la cathédrale d’Avila, Tomas Luis de Victoria est envoyé, une fois sa mue effectuée, à Rome, d’abord au Collège Germanicum, puis au Collegio Romano, où il fait la connaissance et étudie avec les deux fils de Palestrina, puis avec leur père, dont il reçoit très probablement l’enseignement, développant à ses côté son art du contrepoint et de la rythmique. En 1577, c’est d’ailleurs Tomas Luis de Victoria qui succède à Palestrina en qualité de Maître de Chapelle du Séminaire Romain. Il assiste aussi aux funérailles de Palestrina en 1594, avant de rentrer définitivement en Espagne l’année suivante et de s’établir à Madrid.
Cette belle mise en regard a permis de souligner les filiations entre les deux compositeurs, l’art de l’étagement des voix, la maîtrise notamment du double chœur. Elle en montre aussi les différences, les marques de personnalités : Cantoria révèle un Palestrina d’une ferveur intériorisée, tout en maîtrise, laissant son successeur poindre vers plus de couleur, d’individualité, voire plus d’excentricité. Un bel exemple de cette interprétation subtile nous en est donné avec l’Ave Regina caelorum a 8 de Tomas Luis de Victoria sur lequel le compositeur espagnol travaille des ruptures de rythmes marquées pour la musique de cette époque, tout en proposant un art consommé et élégiaque du contrepoint et des montées chromatiques aussi subtiles que tempérées du plus bel effet. A l’inverse, Palestrina, dans le Kyrie et le Gloria présentés en regard démontre une maîtrise polyphonique aussi souveraine que pleine de ferveur, une puissance pénétrante du chœur que rien ne semble pouvoir dévier de la délivrance d’une ferveur de tous les instants. A Palestrina la densité, l’épure subjuguante de la beauté et de la simplicité d’une introduction à trois solistes comme dans le Credo donné en suite de programme. A Tomas Luis de Victoria la dynamique, l’art de l’envolée et la hauteur de note observable dans son Alma redemptoris a 8, ces deux œuvres, mises à la suite en milieu de programme pouvant s’entendre comme deux manifestes des personnalités des compositeurs et d’un Tomas Luis de Victoria qui semble avoir tout assimilé de son maître, et qui ne se résignant pas à le copier cherche dans de nouvelles sonorités un dépassement, une nouvelle échappée. Un chœur angélique de Palestrina, sur son Sanctus-Benedictus, un Ave Maria a 8 de Tomas Luis de Victoria d’où s’échappe les voix solistes masculines comme la porte ouverte vers de nouveaux horizons. L’ensemble Cantoria, où nous retrouvons avec plaisir la belle voix de soprane de Inès Alonso et celle d’alto d’Oriol Guimera, ainsi que la personnalité attachante de Jorgue Losana délivre avec ce programme un très bel hommage aux pages vaticanes de la musique de la fin de la Renaissance dans ses déclinaisons tant romaines qu’ibériques.
A suivre,
Pierre-Damien HOUVILLE
Étiquettes : Bowden Charlotte, Cantoria, Cappella Mediterranea, Contaldo Valerio, Garcia-Alarcon Leonardo, Haendel, Hymas Hugo, Lijas Staffan, Palestrina, Pierre-Damien Houville, Tomas Luis de Victoria Dernière modification: 5 octobre 2025