|
mise à jour
6 janvier 2014
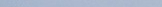
Editorial
Brèves
Numéro du mois
Agenda
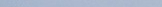
Critiques CDs
Critiques concerts
Interviews
Chroniques
Tribune
Articles & Essais
Documents
Partitions
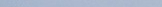
Bibliographie
Glossaire
Quizz
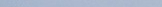
| | L'éclairage
à l'époque baroque : bougies, chandelles, lampes à huile

L'Opéra de Versailles. D.R.
Fiat lux !
 L'Opéra royal de Versailles était éclairé par environ 2000
bougies chaque soir de représentation. Quant on sait que le prix d'une
bougie blanche - réservée au culte ou aux grandes occasions en présence du Roi -
équivalait au salaire hebdomadaire d'un ouvrier, on saisit mieux la ravissement
des contemporains devant cette débauche de lumière. La bougie elle-même est
faite d'une mèche de coton enrobée de cire d'abeille, la jaune étant de qualité
inférieure. L'Opéra royal de Versailles était éclairé par environ 2000
bougies chaque soir de représentation. Quant on sait que le prix d'une
bougie blanche - réservée au culte ou aux grandes occasions en présence du Roi -
équivalait au salaire hebdomadaire d'un ouvrier, on saisit mieux la ravissement
des contemporains devant cette débauche de lumière. La bougie elle-même est
faite d'une mèche de coton enrobée de cire d'abeille, la jaune étant de qualité
inférieure.
 Un mode d'éclairage plus frustre est constitué par les
chandelles. Il s'agit cette fois d'une mèche de lin trempée dans du soif
(gras de mouton et graisse de bœuf) épaissi à la farine et ensuite durci à
l'air. Le grand inconvénient est que le combustible brûle plus vite que la mèche
qui devient charbonneuse. La chandelle s'éteint alors au bout d'un moment.
Aussi, des garçons coiffeurs munies de mouchettes (ciseaux à réservoirs) doivent
"moucher" habilement les chandelles environ toutes les 20 minutes. Il faut
ajouter à cela une odeur assez désagréable. Un mode d'éclairage plus frustre est constitué par les
chandelles. Il s'agit cette fois d'une mèche de lin trempée dans du soif
(gras de mouton et graisse de bœuf) épaissi à la farine et ensuite durci à
l'air. Le grand inconvénient est que le combustible brûle plus vite que la mèche
qui devient charbonneuse. La chandelle s'éteint alors au bout d'un moment.
Aussi, des garçons coiffeurs munies de mouchettes (ciseaux à réservoirs) doivent
"moucher" habilement les chandelles environ toutes les 20 minutes. Il faut
ajouter à cela une odeur assez désagréable.
 Les décors, quant à eux, sont illuminés grâce à des lampes à
huile. Il en fallait 3000 pour l'Opéra de Versailles. Celles-ci se composent
d'une boîte en fer blanc étamé, munie de petits cylindres dans lesquels on
plantait une mèche de coton. Là-encore, cela ne va pas sans difficultés : la
lampe à huile demeure longue à allumer, a tendance à fumer, à chauffer et à
s'emballer. Les décors, quant à eux, sont illuminés grâce à des lampes à
huile. Il en fallait 3000 pour l'Opéra de Versailles. Celles-ci se composent
d'une boîte en fer blanc étamé, munie de petits cylindres dans lesquels on
plantait une mèche de coton. Là-encore, cela ne va pas sans difficultés : la
lampe à huile demeure longue à allumer, a tendance à fumer, à chauffer et à
s'emballer.
V.L.N. 
|
Mini-Glossaire, d'après bougiesland.com
|
 Bobèche
Bobèche |
n.f. (de bobine).
Disque (de verre, de métal, etc) adapté à un bougeoir pour
arrêter les coulures de bougie fondue. |
|
 Bougeoir
Bougeoir |
n.m. (de bougie).
Petit chandelier sans pied, muni d'un anneau ou d'un manche. |
|
 Bougie
Bougie |
n.f. (de Bougie,
Bejaia ville d'Algérie d'où l'on exportait beaucoup de
cire).
Bâtonnet cylindrique de cire, de paraffine, etc., entourant
une mèche et fournissant une flamme qui éclaire.
Anciennement, unité de mesure d'intensité lumineuse
(aujourd'hui candela). |
|
 Candélabre
Candélabre |
n.m.(latin :
candelabrum, de candela, chandelle)
Chandelier ou flambeau à plusieurs branches.
Lampadaire de voie publique. |
|
 Chandeleur
Chandeleur |
nf (du latin festa
candelabrum, fête des chandelles) Fête catholique
(2 février) de la présentation de Jésus au Temple et de la
purification de la Vierge. |
|
 Chandelier
Chandelier |
n.m. (latin
candelabrum) Support, spécialement support muni d'une
pointe, pour les bougies, les cierges, les chandelles.
Chandelier Pascal : candélabre qui reçoit le cierge Pascal.
Personne qui fabrique ou vend des chandelles. |
|
 Chandelle
Chandelle |
nf (du latin candela)
tige de suif, de résine ou d'une autre matière inflammable
entourant une mèche, utilisée autrefois pour l'éclairage. |
|
 Cire
Cire |
nf. (du latin, cera)
Cire d'abeille, substance grasse et fusible, de couleur
jaune, sécrétée par les glandes cirières des abeilles
ouvrières, qui en font les rayons de leur ruche. |
|
 Eteignoir
Eteignoir |
n.m. Petit cône
métallique dont on coiffe les bougies ou les chandelles pour
les éteindre. |
|
 Lampion
Lampion |
nm. Lanterne
vénitienne ; Cylindre ou sphère de papier plissé... bougie
qui brûle à l'intérieur d'un lampion, selon Le Petit Robert
ou encore « petit récipient contenant une matière
combustible et une mèche qui sert aux illuminations » selon
Le Petit Larousse Illustré. Aujourd'hui ce terme a dérivé,
des termes « marketing » sont nés et « lampions » est
souvent utilisé pour désigner des photophores ou même pour
des bougies qui ont la forme d'un « cylindre de papier
plissé » |
|
 Lumignon
Lumignon |
nm (du latin, lumen,
luminis, lumière) Bout de la mèche d'une bougie allumée,
petit morceau de chandelle, ou encore lampe qui diffuse une
lumière faible. |
|
 Lustre
Lustre |
(de l'italien, lustro,
lumière) Appareil d'éclairage décoratif suspendu au plafond.
Mais encore : Eclat brillant de quelque chose ; poli. Ou
encore : Eclat, relief. Comme le lustre mondain.
|
|
 Mèche
Mèche |
nf. Assemblage de
fils, cordon, tresse employés dans la confection des bougies
ou pour servir à conduire un liquide combustible dans un
appareil d'éclairage. |
|
 Moucher
Moucher |
v.t. enlever la
partie carbonisée d'une mèche.
« Elle n'était pas laide, quoique si maigre et si sèche
qu'elle n'avait jamais mouché de chandelle avec les doigts
que le feu n'y prit. »
SCARRON, le Roman comique. |
|
 Mouchette
Mouchette |
n.f. ciseaux pour
moucher les chandelles.
Improprement utilisé pour les éteignoirs. |
|
 Ozocérite
Ozocérite
ou Ozokérite |
nf (du grec ozein,
exhaler une odeur, et keros, cire) en Chimie, hydrocarbure
naturelle semblable à la cire d'abeille. Synonyme :paraffine
naturelle. |
|
 Paraffine
Paraffine |
nf (du latin parum
affinis, qui a peu d'affinité) substance blanche faite d'un
mélange d' hydrocarbures saturés solides caractérisés par
leur indifférence aux agents chimiques, utilisée notamment
dans la fabrication des bougies et de certains emballages. |
|
 Photophore
Photophore |
nm. Coupe décorative
en verre, destinée à recevoir une bougie ou une veilleuse |
|
 Stéarine
Stéarine |
nf (du grec) Corps gras, principal constituant des graisses
animales.
Le chimiste Michel-Eugène Chevreul (1786-1889) publie
en 1823 un ouvrage : « recherches chimiques sur les corps
gras d'origine animale » où il expose la première théorie
scientifique de la saponification. Conséquence pratique :
l'invention de bougies en stéarine qui viennent dès 1825
remplacer les chandelles de suif. |
|
 Suif
Suif |
nm. graisse d'animaux
herbivores, composée de plusieurs glycérides (stéarine,
margarine et oléine) utilisée pour la confection de
chandelles. |
|
Pour en savoir plus sur l'histoire
de la bougie :
http://www.bougiesland.com/index.phtml?lang=fr&mode=secr
|
![]() -
-
![]()