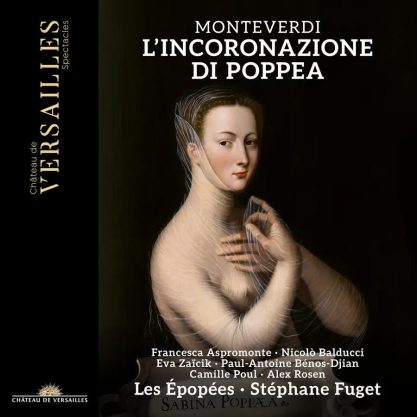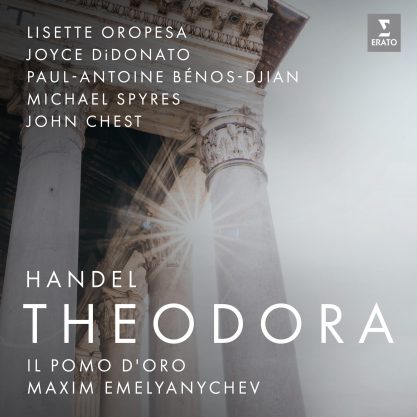Kathryn Lewek – site officiel de l’artiste
Georg Friedrich HAENDEL
Alcina
opéra en 3 actes (HWV 34) sur un livret anonyme (Antonio Marchi ?),
d’après l’Orlando Furioso de l’Arioste, créé à Londres le 16 avril 1735, pour la première saison du théâtre de Covent Garden
Kathryn Lewek | Alcina
Carlo Vistoli | Ruggiero
Lauranne Oliva | Morgana
Katarina Bradić | Bradamante
Zachary Wilder | Oronte
Nicolas Brooymans | Melisso
Ensemble Artaserse
Philippe Jaroussky | direction
Version de concert, Théâtre des Champs-Elysées, Paris, 5 novembre 2025
La saison 1734-1735 de Covent Garden demeure l’un des âges d’or de Haendel : l’arrivée de la danseuse Marie Sallé, la création d’Ariodante et d’Alcina — deux gemmes du même niveau que le génial Giulio Cesare, composé une décade auparavant et que Philippe Jaroussky avait dirigé, en ce même TCE en 2022, dans une interprétation inspirée et puissante, avec la mise en scène sophistiquée de Damiano Michieletto. Le Saxon, bouté de son théâtre par l’Opéra de la Noblesse, se réfugie à Covent Garden grâce à John Rich, mais bénéficie alors de deux opportunités : la présence d’un chœur ce qu’un théâtre quotidien pouvait seul offrir, et celle de la troupe de ballet français de Marie Sallé. Alcina partagera ainsi quelques traits avec la tragédie lyrique à la française, d’autant plus que les danses sont composées principalement dans ce style (Haendel réutilisera celles des Songes d’Ariodante).
Philippe Jaroussky, à la tête de son Ensemble Artaserse, propose une version de concert d’Alcina : dépouillée, révisée, allégée — peut-être trop. La partition subit en effet d’importantes amputations : disparition du rôle d’Oberto (ce qui amoindrit la noirceur d’Alcina et nous prive de trois charmants airs), suppression intégrale des danses et des chœurs. Le drame y perd une dimension essentielle — celle de la cruauté et du vertige collectif — pour ne garder que le triangle amoureux et ses éclats d’intimité. Le sortilège s’y contracte, l’île d’Alcina devient salon à marivaudage. On songe aux reprises londoniennes de 1736-1737 où Haendel, cédant aux contraintes, dut rogner son œuvre, et l’on regrette qu’une version plus complète, à la fois plus satisfaisante musicalement comme dramatiquement, n’ait pas été choisie, à l’instar de l’option choisie par Marc Minkowski, voire même Richard Hickox.
Jaroussky dirige son ensemble avec une élégance féline : on admire le geste souple et précis, l’écoute constante, l’attention scrupuleuse à la ligne vocale. Les da capos, sans doute élaborés par le chef, sont à la fois cohérents, virtuoses et d’un goût très sûr, évitant à la fois l’écueil de la démonstration gratuite, comme celui de l’exercice laborieux d’ornements.
Hélas le son d’Artaserse reste relativement terne, nourri par les cordes (quelques soucis d’intonation du premier violon à relever), sans les chatoyances instrumentales accoutumées. Où diable sont passés les hautbois et le basson, et les flûtes à bec quasi inaudibles ? Leur quasi-absence prive la texture instrumentale de couleurs vaporeuses. À l’inverse, la basse continue, confiée à un quatuor musclé (violoncelles, archiluth, deux clavecins, deux violones), s’affirme avec une énergie féroce mais monochrome. Cette pulsation constante, d’abord grisante, finit par uniformiser les climats, d’autant que les tempi sont allants. Une petite surprise vient du final : le Ballo clôt la représentation, sans le chœur conclusif « Dopo tante amare pene », donné ensuite en bis. Un choix presque espiègle, mais qui laisse l’impression d’un épilogue inachevé.
Sur scène, deux artistes dominent nettement le plateau vocal : d’abord, la prima donna. Kathryn Lewek, ex-Reine de la Nuit, s’avère impériale dès son entrée : présence souveraine, gestes assurés, souffle dramatique. Sa lecture est celle d’une magicienne blessée, d’une grande noblesse, d’une rage émoussée. Dans « Ah! mio cor », son désespoir à fleur de peau émeut ; les aigus s’embrasent, le da capo se déploie avec une hardiesse aérienne et crépusculaire. Si le timbre conserve par instants une acidité métallique, il n’en demeure pas moins d’une intensité saisissante. L’artiste ose le risque, la brisure, l’excès, et la magicienne est avant tout une amante trahie et sans lucide quant à un amour à sens unique.

Carlo Vistoli (dans le même rôle mais sous la houlette de Rinaldo Alessandrini dans une mise en scène de Pierre Audi en mai 2025) – site officiel de l’artiste
Face à elle, Carlo Vistoli incarne un Ruggiero d’une rare complexité. Loin du guerrier falot, il sculpte un personnage traversé par la contradiction et plus déplaisant que d’habitude : c’est un enfant gâté, irascible et hésitant, sujet à des sautes d’humeur, et dont l’indécision et la mollesse tangentent l’égoïsme. Victime consentante des sortilèges d’Alcina, époux infidèle prix la main dans le sac, chevalier qui prend la poudre d’escampette. Carlo Vistoli (qui serait parfait en Tolomeo chez César) campe un portrait d’anti-héros à rebours, avec une suprême agilité jouissive. Les double croches fusent avec netteté, la projection explose. Le « Sta nell’Ircana » accompagné de ses cors naturels boisés (sans correction pavillonnaire, bravo !) vire aux irrésistibles montagnes russes, étincelant de virtuosité et de vigueur conquérante. Mais on saura aussi le surprendre dans le « Mi lusingha » (un peu pressé) ou le « Verdi prati » rêveur et mélancolique, révélant une profondeur insoupçonnée. Là, Vistoli murmure plus qu’il ne chante, dessinant un adieu introspectif, teinté d’amertume et de lucidité.
Parmi les autres protagonistes, la Morgana de Lauranne Oliva a été inégale : après un départ un peu faiblard : timbre uniforme, souffle court, phrasé haché, l’artiste se libère progressivement. Dans les airs vifs du second acte, la voix se colore d’esprit et d’ironie, retrouvant une légèreté mutine qui fait le charme de ce personnage versatile.
Katarina Bradić, en revanche, peine à exister. Sa Bradamante, trop discrète, souffre d’une émission métallique et d’une diction floue ; son duo avec Ruggiero manque d’alchimie. Zachary Wilder campe un Oronte honnête mais fatigué : les vocalises s’émoussent, le timbre se nasalise à mesure que la soirée avance. Quant à Nicolas Brooymans (Melisso), sa belle voix grave et chaleureuse se heurte à une approche un peu laborieuse et très appliquée. Oberto, on l’a déjà dit, passe à la trappe.
L’urne brisée, les amants séparés, après les copieux applaudissements, subsiste de cette Alcina un sentiment d’inachevé : le charme a agi par intermittence, mais le duo d’amants maudits formé par Kathryn Lewek et Carlo Vistoli — flamme et cendre — illumina la soirée, tandis que Jaroussky, en alchimiste complice nous a offert une Alcina sans fard quoique sans faste, d’une sobriété terriblement humaine.
Viet-Linh Nguyen
Étiquettes : Bradić Katarina, Brooymans Nicolas, Ensemble Artaserse, Haendel, Jaroussky, Lewek Kathryn, Oliva Lauranne, opéra, Théâtre des Champs-Élysées, Vistoli Carlo, Wilder Zachary Dernière modification: 13 novembre 2025