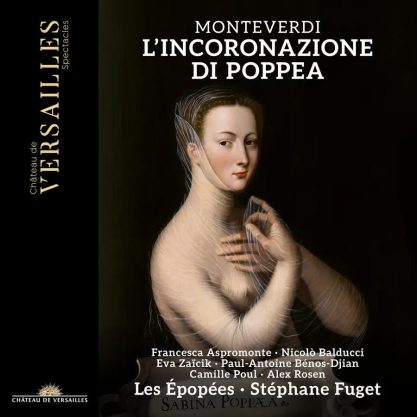Pierre Gaultier de Marseille, Symphonies divisées par suites de tons
Suite en G ré sol Bémol (1) Suite en G ré sol Bémol (2) Suite en C sol ut Suite en G ré sol Bécarre Suite en C sol ut Bémol Suite en C solu ut Bémol & Bécarre Suite en F ut fa Suite en D la ré Bémol & Bécarre Suite en D la ré
Cohaere Ensemble : Marta Gawlas, flûte Marta Korbel, violon Monika Hartmann, violoncelle Natalia Olczak, clavecin et orgue
1 CD digipack, Ambronay Editions, 2025, 69’
 Certains compositeurs restent à exhumer de l’anonymat le plus complet dans lequel ils sont tombés. C’est le cas de Pierre Gaultier [ou Gautier] de Marseille (1642-1696), qui n’eut que très rarement le privilège de voir un disque entier consacré à ses œuvres, à l’exception notable d’excellentes Symphonies nobles et colorées par Hugo Reyne et sa Simphonie du Marais il y a de cela déjà plus de vingt-cinq ans (Astrée, 1999). Et si Les Festes d’Orphée ou plus récemment Les Musiciens de Saint-Julien ont interprété quelques-unes de ses œuvres au cours de leurs différents programme, Gaultier de Marseille reste encore largement méconnu. oublié dans d’un paysage musical encore très largement centré sur Paris et la cour de Versailles en cette fin de XVIIème siècle, qui a tendance à rejeter dans les limbes les musiciens dont la carrière s’est essentiellement déroulée dans les provinces du royaume. Pour rester dans le champ des compositeurs de la fin du Grand Siècle et méridionaux, nous pourrions citer également Jean Audiffren (1680-1762) ou encore Guillaume Poitevin (1646-1706), ce dernier étant été le professeur lors de leurs apprentissages des plus connus Jean Gilles (1668-1705) et André Campra (1660-1744), tous ayant comme dénominateur commun d’être nés en Provence.
Certains compositeurs restent à exhumer de l’anonymat le plus complet dans lequel ils sont tombés. C’est le cas de Pierre Gaultier [ou Gautier] de Marseille (1642-1696), qui n’eut que très rarement le privilège de voir un disque entier consacré à ses œuvres, à l’exception notable d’excellentes Symphonies nobles et colorées par Hugo Reyne et sa Simphonie du Marais il y a de cela déjà plus de vingt-cinq ans (Astrée, 1999). Et si Les Festes d’Orphée ou plus récemment Les Musiciens de Saint-Julien ont interprété quelques-unes de ses œuvres au cours de leurs différents programme, Gaultier de Marseille reste encore largement méconnu. oublié dans d’un paysage musical encore très largement centré sur Paris et la cour de Versailles en cette fin de XVIIème siècle, qui a tendance à rejeter dans les limbes les musiciens dont la carrière s’est essentiellement déroulée dans les provinces du royaume. Pour rester dans le champ des compositeurs de la fin du Grand Siècle et méridionaux, nous pourrions citer également Jean Audiffren (1680-1762) ou encore Guillaume Poitevin (1646-1706), ce dernier étant été le professeur lors de leurs apprentissages des plus connus Jean Gilles (1668-1705) et André Campra (1660-1744), tous ayant comme dénominateur commun d’être nés en Provence.
Et ce sont quatre jeunes musiciennes originaires de Pologne qui nous invitent aujourd’hui à la remise en lumière de l’œuvre de Pierre Gaultier de Marseille, musiciennes réunies au sein de l’Ensemble Cohaere dont nous avions parlé à l’occasion du concert donné par l’ensemble lors de la dernière édition du Festival d’Ambronay, que le présent enregistrement prolonge. Est-ce tout à fait un hasard si les plaines de Pologne furètent du côté des calanques de Marseille ? Peut-être pas tant que cela quand on sait l’intérêt porté par nombre de Polonais pour la culture française et les liens diplomatiques et culturels entre les deux nations au moins depuis les temps glorieux du plein essor de la musique baroque. L’Ensemble Cohaere ressuscite donc ces Symphonies divisées par suite de tons, publiées de manière posthume en 1707, par l’incontournable éditeur et imprimeur Christophe Ballard, détenteur du privilège royal sur les partitions, sous le titre de Symphonies de Feu Mr Gaultier de Marseille, divisées par Suites de tons. Nous ne résistons pas à retracer brièvement la vie mouvementée de Gaultier, tant elle mériterait une biographie, voire un roman d’aventures épique, le Sieur de Marseille croise ainsi Mademoiselle de Maupin ! Né en Provence, à La Ciotat, Pierre Gaultier vient parfaire son apprentissage musical à Paris auprès de grands maîtres : d’abord Jacques Champion de Chambonnières. Il s’en retourne ensuite à La Ciotat avant de revenir à Paris pour un second séjour au cours duquel il approfondit l’art de la composition auprès de Lully. Revenu à Marseille en 1681, il obtient en 1685 le rare privilège de la part du Surintendant de créer à Marseille une maison d’opéra indépendante. Ces fonctions tant de musicien que de producteur de spectacle l’amènent à monter les premières représentations d’opéras dans nombre de cités provençales (Toulon, Aix-en-Provence, Arles, Avignon, Montpellier notamment) participant ainsi à la diffusion des œuvres de ses contemporains, comme des deux œuvres qu’il compose pour le genre Le Triomphe de la Paix et Le Jugement du Soleil, œuvres hélas perdues. C’est sans doute dans le cadre de ces représentations qu’il dû faire appel à la jeune Mademoiselle de Maupin. Mais hélas, hier comme aujourd’hui, tenir une maison d’opéra n’est pas une sinécure, et rapidement Pierre Gaultier de Marseille, qui s’est allié en affaire avec son frère, croûle sous les dettes, ce qui lui vaut un séjour dans les prisons d’Avignon en 1688. A l’ombre, il ne délaisse aucunement la musique ; nous en trouvons trace dans la Suite en C sol ut Bémol & Bécarre, pièce à la tonalité d’une grande tristesse dont le prélude, on ne peut plus clairement titré Les Prisons, mentionne sur la partition que “L’auteur composa cette pièce dans les prisons d’Avignon”. A cette pièce fait suite avec la même gravité une Suite des Prisons, avant qu’une courte Marche à la tonalité un peu plus joyeuse ne vienne conclure l’œuvre. Persistant à tenter de faire de la cité phocéenne un pôle lyrique du royaume dans ce qui ressemble à une première esquisse de décentralisation culturelle, Gaultier s’engage dans de nouvelles productions, conduisant à de nouvelles dettes. En 1696, alors qu’a priori il quitte Montpellier en bateau en compagnie de son frère et d’une partie de sa troupe, l’équipage est pris dans une tempête et les deux frères trouvent tragiquement la mort dans le naufrage du navire, au large de Sète, laissant à Ballard le privilège de publier à titre posthume les pièces auxquelles s’intéressent l’Ensemble Cohaere. Si la composition de l’une d’elle est facilement datable, les autres compositions sont plus difficiles à situer dans la courte vie du compositeur, même si le fait qu’elles ne furent publiées qu’après sa mort peuvent laisser penser qu’elle datent des dernières années de sa vie, la relative variété des formes musicales adoptées et les variations importantes de tonalité de composition et de complexité des partitions peut laisser supposer que ces pièces furent composées sur de nombreuses années, reflétant à la fois les évolutions du goût et de la maîtrise technique de Gaultier de Marseille.

François Puget (1651-1707), Réunion de Musiciens (1688). Huile sur toile, 147 x 212 cm. Collections du Musée du Louvre. Portrait supposé de Pierre Gaultier de Marseille (au théorbe). A moins qu’il ne s’agisse de Lully et du librettiste Philippe Quinault. Source : Wikimedia commons
Cependant, si certaines pièces sont dignes du plus grand intérêt, démontrant une grande variété des formes présentées, à l’exemple de l’introductive Suite en G ré sol Bémol à la belle ouverture portée par la flûte boisée et grave de Marta Gawlas, puis après le prélude, à une belle ritournelle sur laquelle s’accordent joliment la ligne de violon de Marta Korbel et la ligne de flute, les deux soutenues par un continuo des plus charmant (quoiqu’on eut préféré une viole au violoncelle de Monika Hartmann), d’autres sont marquées par davantage d’académisme, à l’exemple de la Suite en G ré sol Bécarre (dont on notera tout de même un dernier mouvement original, les Matelots) plus convenue. Par ailleurs, en ce qui concerne les effectifs, il n’est pas exclu de penser que ces Symphonies furent aussi composées pour pouvoir être jouées à deux violons ou à deux flûtes ; les musiciennes reconnaissent d’ailleurs avoir procédé à un certain nombre d’ajustements, que ce soit dans l’exécution des différentes lignes musicales tout comme dans la place donnée au continuo, ce qu’elles ont réalisé avec goût. Nous retrouvons dans ces compositions nombre de formes habituelles de la musique française de la fin du siècle, à l’exemple des Marche, Sarabande, Passacaille, Gavotte et autre Menuet, Pierre Gaultier de Marseille se distingue par l’usage fréquent de l’utilisation de rythmes issus du folklore populaire du sud de la France, à l’exemple du Rigaudon, à l’origine un rythme de danse provençale, même si celui-ci fera des émules jusque dans les compositions de Charpentier (David & Jonathas), ainsi que chez Rameau, Lully, ou du provençal André Campra. Cette porosité des rythmes populaires dans la musique de Gaultier de Marseille semble tout de même plus prégnante que chez nombre de ses contemporains, mais qui ne doit pas éluder la capacité du compositeur à transmettre des émotions plus abstraites, des sentiments plus intériorisés que les musiciennes rendent avec sensibilité et douceur, que ce soit dans la belle symphonie introductive de la Suite en C sol ut Bémol, ainsi que dans un Sommeil assez ambitieux en conclusion de cette même suite, ainsi dans les pièces très évocatrices de la Suite en D la ré Bémol & Bécarre, du mouvement introductif, la Tendresse, aux magnifiques lignes de violons, tendres et mélancoliques, des Regrets et de la Suite des Regrets. L’interprétation de l’Ensemble Cohaere, qui peut parfois encore gagner en relief et en fluidité, que ce soit sur le violon comme sur la flûte, convainc à remettre sur le devant de la scène ces intéressantes pièces, seul héritage musical de Pierre Gaultier de Marseille, nous emportant loin de Paris pour une charmante plongée dans l’œuvre de ce compositeur pour qui Sète fut, bien avant Valery, un cimetière marin.
Pierre-Damien HOUVILLE
Technique : enregistrement transparent, un peu sec.
Étiquettes : Ambronay éditions, Cohaere Ensemble, Gaultier de Marseille Pierre, Muse : argent, Pierre-Damien Houville Dernière modification: 13 novembre 2025