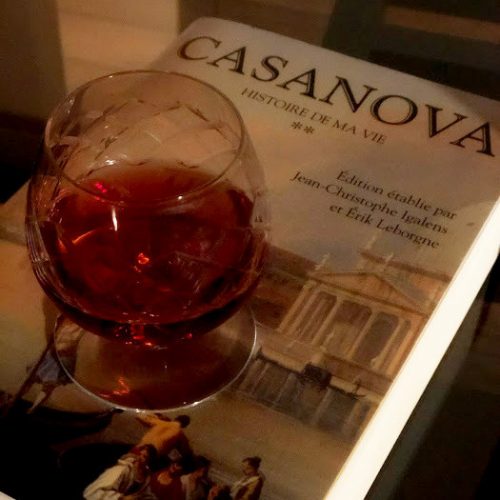Brève relation sur une escale à Grenoble et un alcool oublié

© Muse Baroque, 2020
Août 1760, en provenance des cantons suisses où il rencontra Voltaire et après avoir fait escale à Chambéry pour y changer d’attelage, Casanova arrive à Grenoble, avec la ferme intention d’y rester une huitaine. Que vient-il y faire ? Le Vénitien sait souvent se montrer obscure sur les réelles raisons de ses voyages de futiles motifs cachant souvent un affairisme plus ou moins honnête…il y a du Beaumarchais chez Casanova !
S’étant découvert une soudaine passion pour l’occultisme et l’astrologie depuis sa rencontre quelques années plus tôt avec l’excentrique et peu farouche Madame d’Urfé, elle même très portée sur ces domaines, Casanova a été recommandé par cette dernière au Baron de Valenglard, qu’une mémoire s’étiolant au fil des ans le fait parfois orthographier Valenglar. Capitaine de régiment en garnison dans la capitale des alpes, Valenglard était un ami de Mme d’Urfé, un ancien amant de sa fille, la Duchesse d’Estouteville, et un homme capable d’introduire notre vénitien auprès de toute la bonne société grenobloise.
Grenoble en ce milieu de dix-huitième siècle reste une petite ville provinciale, encore engoncée dans des remparts la protégeant des crues du Drac et de l’Isère, au centre-ville d’une austérité un peu montagnarde, et que Jacques Vaucanson (1709-1782), célèbre en cette époque pour ses automates, a déjà déserté. Sitôt Valenglard rencontré et peu satisfait de son auberge, Casanova se fait recommander une maison en vente à l’extérieur de la ville, dont il loue un logement de trois pièces. Il pose donc ses malles à La Tronche, commune appréciée de la bourgeoisie et de la noblesse pour ses grandes propriétés arborées et lumineuses, très probablement au mas de Saint-Ferjus (ou domaine de la Merci), future propriété de Joseph-Marie Barral (1742-1828), premier Maire de Grenoble durant la période révolutionnaire, et dont le bâtiment principal subsiste, actuel centre administratif de la faculté de médecine et de pharmacie.

Très à l’aise financièrement en cette époque et ne regardant pas à la dépense, Casanova s’empresse de commander moult victuailles au concierge de son logement, tout en essayant durant le séjour, et semble-t-il assez vainement, d’obtenir de concert les faveurs de ses trois filles. Soucieux de paraître et de se faire connaître, Casanova cultive l’art du dîner, au cours duquel il se fait servir « des vins exquis et au dessert du ratafiat supérieur au visnat des turc que j’ai bu chez Josouf Ali dix-sept ans auparavant » (cf. son séjour à Constantinople de 1743). Ravi, Casanova se montre d’humeur flatteuse, affirmant à son hôte qu’il mériterait d’être le premier cuisinier de Louis XV et précise que la conversation s’éternise et que les convives restent à table jusqu’à plus de onze heures « causant et vidant une bouteille de la divine liqueur de Grenoble ». Élixir divin à ses papilles, dont il va jusqu’à donner la recette, « composée d’eau de vie, de sucre, de cerises et de cannelle ». Le breuvage l’enchanta, au point de laisser entendre qu’il en fit une consommation fréquente durant les quelques soirées de son séjour.
Avouons-le, l’arpenteur contemporain des établissements de boissons des bords de la place Grenette ou du boulevard Alsace-Lorraine aura le plus grand mal à se faire servir du ratafia de cerise. C’est oublier un peu vite que cette boisson, avant de tomber dans un anonymat distingué, participa à la renommée de la ville durant une grande partie du dix-huitième siècle. Pourtant, en contournant la ville par la rocade sud de la ville, ce qui a comme avantage de vous rendre immédiatement nostalgique de l’époque des calèches et des platanes de bords de grands chemins, vous ne pouvez manquer d’avoir le regard attiré par une enseigne, donnant aussi son nom à l’un des quartiers de la ville : Teisseire…un fabriquant de sirop ayant connu le succès à la fin des années 1950 grâce à son bidon métallique léger et solide, et donc parfaitement capable de se lancer à l’assaut des naissantes enseignes de grande distribution de la France du Général de Gaulle. Mais ceci est une autre histoire, qui risquerait de nous égarer. Au commencement était Mathieu Teisseire liquoriste originaire de Belgentier (Var), qui fonde en 1720 à Grenoble une distillerie et commence à produire un ratafia de cerise au succès immédiat qui fera sa renommée et sa fortune, introduisant la famille pour longtemps dans la bourgeoisie locale, son petit-fils Camille terminant député de l’Isère entre 1820 et 1823, après une carrière remarquée dans la politique locale durant la période révolutionnaire.
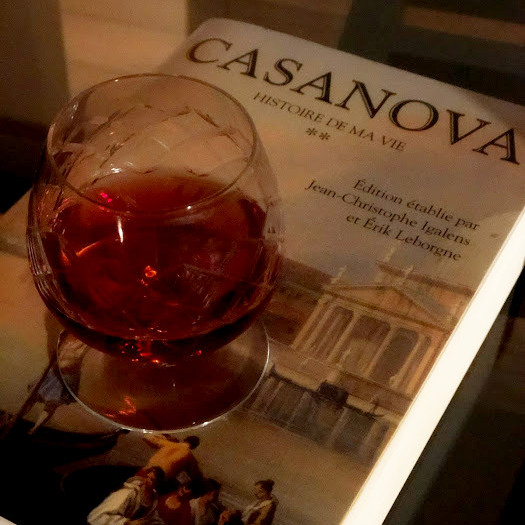
© Muse Baroque, 2020
Mais à quoi pouvait bien ressembler ce ratafia, tant vanté par notre aventurier vénitien ? De nos jours, le breuvage est passé de mode et seuls subsistent des ratafias de raisins, en champagne et en bourgogne, mais aussi de fruits dans le sud ouest, auxquels Pierre Perret rend un hommage discret dans sa chanson, Je suis de Castelsarazin. Le procédé de base est assez simple, consistant en une macération de fruits, de sucre et d’alcool, ce dernier ayant pour particularité de conserver le fruit. A chaque distillateur ensuite de préciser ses proportions, et de l’aromatiser. Casanova nous précise que celui qu’il boit contient des extraits de cannelle. Mathieu Teisseire utilisait pour la confection de son breuvage une petite cerise locale noire et juteuse, dont le nom a avec le temps pris le nom de la boisson, la cerise ratafia. Bien acclimatée au terroir relativement clément du sud de la vallée du Gresivaudan (St-Hilaire du Rosier en particulier) et de la vallée de l’Isère entre Grenoble et Saint-Marcellin, cette cerise conserve à la dégustation un ton aigre-doux la rendant peu attractive en fruit de table. D’où son utilisation privilégiée en sirops ou en ratafia.
Le ratafia, les filles de son concierge et quelques rencontres finalement assez futiles liées à son goût opportun pour l’astrologie semblent les seules choses intéressant vraiment notre noble vénitien lors de son séjour dans la capitale des alpes, oubliant complètement de décrire la ville ou encore les massifs montagneux aux alentours, et ne semblant pas devoir rendre hommage à la Chartreuse (verte bien entendu) pourtant connue depuis le début du dix-septième siècle et cela même si sa réelle commercialisation ne débute qu’en 1764, soit quatre ans après le passage de Casanova à Grenoble. Ses rencontres avec quelques personnalités locales de l’époque pourront ravir les érudits contemporains de l’histoire de Grenoble, mais dans l’ensemble le chapitre se révèle assez pauvre pour cerner la Grenoble du dix-huitième siècle. Notons toutefois que Casanova dépense une petite fortune dans plusieurs paires de gants, autre industrie prospère de la ville qui verra son apogée après le milieu du dix-neuvième siècle et elle aussi pratiquement disparue.

La marque Teisseire a connu comme toute entreprise multiséculaire les vicissitudes des mutations des goûts et des modes et ne produit plus depuis des décennies de ratafia de cerise. Seul subsiste dans son catalogue un sirop de cerise ratafia, non alcoolisé, très bon mais bien lointain du produit original. Ayant à cœur de poursuivre ces intéressantes investigations, la rédaction de Musebaroque a finalement trouvé qu’au moins deux distilleries produisaient et commercialisaient un ratafia de cerise dans la région. L’une à Saint-Marcellin, sous l’appellation de ratafia de cerise et l’autre sous l’appellation de la marque à La Côte-Saint-André, charmant bourg au moins connu des mélomanes pour être la cité de naissance de Hector Berlioz. Validons-nous donc l’extase casanovienne ? Après une entrée en bouche un peu prononcée révélant un goût de sucre trop puisant pour nos papilles, le breuvage gagne en équilibre et en complexité, et s’avère au final très agréable et original. Nous le conseillons donc à servir frais mais pas glacé, par exemple sur une pâtisserie. Il agrémentera ainsi fort agréablement vos relectures de Casanova, votre consultation de la Muse, et même d’éventuelles péroraisons devant trois jeunes femmes.
Précisons que Casanova ne fut pas le seul écrivain à donner une célébrité posthume au ratafia de cerise. Quelques décennies après lui, Stendhal, de loin le plus grand écrivain originaire de la cité, y fit plusieurs allusions dans ses écrits et un développement plus important dans la Vie de Henry Brulard (1835-1836), ouvrage dans lequel il confesse son goût pour le ratafia, qu’il déguste lui en apéritif, occasion de savoir si vous êtes plutôt stendhalien ou plutôt casanovien, du moins en matière de ratafia.
Après quelques jours passés à Grenoble, c’est en bateau le long de l’Isère que s’éloigne Casanova, attendu en Avignon. Après avoir passé la cluse de Voreppe, où peut-être combattit Hannibal, Casanova aperçu sûrement sur les coteaux de la rive droite quelques cerisiers à ratafia. Entre Venise et Dux, il ne devait jamais plus séjourner à Grenoble.
Pierre-Damien HOUVILLE
Étiquettes : boissons, Casanova, Pierre-Damien Houville, vins et spiritueux Dernière modification: 7 décembre 2021