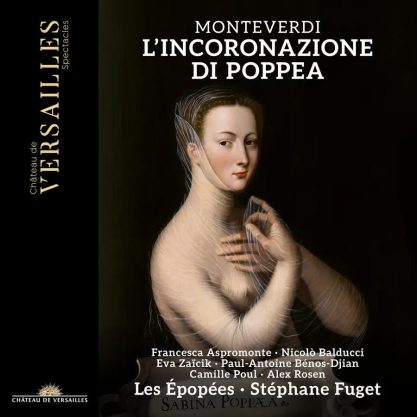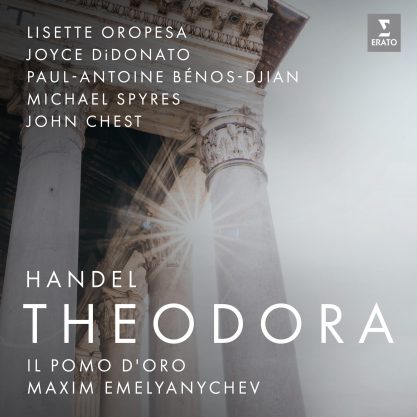“L’impérieuse humeur ! vois comme elle me brave,
Comme son fier orgueil m’ose traiter d’esclave.”
(Valens, Pierre Corneille, Théodore, Vierge et Martyre, II, 7, 1646)

© Muse Baroque, 2025
Georg Frederic HAENDEL
Theodora
oratorio en trois actes sur un livret de Thomas Morell, créé le 16 mars 1750 au Théâtre royal de Covent Garden à Londres
Lea Desandre | Theodora
Hugh Cutting | Didymus
Avery Amereau | Irene
Laurence Kilsby | Septimius
Alex Rosen | Valens
Orchestre et chœur Ensemble Jupiter
Thomas Dunford | direction
Version de concert, Théâtre des Champs-Élysées, Paris, 7 octobre 2025
Ce mardi 7 octobre, sur scène, l’Ensemble Jupiter est disposé en demi-cercle resserré autour de Thomas Dunford, tout de bleu vêtu, couleur qu’il affectionne. Son archiluth est là, presque un arc. Il va l’empoigner de temps à autre, tout en dirigeant, avec une énergie radieuse. Il faut dire que ce concert est particulier, comme nous l’expliquait le musicien lors de l’entretien qu’il nous a accordé, c’est la première fois que l’Ensemble Jupiter se pare des effectifs des grands jours : chœur et orchestre pour dépeindre le martyre de Sainte Theodora, princesse chrétienne d’Antioche refusant de sacrifier aux Dieux païens en l’honneur de l’Empereur, et vouée à servir de prostituée au Temple de Vénus… Sauvée par Didyme, officier romain converti, elle finira par se rendre pour le sauver du supplice, et tous deux périront ensemble, le Gouverneur d’Antioche, Valens, se révélant de bout en bout, un “méchant” intraitable et brutal, quoique laissant à chaque fois une porte de sortie aux Chrétiens dès lors qu’ils renient leur foi… Hélas, l’oratorio ne fut représenté que trois fois du vivant de Haendel, bien qu’il fut l’un de ses favoris. La faute sans doute au livret, excellent, mais qui tangentait vers l’oratorio dramatique voire l’opéra malgré une trame des plus simples, avec de superbes caractérisations psychologiques des personnages et du chœur.
Au TCE, temple de musique dont le hall et le bar ont été discrètement et élégamment rénovés, la lumière accompagnera la dramaturgie, enveloppant de teinte mordorée ou crue les protagonistes. Dès les premières mesures, le chœur s’impose comme colonne vertébrale de par son ampleur, sa précision, sa capacité à brosser les atmosphères, chantant entièrement sans partition. Les différents pupitres se fondent en une texture d’une rare netteté. Dans les fugues, les entrées sont d’une rigueur jubilatoire ; dans les grands blocs homophoniques, la densité vocale s’élève sans jamais saturer. Thomas Dunford, fidèle à son art du détail, modèle les plans sonores avec vivacité d’un geste de main, le chœur devient murmure (“Go, gen’rous, pious youth”), d’un autre, la masse se redresse, éclatante. Le “For ever blessed be thy name” est splendide.

Léa Desandre © site officiel de l’artiste
Le plateau vocal est inégal : 3 rôles superbes d’abord. La Théodora de Lea Desandre, dans sa robe drapée immaculée, incarne une sainte fière et sereine. La beauté et la profondeur du timbre, le sens du mot, l’intensité un peu monolithique (mais attend t-on autre chose d’une sainte ?)… La projection, contrôlée, sait se faire expressive avec une économie de moyens et une sobriété remarquables (“Oh thou bright sun”). Son duo final avec Didymus, “Streams of pleasure ever flowing”, atteint un miracle d’équilibre où co-existent l’amour et la foi.
Avery Amereau remplace Véronique Gens, souffrante, et campe magnifique Irène, vive et empathique. La soprane ne fait pas du personnage une sorte de soubrette confidente – comme trop souvent – mais un alter ego à Theodora, capable de débattre, de s’émouvoir. Plus sanguine et révoltée que la Chrétienne, le personnage apporte du mouvement à l’intrigue. On admire une voix veloutée et enveloppante, incroyablement souple dans le très attendu “As with rosy steps the morn advancing” qui avance vers l’aube avec éclat et confiance. L’émission est parfaitement soutenue, les phrasés naturels, d’une rare évidence.

Jan Luyken, Théodora échangeant ses vêtements avec Didyme pour s’évader gravure sur cuivre, vers 1712 – Source : Wikimedia Commons
Cruel parmi les cruels, le Valens d’Alex Rosen qu’est qu’intransigeance et fermeté. Binaire (conversion ou répression), la basse, ferme et puissante enferme son personnage dans le fonctionnaire borné et imbu de son pouvoir, d’une implacable rigueur. Les attaques sont franches, la diction incisive. Haendel a réservé au Gouverneur des airs hachés, sans lyrisme aucun. Pourtant Rosen parvient à subtilement instiller le doute sur l’humanité du Romain : ne tend t-il pas à plusieurs reprises des perches de salut (sacrifice aux Dieux, prostitution, conversion) en cherchant à éviter la mortelle condamnation le plus possible ? Certes, le fonctionnaire est arrogant et tyrannique, soumis à des accès de colère (livrer Theodora au plus vil de ses soldats si elle ne se soumet pas). Mais dans la scène finale, le librettiste fait de la double condamnation à mort le réflexe du juge offusqué de voir les accusés choisir leur sort, et qui sera crucifié. Il reprend alors la main avec rage. Cette analyse très subjective que nous livrons n’est possible que par le chant nuancé de la basse, d’une éloquence qui fait sortir ce Valens de la caricature de bourreau.

Alex Rosen © site officiel de l’artiste
Malheureusement, Hugh Cutting ne s’est pas montré au niveau de ses confrères (ah, le souvenir de David Daniels à Glyndebourne !). Le contre-ténor au vibratello fréquent, à l’émission faiblarde, à l’engagement vacillant a bien du mal à dépeindre un soldat héroïque et amoureux. La passion est sous le boisseau, la discrétion confine à l’effacement, et l’orchestre recouvre d’ailleurs souvent le chanteur. Reste une sorte d’innocence juvénile, (“Kind Heav’n, if virtue be thy care” édulcoré) et un moment de grâce fugitif : le duo précité avec Théodora, “Streams of pleasure ever flowing”, moment de complicité et de suspension temporelle. l’on passera également sur le Septimius de Laurence Kilsby tout aussi flegmatique.
Dans la fosse, l’orchestre de l’Ensemble Jupiter sait tonner : la basse continue pulse, les bassons et hautbois apportent leur halo tantôt pastoral tantôt martial, les flûtes sont d’une suavité sensuelle. Le chef sait sculpter avec relief les textures et les volumes, et bien que certains tempi soient un peu rapides à nos oreilles, la cohésion dramatique, le sens du phrasé, l’intelligibilité des situations sont d’une stupéfiante maturité. L’on regrettera toutefois la faiblesse des cuivres : trompettes et cors non naturels bidouillés avec les trous dans le tube pour corriger les soucis d’intonation mais une sonorité altérée. Passe encore la correction pavillonnaire anachronique (non pratiquée ici) mais cette solution de facilité – contrainte sans doute par les limites des interprètes – est à déplorer.
Ce soir-là, après une longue soirée entrecoupée de deux entractes, cette Theodora a concilier délice et supplice. Pour notre plus grand bonheur de mélomane.
Viet-Linh Nguyen
Étiquettes : Amereau Avery, Cutting Hugh, Desandre Lea, Dunford Thomas, Ensemble Jupiter, Haendel, Kilsby Laurence, oratorio, Rosen Alex, Théâtre des Champs-Élysées Dernière modification: 14 octobre 2025