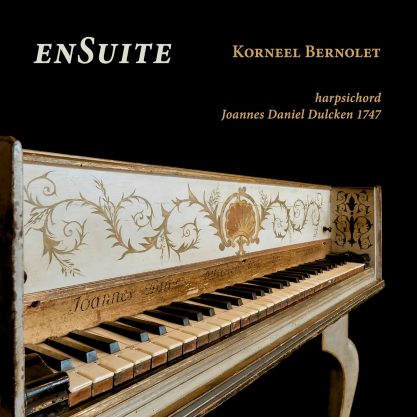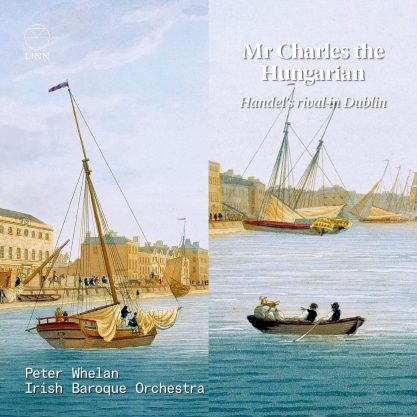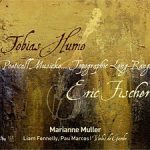Jean-Philippe RAMEAU (1683-1764)
Pièces de clavecin de 1741
 Noëlle Spieth, clavecin Emile Jobin (1983) d’après Goujon (1749)
Noëlle Spieth, clavecin Emile Jobin (1983) d’après Goujon (1749)
60′, Eloquentia, 2010.
[clear]
Nos lecteurs les plus assidus (et nous savons que vous existez) auront remarqué les délais impressionnants dans la parution d’ycelle critique. Votre serviteur, dont la fidélité et la dévotion à votre égard est, malgré ces apparences, inchangée, se doit d’alléguer plein de justifications si peu intéressantes qu’il ne le fera pas ici. Toutefois, il faut aussi avouer que la jaquette du disque ornée de la figure d’un Pierrot au teint devenu bien trop pastel par des retouches excessives ne pouvait que le faire frémir d’effroi. Cela étant évoqué, Richard O’Brien (entre autres) l’a dit, “Don’t judge a book by it’s cover”. Intéressons-nous donc plutôt à ce que contient cet écrin plutôt discutable: de la musique pour clavecin seul — car Noëlle Spieth s’essaie à ce que propose Rameau lui-même, et que seul avait déjà tenté Scott Ross, à savoir jouer ces pièces pour plusieurs instruments, en supprimant les parties des autres instruments, ne gardant que celle pour clavecin solo, que le compositeur jugeait suffisante en elle-même.
Ce qui est tout à fait le cas. Car jamais ne ressent-on une absence, un vide que pourrait créer la disparition de deux lignes musicales, la troisième étant per se suffisamment riche. Et pourtant, alors que la Muse avait succombé à sa superbe intégrale des Ordres de Couperin (Solstice), et écouté avec enthousiasme les œuvres pour clavecin de Rameau (Solstice) à l’allure majestueuse quoique parfois un peu brusque, on peine ici à être véritablement emporté par l’interprétation qu’en donne la claveciniste acclamée.
La musique est très belle, le clavecin possède un son très libre, dégagé, avec de belles basses rondes et amples, et des aigus très clairs, jamais perçants, avec entre les deux, un médium plutôt suave. Le jeu de Noëlle Spieth se révèle mesuré, souple, ornementant à nous en faire tourner la tête (la Laborde, par exemple), toujours avec justesse et sans lourdeur ni excès. Le toucher est certes parfois un peu pesant, un peu – volontairement – asséné (quoi qu’on reste bien loin du poids accablant d’un certain enregistrement de certaines Apothéoses pour deux clavecins), notamment dans les pièces plus lentes comme la Boucon, ou dans le Vezinet, où l’on perd ainsi toute la fantaisie badine du morceau, par une main droite qu’on aurait souhaité peut-être un peu plus légère, et ainsi l’Agaçante l’en devient presque, et la La Polpinière et les Tambourins ressemblent presqu’à du Beethoven et du Mozart (respectivement).
Non, à dire vrai – car même si l’auteur de la présente n’est que le plus humble de vos serviteurs, l’intimité que vous commencez à partager à travers ses frasques en noir sur vert peut lui permettre de vous parler franchement —, ce n’est pas ce jeu un peu carré qui soulève nos réserves, mais une certaine neutralité, loin de la poésie tendre que la claveciniste avait insufflé chez Couperin, un relatif manque de fantaisie, de lyrisme ou d’envol. La ligne musicale est toujours tenue sans faute, les ornements d’une impeccable justesse, les suspensions précises durant le temps nécessaire, mais rien de tout cela ne semble suffisamment habité, et reste d’une terrible perfection technique, avec quelques propositions d’interprétation, qui ne sont pas poussées jusqu’à leur conclusion. La Timide est tellement pleine de son titre qu’on pourrait croire qu’elle se languit, et la Pantomime nous semble une caricature du genre consacré par Debureau.
N’y voyez aucune méchanceté aucune de la part du dévoué signataire de la présente, mais, devant apporter une conclusion à cette critique, il lui semblerait que le disque pourrait constituer une excellente bande-son qui enjoliverait sacrément un dramatique du Service Public se déroulant dans les cabinets privés et feutrés du Château de Versailles…
Charles Di Meglio
Technique : captation irréprochable, resserrée autour de l’instrument qui parvient malgré tout à vivre et se faire entendre