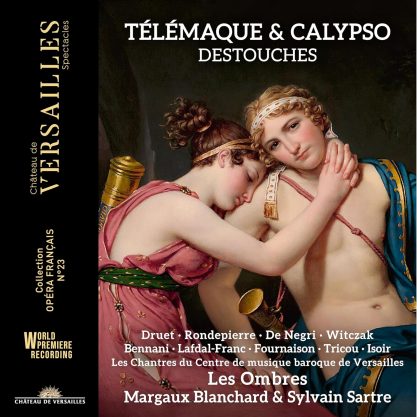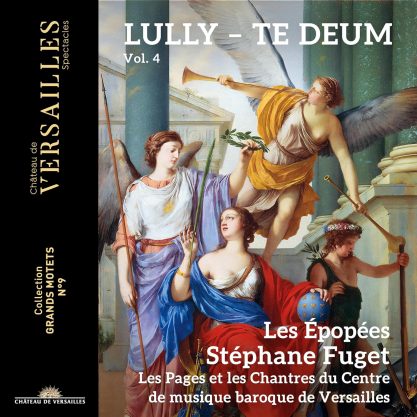Les Adieux à la Reine

Réalisateur : Benoît Jacquot
Lolita Chammah : Louison.
Julie-Marie Parmentier : Honorine.
Michel Robin : Jacob Nicolas Moreau.
Noémie Lvovsky : Mme Campam.
Xavier Beauvois : Louis XVI.
Virginie Ledoyen : Gabrielle de Polignac.
Léa Seydoux : Sidonie Laborde.
Diane Kruger : Marie-Antoinette.
(100’, France, 2012)
Marie-Antoinette et la chute de la monarchie française ont passionné les cinéastes, séduits par le tragique destin de l’Autrichienne, de sa futilité capricieuse à sa dignité retrouvée sur l’échafaud. Après la bonbonnière de Sofia Copola, rock-star adolescente en crise d’indépendance, Benoît Jacquot livre sa passionnante vision d’un naufrage programmé. Pourtant, le résultat est aussi brillant qu’inégal, et les amateurs de reconstitution historique rigoureuse retourneront rapidement aux deux long-métrages commissionnés pour le bicentenaire de 1989 et injustement méconnus : la sobre Autrichienne de Pierre Granier-Deferre qui retrace avec minutie le procès de la Reine incarnée par Ute Lemper, et le premier volume de la monumentale fresque La Révolution Française un peu trop scolaire mais à la réalisation incroyablement soignée où la souveraine prend les traits gracieux de Jane Seymour.

Les Adieux à la Reine© Carole-Bethuel / Ad Vitam Distribution
Dès les premières minutes, et en dépit d’une bande-son indigente et facile, Jacquot nous fait plonger dans l’envers du décor versaillais. Tout au long du film le spectateur explorera ainsi les entresols humides, les combles réduits, les galetas de la domesticité, soulignant la proximité et le contraste entre les bas-fonds des coulisses et la scène chamarrée du pouvoir, des ors du Petit Trianon à ceux de la Grande Galerie, exacerbant les constats de William Ritchey Newton dans son excellent Derrière la façade : Vivre au château de Versailles au XVIIIe siècle (Perrin, 2008) sur la vie quotidienne au château, plus accessible que son ouvrage de référence La Petite Cour : Services et serviteurs à la Cour de Versailles au XVIIIe siècle (Fayard, 2006).
Mais même dans les pièces d’apparat, le réalisateur se délecte de l’usure des dorures, des traces de doigts sur les boiseries, conférant au Château un parfum de décrépitude et de pourriture, reflet de cet Ancien Régime qui se délite.
Tout au long du film, qui retrace les évènements du 14 au 17 juillet 1789 tels que vus depuis Versailles, le spectateur s’identifiera à l’innocence de Sidonie Laborde (Lea Seydoux), lectrice adjointe de la Reine que Chantal Thomas a recréé à partir d’une ligne de l’Almanach Royal, et dont le visage juvénile et la candeur nous servent de guide dans le dédale d’un navire en perdition. Le propos du film se résume ainsi à l’errance de la jeune fille, ballottée dans les soubresauts d’une cour paniquée qui apprend la prise de la Bastille, une cour partagée entre la perpétuation de la routine (Le Cahier des Atours auquel il faut ajouter une broderie de dahlia réclamée par la Reine, comme si les petits-riens continuaient) et l’agitation vaine de nobles partagés entre la fuite, le suicide, ou l’inaction. Après des débuts poussifs qui nous permettent de plonger dans l’intimité de l’Autrichienne (admirable Diane Kruger), une scène remarquable scande le passage aux Enfers et la fin d’un monde : celui où dans la nuit, la jeune Sidonie se fraye un passage dans les couloirs surpeuplés et obscurs des appartements de courtisans, cernée par les halos des bougeoirs et les conversations inquiètes. Tristes apprêts, pâles flambeaux…

Les Adieux à la Reine© Carole-Bethuel / Ad Vitam Distribution
Pour capturer ce sentiment de catastrophe imminente et inéluctable, Benoît Jacquot manie la caméra avec une grande fluidité, optant pour des prises de vue constamment en mouvement, adoptant souvent le point de vue subjectif de Sidonie (cachée derrière des malles, courant de droite et de gauche…), usant de courtes profondeurs de champ. Les plans fixes en sont d’autant plus importants, comme celui où la jeune femme court dans une l’enfilade fantomatique, bleutée et déserte, des Grands Appartements dont on n’aperçoit que les chambranles, ou celui où elle est assise sur un banc de la Cour de Marbre tout aussi abandonnée.
Pourtant, en dépit de ces qualités, le long-métrage n’est pas aussi abouti qu’on eût pu l’espérer. La faute avant tout à des personnages trop falots, et à un jeu moderne et naturel qui se résume souvent à des dialogues d’une effarante et familière banalité (du type « Y se passe quoi ? »), d’une platitude sans nom, qui donnent à l’ensemble le cachet d’un téléfilm moderne peu convaincant, et où toute étiquette a disparu. Mis à part le portrait complexe de la reine, capricieuse, charmante et calculatrice de Diane Kruger (une scène sert d’ailleurs de clin d’œil à la diabolique Glenn Close dans les Liaisons Dangereuses de Stephen Frears), force est d’avouer que seuls les seconds-rôles du généalogiste Moreau, voire du débonnaire Louis XVI de Xavier Beauvois tirent leur épingle du jeu.

Les Adieux à la Reine© Carole-Bethuel / Ad Vitam Distribution
Il faut ajouter à cela les inutiles mais racoleurs relents lesbiens de la relation entre Marie-Antoinette et la Duchesse de Polignac (Virginie Ledoyen) au déhanché digne d’un podium se trémoussant en robe vert électrique et dont les spectateurs n’ignoreront rien de l’affriolante anatomie).
Enfin, on notera que la reconstitution se révèle moyennement rigoureuse du point de vue des décors et costumes. Ainsi, dès les premières minutes, le spectateur maniaque sursautera en voyant des… euh… bon… en étant tolérant, sans doute des Gardes Françaises (on se réfèrera au Lienhart & Humbert ou à Lelièpvre pour retrouver ces mêmes gardes en tenues conformes au règlement de 1786) traverser l’affreuse Grille Dorée sponsorisée par Monnoyeur dans la Cour Royale alors que se détache à l’arrière-plan le… Pavillon Dufour construit sous Louis-Philippe. De même, l’uniformologue sera sauvé par un défibrillateur secourable après s’être ému des tenues approximatives des Suisses, de l’absence de Gardes du Corps, des laquais en livrée rouge, bleu et or bien éloignées de la Livrée Royale pourtant parfaitement documentée (cf. article du Bulletin du Centre de Recherche du Château de Versailles), tandis que l’on cherchera en vain une vraie robe à la française dans les costumes de cour simplifiés (qu’importe, on voit la plupart du temps des bonnets de nuit) alors que la coiffure de la Reine correspond plutôt aux années 1770. On passera également sur les menues inexactitudes en termes de mobilier ou d’objets, mais l’accumulation d’erreurs, bien que non rédhibitoires par rapport au propos du film, s’avère assez agaçante et se cumule au manque de crédibilité des acteurs si bien que l’on aurait pu souhaiter soit une reconstitution plus approfondie et un jeu plus théâtral, soit à l’inverse une mise en scène contemporaine transposant abstraitement et habilement le message.

Les Adieux à la Reine© Carole-Bethuel / Ad Vitam Distribution
Au final, la grande réussite de Benoît Jacquot a été de montrer un Versailles intime et hagard, réminiscent – toute proportions gardées – de La Chute d’Olivier H. par son atmosphère claustrophobique, ses peurs, et son désespoir. Autopsie d’un microcosme en perdition, photographie d’un abîme entrouvert, les Adieux à la Reine, avec son unité de temps, de lieu et d’action, aurait pu s’appeler « Quatre jours qui ébranlèrent le monde ». Et ce n’est pas rien.
Armance d’Esparre