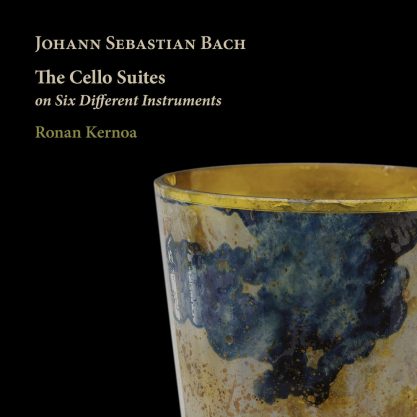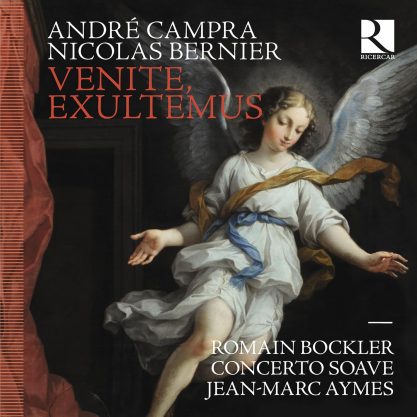« C’est pour moi le projet le plus ambitieux de Bach, le plus incroyable. » : entretien avec Stephan Mac Leod, chanteur, fondateur et directeur musical de Gli Angeli Genève, à propos de la parution de l’intégrale des cantates sur mélodie de choral de Bach

Stephan MacLeod et Gli Angeli Genève © Carole Parodi
Troisième partie : L’intégrale des cantates sur mélodie de choral de Bach
a) La genèse d’un cycle monumental

Muse Baroque : Stephan MacLeod, abordons ce grand projet qui vous a occupé plusieurs années : l’intégrale liturgique des cantates sur mélodie de choral de Bach. Comment naît une telle ambition ? Vous êtes-vous levé un matin, en 2011, avec cette certitude ?
Stephan MacLeod : Ce ne fut pas une illumination soudaine, mais plutôt le fruit d’une longue maturation. Il faut comprendre que Bach est l’ADN même de Gli Angeli Genève ; l’ensemble a été créé autour de sa musique. J’avais très tôt conscience que pour obtenir un soutien public pérenne et structurer l’ensemble, il nous fallait bâtir un projet à long terme. Cette intégrale offrait une double garantie : celle de fidéliser notre public, et celle de faire progresser les musiciens, avec les cantates de Bach comme “étalon”, à raison de trois concerts par an.
Nous avons débuté ce cheminement dès 2005. Pendant quatre ans, nous nous sommes consacrés presque exclusivement aux cantates. Après deux enregistrements chez Sony et le développement de nos activités vers les grands oratorios, je me suis retrouvé, vers 2010, avec une connaissance intime de ce répertoire. C’est à ce moment précis que j’ai commencé à percevoir la cohérence structurelle du corpus des cantates sur mélodie de choral et à comprendre que Bach y avait travaillé pendant plus de dix années et pas seulement pendant 9 ou 10 mois comme on me l’avait appris. J’ai réalisé qu’il s’agissait d’un véritable legs musical, d’un testament soigneusement construit par le Cantor.
M. B. : en quoi ce corpus est-il si spécifique par rapport aux autres cycles de cantates ?
ML. : La caractéristique fondamentale est l’utilisation de la mélodie de choral. D’abord, le chœur d’entrée est systématiquement construit sur la mélodie d’un choral luthérien. Parfois, cette mélodie irrigue l’œuvre entière ; d’autres fois, elle surgit en citation dans un air ou dans un récit, par exemple à la trompette ou dans la partie de continuo. Il arrive même que le texte entier de la cantate soit une paraphrase littérale des strophes du choral – ce qui représentait un défi pour les librettistes, certains chorals comportant beaucoup de strophes !
Pour saisir la portée de ce geste, il faut comprendre ce qu’est le choral au XVIIIe siècle. C’est le b.a.-ba du luthérien. C’est comparable, toutes proportions gardées, à ce que représentent aujourd’hui les sourates pour un enfant éduqué dans une école coranique. Le choral est le matériau avec lequel l’Allemand de 1725 apprend à lire, à écrire, à chanter, à penser. Le choral est le terreau culturel commun à tous à l’époque.
À Leipzig, ville d’environ 25 000 habitants à l’époque, la société est d’une uniformité que nous avons peine à imaginer aujourd’hui. Hormis lors des foires, la population est quasi exclusivement luthérienne. Ils partagent la même langue, la même cuisine, la même foi. Dans ce terreau, le choral possède une puissance communicative absolue, universelle.

La Thomaskirche de Leipzig vers 1723, gravure sur cuivre – Source : Wikimedia Commons
M. B. : Bach l’utilise donc comme une porte d’entrée vers son auditoire ?
ML. : Exactement. Imaginons la situation : Bach arrive à Leipzig en 1723, parce que c’est un poste très prestigieux et qu’il a envie d’écrire de la musique religieuse. Il avait d’ailleurs commencé un cycle de cantates à Weimar, avant de se brouiller avec son employeur.
Mais Leipzig est une ville conservatrice. C’est une ville où la musique, depuis une trentaine d’années, est assez ennuyeuse et mal fichue, alors même que, un siècle avant Bach, on y publiait l’un des plus importants recueils de musique de l’histoire de la musique allemande : Les Fontaines d’Israël de Schein, publié en 1623 à Leipzig, Schein qui est Thomaskantor, comme Bach va l’être plus tard. Après Bach, à Leipzig, il y aura Mendelssohn, Schumann, Beethoven. Mais à l’époque de Bach, en termes de qualité musicale, Leipzig, c’est le néant. Pire encore, durant sa première année (1723-1724), sa musique choque. On lui reproche d’écrire une musique “opératique”, trop complexe. Pour des oreilles habituées à la simplicité de son prédécesseur Kuhnau, les cantates de Bach devaient sonner avec la modernité radicale d’un Luciano Berio !
Face à cette incompréhension, Bach réagit en génie. Il ne simplifie rien – au contraire, il va écrire une musique encore plus savante. Mais il ajoute une “couche” d’accessibilité : le choral. En basant ses grandes fresques d’ouverture sur des mélodies que tout le monde connaît par cœur, il offre une clé d’écoute immédiate. Dès les trois premières notes, le fidèle sait de quoi l’on parle, il identifie les enjeux théologiques, philosophiques et liturgiques. C’est un coup de maître.
M.B. : vous évoquez une grande diversité dans ce cycle. Ces cantates ne sont-elles pas un peu répétitives ?
ML. : Au contraire, la variété est stupéfiante ! Dès le début du cycle, en juin 1724, Bach semble vouloir démontrer toute l’étendue de sa palette. Pour un dimanche donné, il compose dans un style radicalement opposé à celui de la semaine précédente.
Prenez les premières œuvres : parmi toutes les premières cantates du cycle, pour un dimanche donné, Bach compose dans un style aussi différent que possible que le dimanche d’avant ! La BWV 20, c’est une grande ouverture à la française. La BWV 2, c’est une ouverture en style antique avec des trombones, avec un contrepoint ultra compliqué. On pourrait dire que c’est une espèce de Gombert tardif, terrible. La troisième, la BWV 7, débute par une ouverture concertante à l’italienne avec des dialogues instrumentaux. Dans les quatre premières cantates du cycle, il donne le choral aux quatre voix différentes du chœur. Dans la BWV 20, le choral est au soprano. Dans la BWV 10, il est à l’alto. Dans la BWV 7, au ténor. Et dans la BWV 138, à la basse. C’est pensé. Bach prépare un socle fondamental. On ne m’avait jamais expliqué ça non plus.
C’est programmatique. Bach pose les fondations d’un édifice théorique. Par la suite, il confiera le plus souvent le choral aux sopranos – c’est acoustiquement plus efficace – mais cette volonté initiale de démonstration est patente.
M.B. : vous pensez que les fidèles chantaient aussi les chorals en même temps ?
ML. : je pense qu’ils les avaient dans la tête et peut-être qu’il y en a qui osaient chanter avec le choral. De toute façon à Saint-Thomas, ça n’a pas beaucoup d’importance parce que les fidèles sont 15-20 mètres plus bas, ils ne peuvent pas avoir un grand impact sur la musique qui se fait à la tribune. Ce qui est sûr, c’est que s’ils chantaient, comme Bach était assis à l’orgue, il ne les entendait probablement pas en jouant !
M.B. : ce cycle s’interrompt pourtant au printemps 1725, comme s’il s’essoufflait ?
ML. : C’est là que l’histoire devient passionnante. Le 2ème cycle de cantates de Leipzig court de juin 1724 à avril 1725. Après cette date, la production de cantates de Bach ralentit fortement. Il passe d’une boulimie créatrice à une production sporadique. Pourtant, si l’on regarde attentivement les dix années qui suivent (1725-1735), on s’aperçoit que Bach continue d’écrire des cantates sur mélodie de choral, au compte-gouttes. Et en analysant le calendrier liturgique, on réalise que ces cantates tardives viennent boucher très précisément les “trous” laissés dans l’année 1724-1725.
M.B. : Pourquoi y avait-il des “trous” ?
ML. : Pour des raisons calendaires ou pragmatiques. Deux fêtes peuvent tomber un même dimanche, obligeant le clergé à choisir l’une et non l’autre. Ou bien Pâques tombe très tôt, supprimant certains dimanches après l’Épiphanie. Il y a aussi les aléas de la vie : un voyage pour réparer un orgue, une visite familiale, etc…
Ce qui est stupéfiant, c’est que des années plus tard, en 1730 ou 1734, Bach compose pour un dimanche précis une cantate sur mélodie de choral, comme s’il avait gardé en tête la case vide de son tableau de 1724. Sur les 13 cantates complémentaires, 9 qu’on peut très précisément dater viennent remplir ces cases vides avec une précision chirurgicale. Comme si Bach avait conservé l’idée sur son étagère pendant des années, et souhaitait compléter son cycle.
Pourquoi fait-il cela, alors qu’il n’est plus dans cette dynamique de production ? Pour Dieu ? Pour sa propre satisfaction d’artisan ? Pour la postérité ? Je l’ignore, mais cette persévérance démontre que ce cycle était sans doute son projet le plus cher. C’est bien plus fou encore que le Clavier bien tempéré ou que la Messe en si, d’après moi en tout cas…
M.B. : mais, pour faire l’avocat du diable, des cantates sur mélodie de choral, il en avait composé auparavant, la BWV4 par exemple…
ML. : Oui, mais la BWV 4 est la seule exception notable. Bach se comporte souvent comme un artisan pragmatique, un “cordonnier” de génie qui ne jette rien. Il reprend cette cantate de jeunesse (BWV 4), écrite vers 1707 à Mühlhausen, et la réadapte pour Leipzig. Il étoffe l’orchestration, ajoute des cornets et trombones qui n’existaient pas dans sa version originale.
b) Dans la “cuisine” de l’interprète : préparation et enregistrement

Stephan MacLeod et Gli Angeli Genève © Carole Parodi
M.B. : Concrètement, comment prépare-t-on une telle somme ? Quel était votre rythme de travail entre 2017 et 2023 ?
ML. : Entrons dans la cuisine ! Nous avons établi un protocole très strict pour programmer chaque concert. Le schéma idéal sur quatre jours était le suivant :
- le premier jour, on travaille les airs avec instruments solistes, et quand il y a beaucoup de chœurs, on commence aussi à travailler avec les 8 chanteurs. Mais sur les dernières années, on parvenait à nous concentrer uniquement sur les solistes, le continuo et les instruments solistes le premier jour.
- le deuxième jour, on travaille avec les cordes seules puis on lit les autres airs, on travaille avec les 8 chanteurs et un des claviers pour définir comment on va parler et penser le texte en le chantant ensemble et à la fin de la journée tout le monde est là et on doit avoir lu tout le programme du concert à venir au moins une fois.
- le troisième jour, on fait des filages et du travail sur les choses délicates.
- et le quatrième jour, on fait un raccord et le concert dans les lieux du concert.
Nous ne travaillions dans l’église (le Temple de Saint-Gervais à Genève) que le dernier jour. C’est un lieu magnifique mais très résonnant, fatigant pour les répétitions. Les concerts enregistrés ont été très fatigants, parce que d’où je suis c’est déjà difficile de chanter et de diriger en même temps. Le fait de chanter amène à ce que j’entende évidemment moins que si je ne chantais pas. Et dans la configuration de cette église, c’est très bien pour le public qu’on soit placés devant, mais nous, d’être entourés par l’orchestre, c’est parfois terrible, parce qu’on s’entend très, très mal. Et là, c’est vraiment Markus Heiland et les micros qui arrivaient à séparer le bon grain de l’ivraie.
M.B. : justement, s’agit-il d’enregistrements véritablement live ? La qualité sonore est telle qu’on en doute parfois.
ML. : Je vous assure que c’est du live pur ! Il n’y a quasiment pas de montage, hormis quelques raccords nécessaires. Nous n’avions pas le budget pour faire des sessions de studio après les concerts. C’était un pari risqué : “Ça passe ou ça casse”.
Mais pour être tout à fait transparent, et c’est très clairement indiqué sur le livret technique qui accompagne notre coffret, nous avons organisé une session de rattrapage de trois jours en février 2024, une fois les concerts terminés. Nous avons réenregistré une vingtaine de plages sur les 600 que compte le coffret, pour corriger des imperfections insupportables. Pour ce faire, nous avons dû tapisser l’église vide de tissu noir pour recréer l’acoustique de la salle pleine (la présence du public absorbe énormément le son). Mais 95% de ce que vous entendez est le fruit du concert.
M. B. : la résonance du lieu a-t-elle dicté vos choix de tempi ?
ML. : C’est un danger constant. L’acoustique de cette église est belle, très flatteuse pour les aigus, mais elle manque un peu de définition dans les basses. Or, pour moi, tout part de la basse !
Nous avons refusé de ralentir pour complaire à l’acoustique. Grâce à la virtuosité et à la confiance des musiciens, nous avons pu maintenir des tempi vifs. Il faut réaliser que dans cette configuration, avec les chanteurs devant et l’orchestre autour, les hautbois et les violons ne s’entendent pas entre eux ! Ils jouent à l’instinct, en se fiant à leurs gestes et aux miens.
c) Une vision esthétique : effectifs et sonorité

Stephan MacLeod et Gli Angeli Genève © Carole Parodi
M.B. : puisque vous abordez la question des effectifs, pourquoi 8 chanteurs ? Cela ne correspond ni à une voix par partie, ni aux effectifs du fameux Mémorandum de Bach d’août 1730 sur lequel tant les tenants du « une voix par partie » que ceux d’un chœur plus fourni s’appuient.
ML. : En réalité, on ne sait toujours pas si le chœur à Saint-Thomas était constitué de 16 chanteurs, de 4 doublés… Qui faisait quoi exactement ? Sans m’appesantir sur les controverses musicologiques, je vais dire pourquoi nous avons choisi 8 chanteurs : d’abord nous n’avions pas assez d’argent pour 12, mais surtout, à 8, on ne peut pas se retrouver dans une esthétique chorale telle qu’on l’entend aujourd’hui. De l’époque de Bach, on ne saura jamais exactement comment les choses sonnaient. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il y a plus de sopranos et d’altos qu’il y a de ténors et de basses. Et est-ce qu’il utilisait une formation 6-6-2-2 ou 3-3-1-1 ? Est-ce 8-8 ? Sincèrement, je pense que cela pouvait changer tous les dimanches, chaque année, ou encore en fonction du niveau des chanteurs disponibles d’une semaine à l’autre.
D’ailleurs, Bach déplorait leur niveau souvent lamentable. A partir de 1726, il se met à écrire de la musique plus facile [alors qu’en même temps, de 1729 à 39 il dirigera le Collegium Musicum au Café Zimmermann où le niveau était certainement plus élevé que dans ses églises]. Prenons les Passions : la Saint Mathieu (1727) peut être chantée très bien par des mauvais chanteurs, alors que la Saint Jean (1724), est l’une des choses les plus difficiles qui soit. Pourquoi ? Parce que Bach n’écrit plus de musique compliquée au bout d’un certain temps. Face à ces réalités, ce grand débat sur combien de chanteurs dans les cantates de Bach, ça me passe à des kilomètres, ça n’a aucune valeur historique, ça n’a aucune valeur esthétique ! Il n’y a aucun desiderata d’être juste historiquement derrière les huit.
Et puis, à partir du moment où on ne fait pas du Bach avec un grand orgue, on est tellement à côté de la plaque en termes de rapport de balance, de rapport sonore… J’ajoute qu’on n’est plus dans un contexte liturgique, on les joue comme de la musique, même si je fais du Bach à Saint-Thomas relativement régulièrement, ce n’est plus la même chose qu’à l’époque.
M.B. : autre particularité frappante, la disposition spatiale. Les chanteurs sont devant l’orchestre.
ML. : C’est essentiel ! Si les chanteurs ne sont pas devant, on ne comprend pas la même chose à cette musique. Le paradigme romantique a placé le chœur derrière l’orchestre, obligeant ce dernier à jouer moins fort pour accompagner. Chez Bach, le Verbe est premier. La Parole doit être projetée physiquement vers le fidèle. L’orchestre est autour et derrière, en soutien.
Nous respectons aussi la disposition historique de l’orchestre : les hautbois font face aux violons, ils ne sont pas mélangés. On faisait comme cela avec Gli Angeli un peu par hasard, et j’ai découvert que c’était l’usage à Leipzig à l’époque, et acoustiquement, cela change beaucoup en termes de dialogue.

Stephan MacLeod et Gli Angeli Genève © Carole Parodi
M.B. : et le continuo, il est derrière aussi ?
ML. : Tout à fait. Le continuo est derrière nous, au centre, toujours avec un orgue et un clavecin, sauf en 2011 parce qu’on n’avait pas encore assez d’argent pour le clavecin, donc les trois cantates qui ont été enregistrées en 2011 sont sans clavecin.
M.B. : mais il semble qu’il n’y avait pas de clavecin à Leipzig au continuo, du moins d’après Cantagrel…
ML. : Il a vraiment écrit ça ? Je pense au contraire qu’on sait qu’il y avait au moins un clavecin sur la tribune de Saint Thomas à Leipzig et qu’il était habituel qu’un de ses fils le tienne…
[NdlR : cf. Bach en son temps, Fayard, 2010. “Il semble que le clavecin n’ait été utilisé à l’église que lorsque l’orgue n’était pas en état de fonctionnement, pour une raison ou une autre.” (pp. 78-79), mais cette hypothèse est débattue dans Laurence Dreyfus, Bach’s Continuo Group, Harvard University Press, 1990.].
M.B. : en parlant de l’intégrale mythique de Harnoncourt et Leonhardt, ça ne vous a jamais tenté de recourir à des voix d’enfants ?
ML. : J’y ai réfléchi et je me suis rendu compte que non… Le Tölzer Knabenchor, c’est vraiment un peu… Je chante parfois avec eux mais non, je n’aime pas ça, je n’aime vraiment pas ça. Je reconnais cependant qu’un enfant qui chante bien, c’est exceptionnel, c’est extraordinaire.
M.B. : sans parler des parties solistes, dans le chœur, cela ne vous convainc pas non plus ? Dans Leonhardt qu’on citait par exemple, avec le Wiener Sängerknaben ?
ML. : Malheureusement, cela ne s’écoute plus aussi bien qu’il y a 30 ou 40 ans. Je trouve que c’était vraiment une autre époque dans l’interprétation, une époque de pionniers : c’est superbe mais il y a tellement de problèmes de facture, de problèmes au niveau de la maîtrise des instruments, de soucis de justesse. Le niveau des musiciens a tellement monté depuis. Le niveau des jeunes instrumentistes d’aujourd’hui est juste dément. Il y a aussi une espèce de manière commune, un peu “world fashion”, de faire du Bach aujourd’hui, il y a une grammaire partagée qui fait que les musiciens se trouvent très rapidement et très facilement. D’ailleurs, cela peut aussi être un peu dangereux, car si tout le monde fait le même Bach, c’est un peu embêtant !
M.B. : est-ce que vous êtes intransigeant sur l’instrumentarium ? C’est-à-dire, pas de correction pavillonnaire sur les cors, les trompettes vraiment naturelles, et… l’orgue au grand orgue ?
ML. : Non, pas à ce point. Par exemple pour les trompettes naturelles, je préfère les trompettistes qui ont des trous. Là où on a poussé un peu le bouchon, c’est qu’on est les premiers qui avons utilisé le corno da tirarsi dans toutes les cantates où Bach demandait simplement “cor” ou “cornet” ou “corno” pour doubler le choral. Vous n’êtes pas sans savoir que Rainer Egger à Bâle a inventé il y a une vingtaine d’années un instrument qui est probablement une utopie. Il en existe quatre ou cinq au monde. Il est joué par Olivier Picon sur nos disques. Il le prête parfois à des collègues. C’est un cor à coulisses ! C’est un instrument qui ressemble beaucoup à la trompette à coulisse, la “tromba da tirarsi”. Le cor à coulisse, c’est probablement cet instrument qui s’appelle “corno”. Il y a d’ailleurs des cantates où il est écrit “corno da tirarsi”, et pas “tromba da tirarsi”.
Ce corno da tirarsi, c’est une reproduction de la trompette enroulée du fameux tableau de Gottfried Reiche, le trompettiste de Bach, celui pour qui il a écrit le deuxième Brandebourgeois et qu’il a aussi retrouvé à Leipzig à une certaine époque. C’était un virtuose et il lui a écrit plusieurs airs extraordinaires pour trompettes. Donc, Rainer Egger a construit un cor à coulisse sur la base de cet instrument. Le résultat donne un son merveilleux. Suzuki, quand il a entendu ça, l’a tout de suite utilisé parce que c’est tellement mieux que de doubler le choral avec un vrai cor de chasse, mais était dépité parce qu’il ne l’avait pas utilisé dès le début de son intégrale !
D’abord, avec le cor à coulisse, on peut tout faire à la bonne octave, ce qui n’est pas possible avec le cor de chasse où il y a des notes qui ne marcheraient vraiment pas. Et c’est beaucoup plus doux et rond que la trompette, et même que la trompette à coulisse. Donc, c’est un peu l’instrument idéal, et on l’a beaucoup utilisé.

Elias Gottlob Haussmann, portrait de Gottfried Reiche (vers 1726), musée de Leipzig – Le compositeur et musicien est né le 5 février 1667 et mort sans descendance le 6 octobre 1734) – source : Wikimedia Commons
M.B. : je ne sais pas comment dire mais il y a aussi une attention toute particulière portée aux violons…
ML. : Nos violons sont tous ancrés dans l’école de Chiara Banchini. La première violon de l’ensemble, pendant de nombreuses année, était Leila Schayegh, qui a été une élève de Chiara. Je travaillais déjà avec certains élèves d’Odile Edouard à Lyon. Et j’ai compris, dès les années 2009-2010 déjà, que quand on mettait l’un à côté de l’autre deux violonistes, un élève d’Odile Edouard à Lyon et un élève de Leila ou de Chiara à Bâle, il y avait naturellement une cohésion instantanée… Ça mettait sept-huit minutes, et après, ils jouaient comme s’ils avaient joué ensemble toute leur vie. J’ai compris que c’était lié à Chiara. J’ai compris que c’était lié à la manière dont Chiara faisait vivre et sonner le violon. Et d’ailleurs, Chiara est devenue une espèce de marraine de l’ensemble. Elle vient à nos concerts à Genève, elle a joué avec nous, elle a fait ses derniers concerts avec nous… Le violon pour Bach, dans l’ensemble, c’est vraiment entièrement l’école de Chiara Banchini. Tous les violonistes de l’ensemble ont étudié avec elle ou avec ses disciples.
M.B. : quelle est la particularité de « l’école Chiara Banchini » ? En termes de sonorités on est loin de l’Ensemble 415…
ML. : Je pense que ça ne ressemble pas du tout à l’Ensemble 415. C’est avant tout la technique de jouer sans mentonnière dès le début, et d’être dans une logique de son et de résonance du violon aussi libre et dense que possible. Le violon de Chiara, c’est avant tout ça, c’est le travail de l’archet sur la corde à vide et le rapport au son et l’importance du son en toute chose. Et je pense que, voilà, les époques sont très, très différentes. 415 ne sonnerait jamais aujourd’hui comme il sonnait hier.
Muse Baroque : autre question, mais c’est du ressenti subjectif. Je trouve que vous avez un son « en cloche », comme ce que Harnoncourt écrivait pour le son chez Bach sur les cordes, lié à l’archet baroque qui empêche un son tenu régulier. C’est-à-dire que ça enfle et puis les finales sont relativement douces. Est-ce que vous faites cela à cause des traités d’époque, ou c’est votre vision naturelle du phrasé ?
ML. : Je pense qu’il y a un rapport au son qui est à la fois lié à moi en tant que chanteur et à ce que je vous disais de mes cordes en tant que violoniste. C’est-à-dire que je pense qu’il y a une manière commune de ressentir le son et de ressentir la forme du son instrumental, entre l’école de Chiara, et ce que je vis en tant que chanteur, ce que j’enseigne en tant que professeur de chant, et ce qu’il est possible de faire ou pas avec la voix humaine. Je ne sais pas trop comment l’expliquer mais c’est chouette d’entendre ça !
M.B. : vous dirigez tout en chantant les parties de basse solistes. N’est-ce pas une contrainte terrible ?
ML. : Au contraire, c’est ma liberté. Je ne suis pas un chef traditionnel qui domine l’orchestre de sa baguette. Je me vois comme un “chef de meute”. Je suis au milieu d’eux, je chante avec eux. Diriger me rend meilleur chanteur car cela me libère de l’angoisse du chant. Le chanteur soliste est, par nature, une créature vulnérable, centrée sur son nombril et son instrument. Quand je dirige, je n’ai pas le temps d’avoir le trac pour moi-même : je dois écouter les autres, anticiper les départs, gérer l’équilibre. Je suis dans l’action pure.
Certes, je n’ai pas l’aura dominatrice d’un Gardiner ou d’un Herreweghe, qui tiennent la musique entière dans leur regard. Eux sont des démiurges ; moi, je suis un artisan parmi les artisans. Je pense que cela libère mes musiciens, qui se sentent plus responsables. Je suis un chef chanteur, je suis plus qu’un chef, et je suis partie prenante. Et surtout, je dois faire de la musique en étant en admiration constante pour ce que sont en train de faire mes collègues.
M.B. : votre vision de Bach a-t-elle changé au cours de ces six années ?
ML. : Pas fondamentalement. Nous avons gagné en fluidité. Au début, on est dans la survie : “Mon Dieu, comment ne pas se planter dans ce tempo ?”. À la fin, on respire la musique. Mais j’ai tenu à garder une cohérence stricte. Mêmes micros, même disposition, même orgue. Bach a composé ces œuvres dans la même “poussière” de Leipzig ; nous devions les enregistrer dans la même unité de lieu et de son.
M.B. : en parlant d’autres chefs, vous semblez critique envers certaines approches…
ML. : Je ne suis pas dogmatique, j’admire beaucoup de choses chez mes confrères. Suzuki a une approche spirituelle très profonde, Herreweghe a un sens du texte et du son inouï. Je suis critique envers les chefs qui traitent Bach comme de la musique pure, en ignorant le texte.
On entend parfois des instrumentistes géniaux qui dirigent des cantates où les récitatifs sont expédiés, bâclés, sans aucune conscience rhétorique. Ils ajoutent des ornements partout, comme s’il fallait décorer cette musique. C’est un contresens. Bach n’a pas besoin de décoration, il a besoin qu’on dise son texte. C’est peut-être mon côté suisse, ou l’influence de l’école hollandaise de Gustav Leonhardt : une certaine austérité, un refus de l’esbroufe au profit de la vérité du discours.

d) Le coffret : une ambition didactique
M.B. : la structure du coffret est très soignée et originale : chaque cantate est précédée d’une pièce d’orgue et du choral chanté a cappella. Pourquoi ?
ML. : Je voulais que ce coffret soit une anthologie du choral luthérien autant qu’une intégrale de cantates. Il y a une volonté didactique assumée. Je veux que l’auditeur, comme l’école ou la paroisse qui acquerra ce disque, puisse entendre la mélodie “nue” avant de l’entendre traitée par Bach.
Pour les pièces d’orgue, nous sommes allés enregistrer sur l’orgue Arp-Schnitger de Groningen aux Pays-Bas, un instrument fabuleux de la fin du 17ème qui a été rénové à l’époque de Bach. De tous les orgues de ce facteur qui sont encore en ordre de marche aujourd’hui, c’est le plus extraordinaire pour la musique de Bach, parce que d’une part il est dans son jus, ce qui est complètement inouï, et d’autre part parce qu’il a été retapé par le fils de Schnitger en 1715-1718 et que son esthétique sonore correspond incroyablement bien et fidèlement à celle de l’époque de Bach.
Comme on a un fantastique organiste dans notre ensemble, Francis Jacob, qui est un ami de très longue date, que d’ailleurs j’ai rencontré en faisant du Bach avec Philippe Pierlot, je lui ai dit que j’aimerais sortir le coffret avec 56 pièces d’orgue pour présenter chaque choral.
Il s’est occupé de faire le choix des pièces d’orgue. Sachant qu’il y a des chorals sur lesquels on a beaucoup d’œuvres et des chorals sur lesquels on n’en a pas. Et pour les chorals pour lesquels on n’avait vraiment rien du tout, j’ai engagé François Saint-Yves pour improviser 5 ou 6 pièces sur ce même orgue aux Pays-Bas, sur lequel on a donc passé 4 jours assez féeriques à faire de l’orgue toute la journée et à enregistrer ces pièces.
D‘ailleurs la pièce d’orgue est très rarement dans une tonalité correspondante à la cantate, entre autres parce que l’orgue de Groningen était à 465 Hz et que nous, on jouait à 415. Comme à Leipzig, où l’orgue de Bach était aussi un ton plus haut que les instruments, et où il transposait donc ses propres cantates un ton plus bas pour pouvoir jouer avec tout le monde…
J’ai aussi décidé de faire entendre le choral, la mélodie du choral dans sa forme la plus ancienne, la plus originale, avec le texte du choral qui commence la cantate a cappella, afin que les gens entendent le choral avant que le choral commence et qu’ils sachent quelle mélodie, à quelle mélodie ils ont affaire. On se rend alors bien compte qu’y a des mélodies qui sont d’une richesse qui ouvre la porte à des harmonies dans lesquelles Bach va s’engouffrer pour faire les trucs les plus dingues possibles. Et puis, il y a d’autres chorals dont la mélodie est plus simple et où on voit dès le début de la cantate que : “Bon allez, bon d’accord, hop”, et puis Bach va juste mettre le choral uniquement aux instruments qui doublent la voix. Alors qu’il y a d’autres cantates où le choral est partout tout le temps, où il le cite à quatre vitesses différentes dans la même cantate, dans le même chœur. Ça, on le montre sur les vidéos, car on a mis en ligne un site Internet avec des vidéos de toutes les partitions qui défilent avec la musique et où les occurrences du choral sont colorées.
Ainsi, l’auditeur fait le cheminement complet : la méditation instrumentale (orgue), la mélodie brute (a cappella), et enfin la cathédrale sonore (la cantate).
M.B. : et maintenant ? Après ce sommet, allez-vous vous lancer dans une autre intégrale ? Telemann ? Graupner ?
ML. : (rires) Non, certainement pas. Graupner, il y a des choses si belles ceci-dit… On a joué du Graupner l’année dernière, et là je me suis dit : “Oh là là, quand même, il y a des trucs dingues, dingues dans Graupner.” Mais non, sur la durée, non, non. C’était un très grand projet que cette intégrale et je suis très content que ce soit fini, très content.
M.B. : merci infiniment pour cet entretien.
Propos recueillis par Viet-Linh Nguyen à Paris le 5 novembre 2025
Vers le début de l’entretien sur la carrière de Stephan MacLeod et la fondation de Gli Angeli Genève
En savoir plus :
- Site officiel de Stephan MacLeod : https://www.gliangeligeneve.com
- Site officiel de Gli Angeli Genève : https://stephanmacleod.com
- Site officiel des cantates sur mélodies de choral par Gli Angeli Genève : https://bach-chorale-cantatas.com
Étiquettes : Gli Angeli Genève, Jean-Sébastien Bach, MacLeod Stephan, musique religieuse Dernière modification: 19 décembre 2025