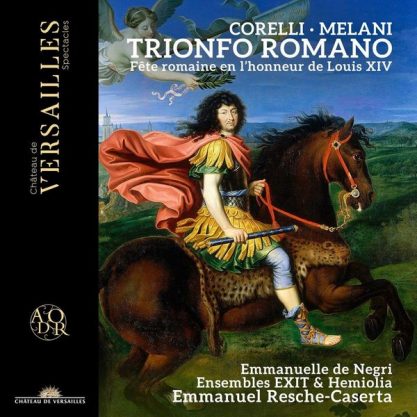« Rome, l’unique objet de mon ressentiment !
Rome, à qui vient ton bras d’immoler mon amant !
Rome qui t’a vu naître et que ton cœur adore !
Rome enfin que je hais, parce qu’elle t’honore !
Puissent tous ses voisins, ensemble conjurés,
Saper ses fondements encor mal assurés !
Et si ce n’est assez de toute l’Italie,
Que l’Orient, contre elle, à l’Occident s’allie !
Que cent peuples unis des bouts de l’univers
Passent pour la détruire et les monts et les mers !
Qu’elle-même sur soi renverse ses murailles,
Et de ses propres mains déchire ses entrailles !
Que le courroux du ciel allumé par mes vœux,
Fasse tomber sur elle un déluge de feux !
Puissé-je de mes yeux y voir tomber ce foudre,
Voir ses maisons en cendres, et tes lauriers en poudre !
Voir le dernier Romain à son dernier soupir,
Moi seule en être cause, et mourir de plaisir. »
(Pierre CORNEILLE, Horace, IV, 5)

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751–1829), Goethe dans la campagne romaine (1787), huile sur toile, Städel Museum, Francfort – Source : Wikipedia Commons
La citation en exergue est bien trop longue, et à initialement, nous pensions juste en citer les deux à quatre vers si fameux. Mais la langue de Corneille est si belle, si fluide, si coulante, qu’on ne saurait l’endiguer, et c’est la tirade entière de Camille, criant sa haine, que nous avons laissée afin qu’elle compense l’extrait suivant que nous vous soumettons aujourd’hui, celui d’un grand cri d’amour de Goethe, à 37 ans, qui le 4 septembre quitte Ratisbonne et arrive à la Toussaint 1786 dans la Ville Eternelle, « capitale du monde », si connue et étudiée, tant rêvée, tant désirée, tant attendue.
Étiquettes : Rome Dernière modification: 27 novembre 2020Rome, 1er novembre 1786.
Enfin je puis parler et saluer mes amis d’un cœur joyeux ! Qu’ils me pardonnent ce mystère, et le voyage, en quelque sorte souterrain, que j’ai fait jusqu’ici ! A peine osais-je me dire à moi-même où j’allais. Même en chemin, je craignais encore, et c’est seulement sous la porte del Popolo que j’ai été certain de tenir la ville de Rome. Et laissez-moi dire aussi que je pense mille fois, que je pense continuellement à vous, en présence des objets que je ne croyais jamais visiter seul. Ce n’est qu’au moment où j’ai vu chacun enchaîné de corps et d’âme dans le Nord, où j’ai vu toute aspiration vers ces contrées évanouie, que j’ai pu me résoudre à entreprendre un long voyage solitaire, et à chercher le centre vers lequel m’attirait une force irrésistible. Dans ces dernières années, cela était même devenu une sorte de maladie que la vue et la présence des objets pouvaient seules guérir. Je l’avoue maintenant, j’avais fini par n’oser plus regarder aucun livre latin, aucun dessin d’une contrée italienne. Mon désir de voir ce pays était mûr depuis trop longtemps. A présent qu’il est satisfait, je retrouve au fond de mon cœur, pour mes amis et ma patrie, l’affection la plus tendre, et le retour me sera doux, il le sera d’autant plus que je n’emporterai pas, je le sens bien, tous ces trésors pour les posséder seul, pour en user seul, mais qu’ils seront pour d’autres et pour moi, durant toute la vie, des guides et des encouragements.Oui, je suis enfin arrivé dans cette capitale du monde ! Je m’estimerais heureux, si je l’avais vue il y a quinze ans, bien accompagné, conduit par un homme éclairé. Mais, puisque je devais la voir seul et de mes propres yeux, il était bon que cette jouissance me fût accordée si tard.
J’ai franchi au vol, pour ainsi dire, les Alpes du Tyrol. J’ai bien vu Vérone, Vicence. Mantoue, Venise ; j’ai vu en courant Ferrare, Cento, Bologne ; j’ai vu à peine Florence. Tel était mon désir d’arriver à Rome, il augmentait si fort à chaque moment, que je ne pouvais plus m’arrêter, et je ne suis demeuré que trois heures à Florence. Me voilà maintenant à Rome et tranquille, et, à ce qu’il semble, tranquillisé pour toute ma vie.
C’est en effet commencer une vie nouvelle, que de voir de ses yeux l’ensemble que l’on connaît en détail intérieurement et extérieurement. Tous les rêves de ma jeunesse, je les vois vivants aujourd’hui ; les premières estampes dont je me souvienne (mon père avait placé les vues de Rome dans un vestibule), je les vois maintenant en réalité, et tout ce que je connaissais depuis longtemps en tableaux et en dessins, en gravures sur cuivre et sur bois, en plâtre et en liège, est réuni devant moi ; où que j’aille, je trouve une connaissance dans un monde étranger ; tout est comme je me le figurais et tout est nouveau. J’en puis dire autant de mes observations, de mes idées : je n’ai point eu de pensées toutes nouvelles, je n’ai rien trouvé tout à fait étranger, mais les anciennes sont devenues si précises, si vivantes, si enchaînées, qu’elles peuvent passer pour nouvelles.
Quand Pygmalion eut formé Élise au gré de ses vœux, quand il lui eut donné autant de vérité et de vie que l’artiste pouvait le faire, et qu’enfin Élise vint à lui et lui dit : « C’est moi ! » que l’être vivant était différent de la pierre sculptée !
Combien aussi il est moralement salutaire pour moi de vivre au milieu d’un peuple tout sensuel, sur lequel on a tant discouru et tant écrit, et que chaque étranger juge à la mesure qu’il apporte avec lui ! Je pardonne à ceux qui blâment et condamnent ce peuple : il est trop loin de nous, et il en coûte trop de fatigue et de frais d’avoir commerce avec lui comme étranger. »
(Johann Wolfgang von GOETHE, Voyages en Suisse et en Italie, Trad. par Jacques Porchat, L. Hachette et Cie, 1862).